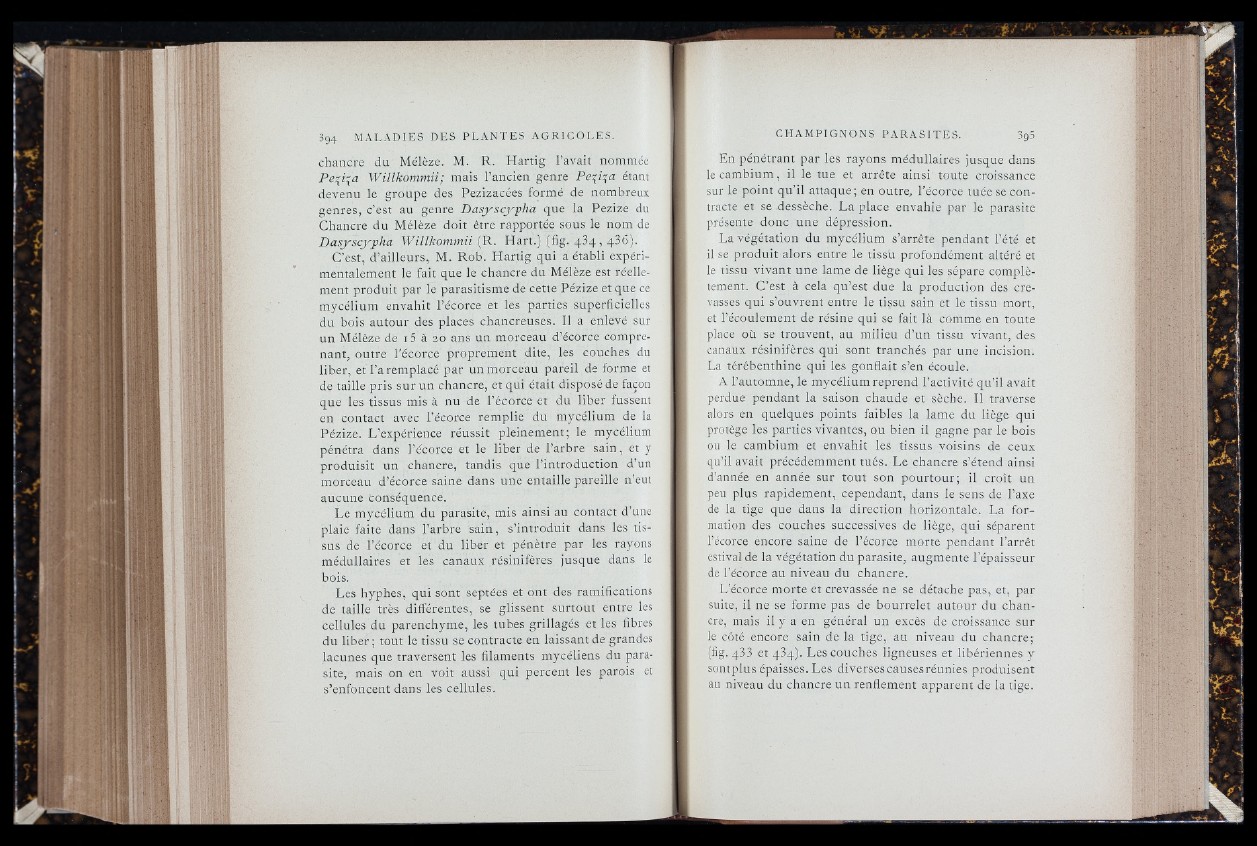
chancre du Mélèze. M. R . Hartig l’avait nommée
P e 0 a W illkom mii; mais l ’ancien genre P e 0 a étant
devenu le groupe des Pezizacées formé de nombreux
genres, c’est au genre D a s y s c y p h a que la Pezize du
Chancre du Mélèze doit être rapportée sous le nom de
D a sy sc y p h a Willkommii (R . Hart.) (fig. q S q , qSü).
C’est, d’a illeurs, M. R ob. Hartig qui a établi expérimentalement
le fait que le chancre du Mélèze est réellement
produit par le parasitisme de cette Pézize et que ce
mycélium envahit l ’écorce et les parties superficielles
du bois autour des places chancreuses. 11 a enlevé sur
un Mélèze de i 5 à 20 ans un morceau d’écorce comprenant,
outre l’écorce proprement dite, les couches du
liber, et l ’a remplacé par un morceau pareil de forme et
de taille pris sur un chancre, et qui était disposé de façon
que les tissus mis à nu de l ’écorce et du liber fussent
en contact avec l ’écorce remplie du mycélium de la
Pézize. L ’expérience réussit pleinement; le mycélium
pénétra dans l ’écorce et le liber de l ’arbre sa in , et y
produisit un chancre, tandis que l’introduction d’un
morceau d’écorce saine dans une entaille pareille n’eut
aucune conséquence.
Le mycélium du parasite, mis ainsi au contact d’une
plaie faite dans l ’arbre sa in , s ’introduit dans les tissus
de l ’écorce et du liber et pénètre par les rayons
médullaires et les canaux résinifères jusque dans le
bois.
Les hyphes, qui sont septées et ont des ramifications
de taille très différentes, se glissent surtout entre les
cellules du parenchyme, les tubes grillagés et les libres
du lib e r ; tout le tissu se contracte en laissant de grandes
lacunes que traversent les filaments mycéliens du parasite,
mais on en voit aussi qui percent les parois et
s’enfoncent dans les cellules.
En pénétrant par les rayons médullaires jusque dans
le cambium, il le tue et arrête ainsi toute croissance
sur le point qu’il attaque; en outre, l ’écorce tuée se contracte
et se dessèche. L a place envahie par le parasite
présente donc une dépression.
La végétation du mycélium s’arrête pendant l’été et
il se produit alors entre le tissu profondément altéré et
le tissu vivant une lame de liège qui les sépare complètement.
C ’est à cela qu’est due la production des crevasses
qui s’ouvrent entre le tissu sain et le tissu mort,
et l’écoulement de résine qui se fait là comme en toute
place où se trouvent, au milieu d’un tissu vivant, des
canaux résinifères qui sont tranchés par une incision.
La térébenthine qui les gonflait s’en écoule.
A l ’automne, le mycélium reprend l ’activité qu’il avait
perdue pendant la saison chaude et sèche. Il traverse
alors en quelques points faibles la lame du liège qui
protège les parties vivantes, ou bien il gagne par le bois
ou le cambium et envahit les tissus voisins de ceux
qu’il avait précédemment tués. Le chancre s’étend ainsi
d’année en année sur tout son pourtour; il croît un
peu plus rapidement, cependant, dans le sens de l ’axe
de la tige que dans la direction horizontale. L a formation
des couches successives de liège, qui séparent
l’écorce encore saine de l ’écorce morte pendant l ’arrêt
estival de la végétation du parasite, augmente l ’épaisseur
de l ’écorce au niveau du chancre.
L ’écorce morte et crevassée ne se détache pas, et, par
suite, il ne se forme pas de bourrelet autour du chancre,
mais il y a en général un excès de croissance sur
le côté encore sain de la tige, au niveau du chancre;
(fig. 433 et 434). Les couches ligneuses et libériennes y
sontplus épaisses. Le s diverses causes réunies produisent
au niveau du chancre un renflement apparent de la tige.