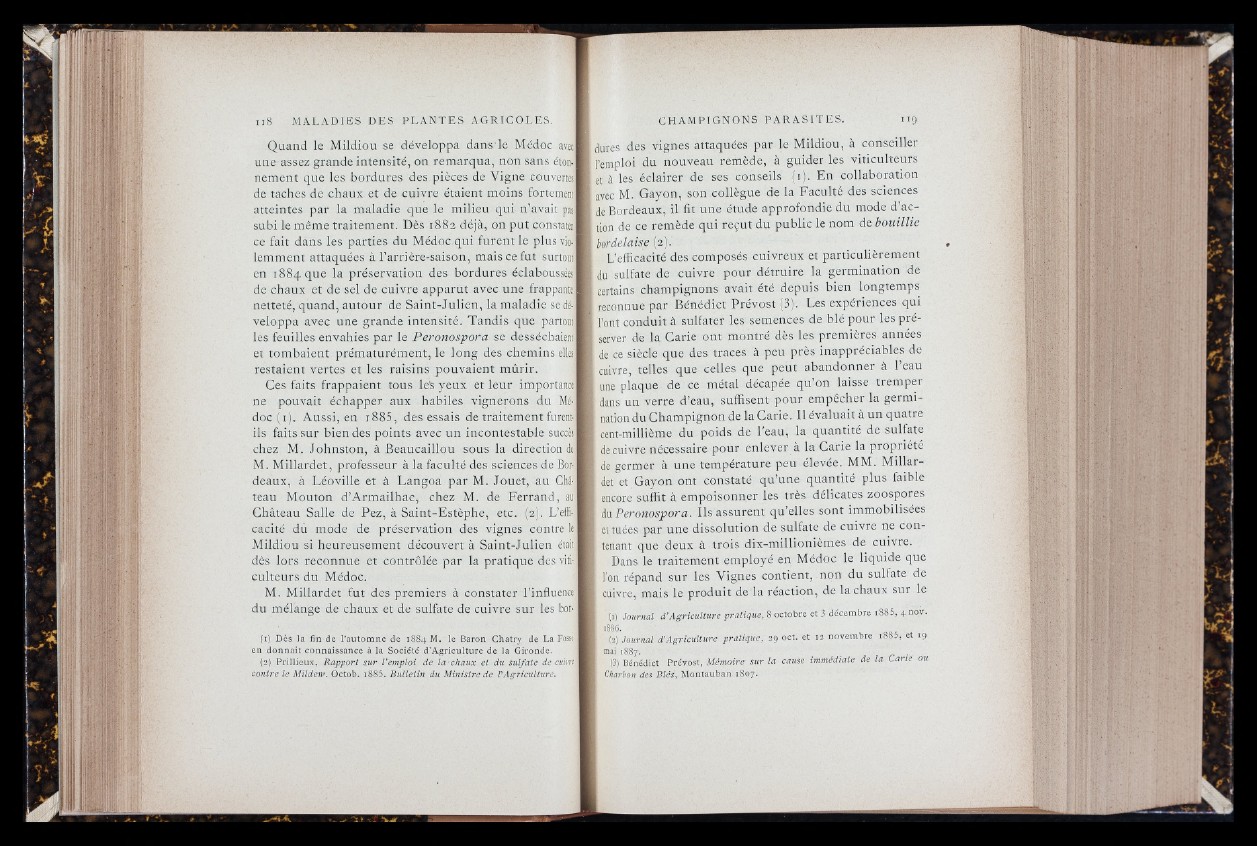
■ Y'h; „
■■ EÎ
i -m
'YÏ
Quand le Mildiou se dévelopopia dans le Médoc avec
une assez grande intensité, on remarqua, non sans étonnement
que les bordures des pièces de Vigne couvertes
de taches de chaux et de cuivre étaient moins fortcmen:
atteintes par la maladie que le milieu qui n’avait pas
subi le même traitement. Dès 1882 déjà, on put constater
ce fait dans les parties du Médoc qui furent le plus violemment
attaquées à l’arrière-saison, mais ce fut surtotit
en 1884 que la préservation des bordures éclaboussées
de chaux et de sel de cuivre apparut avec une frappante
netteté, quand, autour de Saint-Julien, la maladie se développa
avec une grande intensité. Tandis que partotii
les feuilles envahies par le Peronospora se desséchaient
et tombaient prématurément, le long des chemins elles
restaient vertes et les raisins pouvaient mûrir.
Ces faits frappaient tous le's yeux et leur importance
ne pouvait échapper aux habiles vignerons du Médoc
(i). Aussi, en i 8 8 5 , des essais de traitement furent-
ils faits sur bien des points avec un incontestable succès
chez M. Johnston, à Beaucaillou sous la direction de
M. Millardet, pnrofesseur à la faculté des sciences de Bordeaux,
à Léoville et à Langoa par M. Jouet, au Château
Mouton d’Armailhac, chez M. de Ferrand, au
Château Salle de Pez, à Saint-Fstèphe, etc. (2). L’efficacité
du mode de préservation des vignes contre le
Mildiou si heureusement découvert à Saint-Julien était
dès lors reconnue et contrôlée par la pratique des viticulteurs
du Médoc.
M. Millardet fut des premiers à constater l ’influence
du mélanse de chaux et de sulfate de cuivre sur les bot-
(1) Dès la fin de l ’automne de 1884 1^* H Baron Chatry de La Fosse
en donnait connaissance à la Société d’Agriculture de îa Gironde.
(2) Pril iieux, Rapport sur l'emp lo i de la chaux et du sulfate de cuivn
contre le Mildem. Octob. i 8 85. B u lletin du Ministre de VAgricidturc.
dures des vignes attaquées par le Mildiou, à conseiller
l’emploi du nouveau remède, à guider les viticulteurs
et à les éclairer de ses conseils (i). En collaboration
avec M. Gayon, son collègue de la Faculté des sciences
de Bordeaux, il fit une étude approfondie du mode d’action
de ce remède qui reçut du public le nom de bouillie
bordelaise (2).
L’efficacité des composés cuivreux et particulièrement
du sulfate de cuivre pour détruire la germination de
certains champignons avait été depuis bien longtemps
reconnue par Béiiédict Prévost (3). Les expériences qui
l’ont conduit à sulfater les semences de blé pour les préserver
de la Carie ont montré dès les premières années
de ce siècle que des traces à peu près inappréciables de
cuivre, telles que celles que peut abandonner à l’eau
une plaque de ce métal décapée qu’on laisse tremper
dans un verre d’eau, suffisent pour empêcher la germination
du Champignon de la Carie. Il évaluait à un quatre
cent-millième du poids de l’eau, la quantité de sulfate
de cuivre nécessaire pour enlever à la Carie la propriété
de germer à une température peu élevée. MM. Millardet
et Gayon ont constaté qu’une quantité plus faible
encore suffit à empoisonner les très délicates zoospores
du Peronospora. Ils assurent qu’elles sont immobilisées
et tuées par une dissolution de sulfate de cuivre ne contenant
que deux à trois dix-millionièmes de cuivre.
Dans le traitement employé en Médoc le liquide que
l’on répand sur les Vignes contient, non du sulfate de
cuivre, mais le produit de la réaction, de la chaux sur le
(1) Journal d ’A g ricu ltu re pratique, 8 octobre et 3 décembre iS8 5 , 4 nov.
1886.
(2) Journal d 'A g r icu ltu re p ra tiqu e , 29 oct. et 12 novembre R
, et 19
mai 1887. .
(3) Benedict Prévost, Mémoire sur la cause immédiate de la C a n e ou
Charbon des Blés, Montauban 1807.
’ S..LL
î