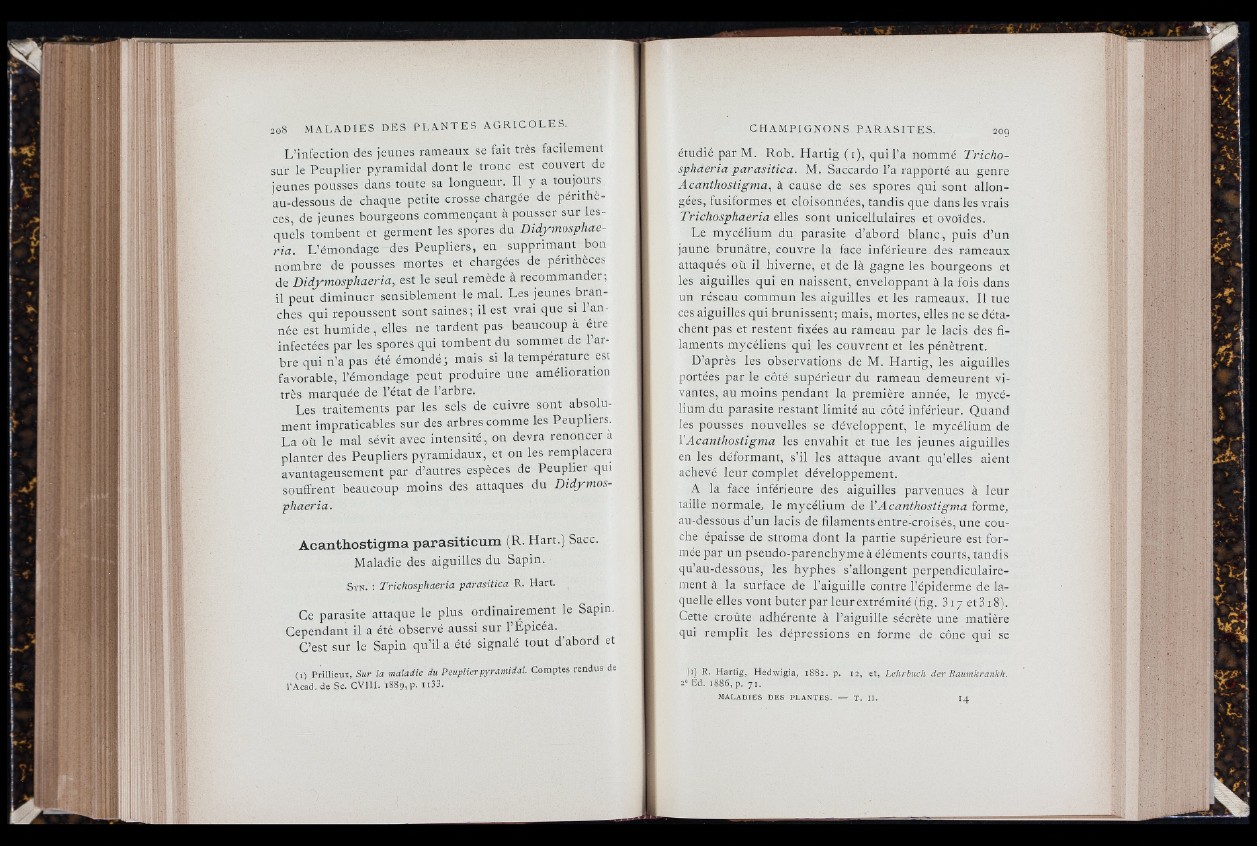
I. V.
^ i
Ï S i MS , a ll!® !
J (I,
it ,
■Ï?
■ :ï.
tïeffl!i
î,
t’
: :ëI
’ /I/
s 1 kì K
rii fe,
ri
2 0 8 M A L A D I E S D E S P L A N T E S A G R I C O L E S .
L ’infection des jeunes rameaux se fait très facilement
sur le Peuplier pyramidal dont le tronc est couvert de
jeunes pousses dans toute sa longueur. Il y a toujours
au-dessous de chaque petite crosse chargée de périthèces,
de jeunes bourgeons commençant à pousser sur lesquels
tombent et germent les spores du Didymosphaeria
. L ’émondage des Peupliers, en supprimant bon
nombre de pousses mortes et chargées de périthèces
de D idymosphaeria, est le seul remède à recommander;
il peut diminuer sensiblement le mal. Les jeunes branches
qui repoussent sont saines; il est vrai que si l’année
est humide, elles ne tardent pas beaucoup à être
infectées par les spores qui tombent du sommet de l’arbre
qui n’a pas été émondé; mais si la température est
favorable, l’émondage peut produire une amélioration
très marquée de l ’état de l’arbre.
Les traitements par les sels de cuivre sont absolument
impraticables sur des arbres comme les Peupliers.
La où le mal sévit avec intensité, on devra renoncer à
planter des Peupliers pyramidaux, et on les remplacera
avantageusement par d’autres espèces de Peuplier qui
souffrent beaucoup moins des attaques du Didymosphaeria.
Acanthostigma parasiticum (R. Hart.) Sacc.
Maladie des aiguilles du Sapin.
S y n . : T r i c h o s p h a e r i a p a r a s i t i c a R . H a r t .
Ce parasite attaque le plus ordinairement le Sapin.
Cependant il a été observé aussi sur l’ Epicéa. ^
C’est sur le Sapin qu’il a été signalé tout d’abord et
(I) Pri l i ieux, S u r la maladie du P eu p lie r py ramida l. Comp t e s rendus de
l’Acad. de Sc. C V I I I . 1889, p. u 33.
C H A M P I G N O N S P A R A S I T E S . 209
étudié parM. Rob. Hartig (i), qui l’a nommé Trichosphaeria
parasitica. M. Saccardo l’a rapporté au genre
Acanthostigma, à cause de ses spores qui sont allongées,
fusiformes et cloisonnées, tandis que dans les vrais
Trichosphaeria elles sont unicellulaires et ovoïdes.
Le mycélium du parasite d’abord blanc, puis d’un
jaune brunâtre, couvre la face inférieure , des rameaux
attaqués où il hiverne, et de là gagne les bourgeons et
les aiguilles qui en naissent, enveloppant à la fois dans
un réseau commun les aiguilles et les rameaux. Il tue
ces aiguilles qui brunissent; mais, mortes, elles ne se détachent
pas et restent fixées au rameau par le lacis des filaments
mycéliens qui les couvrent et les pénètrent.
D’après les observations de M. Hartig, les aiguilles
portées par le côté supérieur du rameau demeurent v ivantes,
au moins pendant la première année, le mycélium
du parasite restant limité au côté inférieur. Quand
les pousses nouvelles se développent, le mycélium de
VAcanthostigma les envahit et tue les jeunes aiguilles
en les déformant, s’il les attaque avant qu’elles aient
achevé leur complet développement.
A la face inférieure des aiguilles parvenues à leur
taille normale, le mycélium de VAcanthostigma forme,
au-dessous d’un lacis de filaments entre-croisés, une couche
épaisse de stroma dont la partie supérieure est formée
par un pseudo-parenchyme à éléments courts, tandis
qu’au-dessous, les hyphes s’allongent perpendiculairement
à la surface de l ’aiguille contre l ’épiderme de laquelle
elles vont buter par leur extrémité (fig. 3 17 et318).
Cette croûte adhérente à l ’aiguille sécrète une matière
qui remplit les dépressions en forme de cône qui se
(i) R. Hartig, Hedwigia, 1882. p. 12, et, L eh r b u c h d e r B a um k r a n k h .
2“ Éd. 1886, p. 7 1 .
M A LA D IE S D E S P L A N T E S . — T . I I . I 4
J
!..
(.A ri
< I f f
h \
f.- ti ^ jigiÄrii/ r -t J ! r