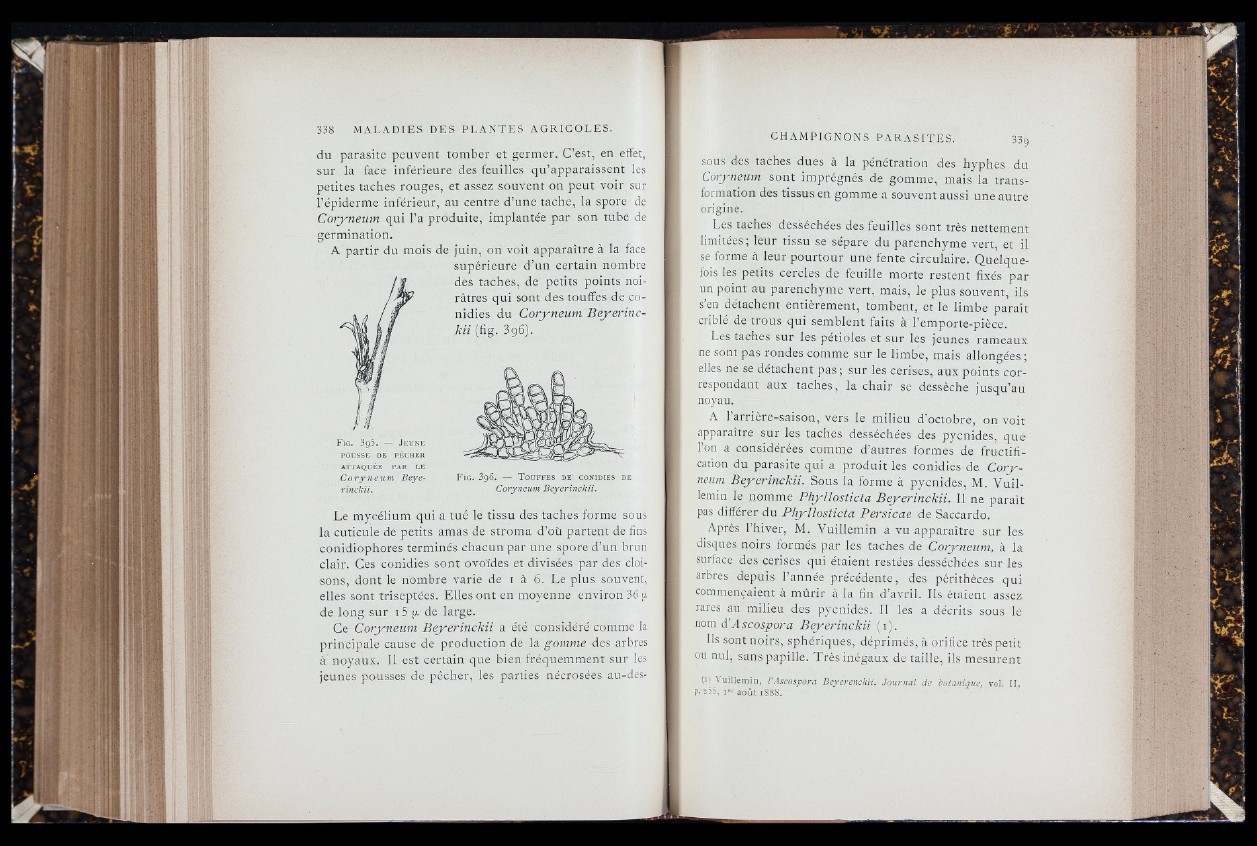
i.
m
du parasite peuvent tomber et germer. C’est, en effet,
sur la face inférieure des feuilles qu’apparaissent les
petites taches rouges, et assez souvent on peut voir sur
l’épiderme inférieur, au centre d’une tache, la spore de
Coryneum qui l’a produite, implantée par son tube de
germination.
A partir du mois de juin, on voit apparaître à la face
supérieure d’un certain nombre
des taches, de petits points noirâtres
qui sont des touffes de conidies
du Coryneum Beye rin ckii
(fig. 396).
F ig . 3 9 5 . — J e u n e
POUSSE DE PÊCHER
ATTAQUÉE PAR LE
C 0 r y n e u m B e y e r
in ck ii.
F ig . 3 9 6 . — T o u f f e s d e c o n id i e s d e
Coryneum B ey e rin ck ii.
Le mycélium qui a tué le tissu des taches forme sous
la cuticule de petits amas de stroma d’où partent de fins
conidiophores terminés chacun par une spore d’un brun
clair. Ces conidies sont ovoïdes et divisées par des cloisons,
dont le nombre varie de i à 6. Le plus souvent,
elles sont triseptées. Elles ont en moyenne environ 36 «
de long sur 1 5 u. de large.
Ce Coryneum Beye rin ck ii a été considéré comme la
principale cause de production de la gomme des arbres
à noyaux. 11 est certain que bien fréquemment sur les
jeunes pousses de pêcher, les parties nécrosées au-dessous
des taches dues à la pénétration des hyphes du
Coryneum sont imprégnés de gomme, mais la transformation
des tissus en gomme a souvent aussi une autre
origine.
Les taches desséchées des feuilles sont très nettement
limitées; leur tissu se sépare du parenchyme vert, et il
se forme à leur pourtour une fente circulaire. Quelquefois
les petits cercles de feuille morte restent fixés par
un point au parenchyme vert, mais, le plus souvent, ils
s’en détachent entièrement, tombent, et le limbe paraît
criblé de trous qui semblent faits à l’emporte-pièce.
Les taches sur les pétioles et sur les jeunes rameaux
ne sont pas rondes comme sur le limbe, mais allongées ;
elles ne se détachent pas; sur les cerises, aux points correspondant
aux taches, la chair se dessèche jusqu’au
noyau.
A l’arrière-saison, vers le milieu d’octobre, on voit
apparaître sur les taches desséchées des pycnides, que
l’on a considérées comme d’autres formes de fructification
du parasite qui a produit les conidies de Cory-
neum Beyerinckii. Sous la forme à pycnides, M. Vuillemin
le nomme Phyiiosticta Beyerinckii. Il ne paraît
pas différer du Phyiiosticta Persicae de Saccardo.
Après l’hiver, M. Vuillemin a vu apparaître sur les
disques noirs formés par les taches de Coryneum, à la
surface des cerises qui étaient restées desséchées sur les
arbres depuis l’année précédente, des périthèces qui
commençaient à mûrir à la fin d’avril. Ils étaient assez
rares au milieu des pycnides. Il les a décrits sous le
nom à'Ascospora B eyerin ckii (i).
Ils sont noirs, sphériques, déprimés, à orifice très petit
ou nul, sans papille. Très inégaux de taille, ils mesurent
(t) Vuillemin, ¡'Ascospora Bev c renckii. Jo u rn a l de botanique, vol II,
P-255, ICI’ août 1888.