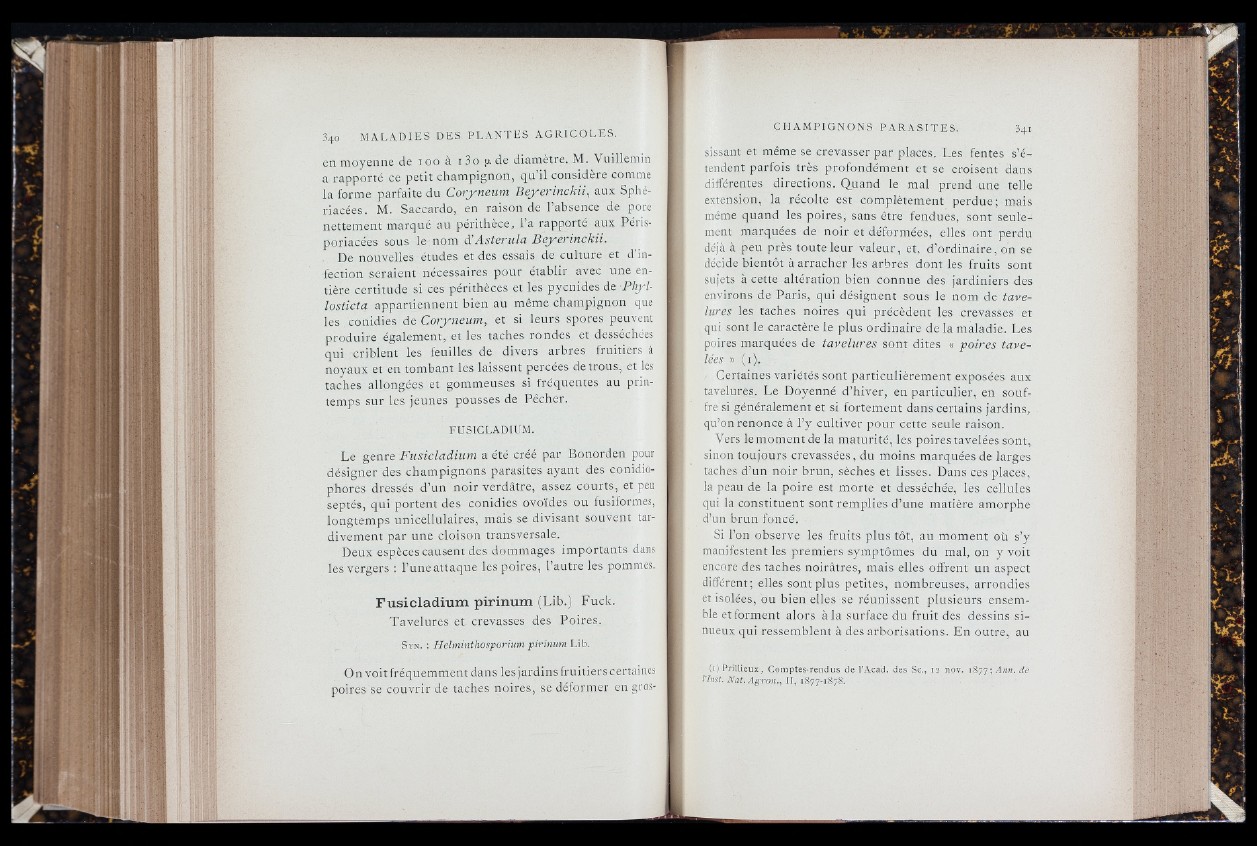
i î|/:
M t
i
■-i: 'I. UF;
ï :R
i
(If:
l'Î'l
3 4 0 M A L A D I E S D E S P L A N T E S A G R I C O L E S .
en moyenne de 10 0 à i 3o ¡j. de diamètre. M. Vuillemin
a rapporté ce petit champignon, qu’il considère comme
la forme parfaite du Coryneum Beyerinckii, aux Sphériacées.
M. Saccardo, en raison de l’absence de pore
nettement marqué au périthèce, l’a rapporté aux Périsporiacées
sous le nom déAsterula Beyerinckii.
De nouvelles études et des essais de culture et d'infection
seraient nécessaires pour établir avec une entière
certitude si ces périthèces et les pycnides de Phyllosticta
appartiennent bien au même champignon que
les conidies de Coryneum, et si leurs spores peuvent
produire également, et les taches rondes et desséchées
qui criblent les feuilles de divers arbres fruitiers à
noyaux et en tombant les laissent percées de trous, et les
taches allongées et gommeuses si fréquentes au printemps
sur les jeunes pousses de Pêcher.
F U S I C L A D I U M .
Le genre Fusicladium a été créé par Bonorden pour
désigner des champignons parasites ayant des conidiophores
dressés d’un noir verdâtre, assez courts, et peu
septés, qui portent des conidies ovoïdes ou fusiformes,
longtemps unicellulaires, mais se divisant souvent tardivement
par une cloison transversale.
Deux espèces causent des dommages importants dans
les vergers ; l’une attaque les poires, l’autre les pommes.
F u s ic lad ium pirinum (Lib.) Fuck.
Tavelures et crevasses des Poires.
S y n . : H e lm in t h o s p o r iu m p i r in u m L i b .
On voit fréquemment dans les jardins fruitiers certaines
poires se couvrir de taches noires, se déformer en gros-
C I I A M P I G N O N S P A R A S I T E S . 34.
sissant et même se crevasser par places. Les fentes s’étendent
parfois très profondément et se croisent dans
différentes directions. Quand le mal prend une telle
extension, la récolte est complètement perdue; mais
même quand les poires, sans être fendues, sont seulement
marquées de noir et déformées, elles ont perdu
déjà à peu près toute leur valeur, et, d’ordinaire, on se
décide bientôt à arracher les arbres dont les fruits sont
sujets à cette altération bien connue des jardiniers des
environs de Paris, qui désignent sous le nom de tavelures
les taches noires qui précèdent les crevasses et
qui sont le caractère le plus ordinaire de la maladie. Les
poires marquées de tavelures sont dites « poires tavelées
» (i).
Certaines variétés sont particulièrement exposées aux
tavelures. Le Doyenné d’hiver, en particulier, en souffre
si généralement et si fortement dans certains jardins,
qu’on renonce à l’y cultiver pour cette seule raison.
Vers le moment de la maturité, les poires tavelées sont,
sinon toujours crevassées, du moins marquées de larges
taches d’un noir brun, sèches et lisses. Dans ces places,
la peau de la poire est morte et desséchée, les cellules
qui la constituent sont remplies d’une matière amorphe
d’un brun foncé.
Si l’on observe les fruits plus tôt, au moment où s’y
manifestent les premiers symptômes du mal, on y voit
encore des taches noirâtres, mais elles offrent un aspect
différent; elles sont plus petites, nombreuses, arrondies
et isolées, ou bien elles se réunissent plusieurs ensemble
et forment alors à la surface du fruit des dessins sinueux
qui ressemblent à des arborisations. En outre, au
(i) Priliieux, Comptes-rendus de l’Acad. des Sc., 12 nov. \ Ann. de
l'hist. Nat. A g ro n ., II , 1877-1878.