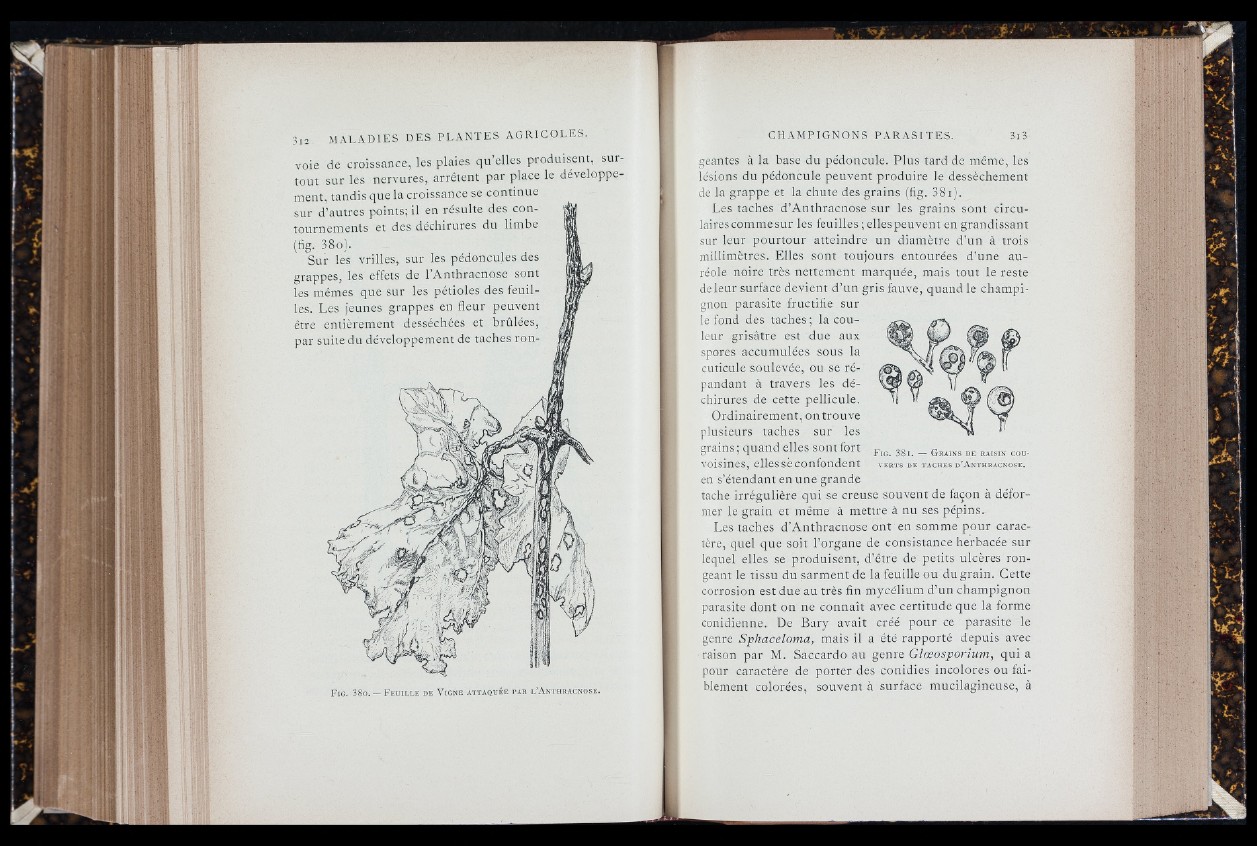
'i;
■t?
1F’
*rf
■‘' i;-» . l'î
J t
3,2 M A L A D I E S DE S P L A N T E S A G R I C O L E S .
voie de croissance, les plaies qu’elles produisent, surtout
sur les nervures, arrêtent par place le développement,
tandis que la croissance se continue
sur d’autres points; il en résulte des contournements
et des déchirures du limbe
(fig. 3 8 o).
Sur les vrilles, sur les pédoncules des
grappes, les effets de l ’Anthracnose sont
les mêmes que sur les pétioles des feuilles.
Les jeunes grappes en fleur peuvent
être entièrement desséchées et brûlées,
par suite du développement de taches ron-
CH AMP IG NO N S P A R A S I T E S .
F ig . 38o . — F e u i l l e d e V i g n e a t t a q u é e p a r l ’A n t h r a c n o s e .
géantes à la base du pédoncule. Plus tard de même, les
lésions du pédoncule peuvent produire le dessèchement
de la grappe et la chute des grains (fig. 3 8 i).
Les taches d’Anthracnose sur les grains sont circulaires
commesur les feuilles ; elles peuvent en grandissant
sur leur pourtour atteindre un diamètre d’un à trois
millimètres. Elles sont toujours entourées d’une auréole
noire très nettement marquée, mais tout le reste
de leur surface devient d’un gris fauve, quand le champignon
parasite fructifie sur
le fond des taches; la couleur
grisâtre est due aux
spores accumulées sous la
cuticule soulevée, ou se répandant
à travers les déchirures
de cette pellicule.
Ordinairement, on trouve
plusieurs taches sur les
grains ; quand elles sont fort
F i g . 3 8 i . — G r a i n s d e r a i s i n c o u v
voisines, ellessèconfondent
e r t s DE TACHES d ’ A ntHRACNOSE.
en s’étendant en une grande
tache irrégulière qui se creuse souvent de façon à déformer
le grain et même à mettre à nu ses pépins.
Les taches d’Anthracnose ont en somme pour caractère,
quel que soit l’organe de consistance herbacée sur
lequel elles se produisent, d’être de petits ulcères rongeant
le tissu du sarment de la feuille ou du grain. Cette
corrosion est due au très fin mycélium d’un champignon
parasite dont on ne connaît avec certitude que la forme
conidienne. De Bary avait créé pour ce parasite le
genre Sphaceloma, mais il a été rapporté depuis avec
raison par M. Saccardo au genre Gloeosporium, qui a
pour caractère de porter des conidies incolores ou faiblement
colorées, souvent à surface mucilagineuse, à