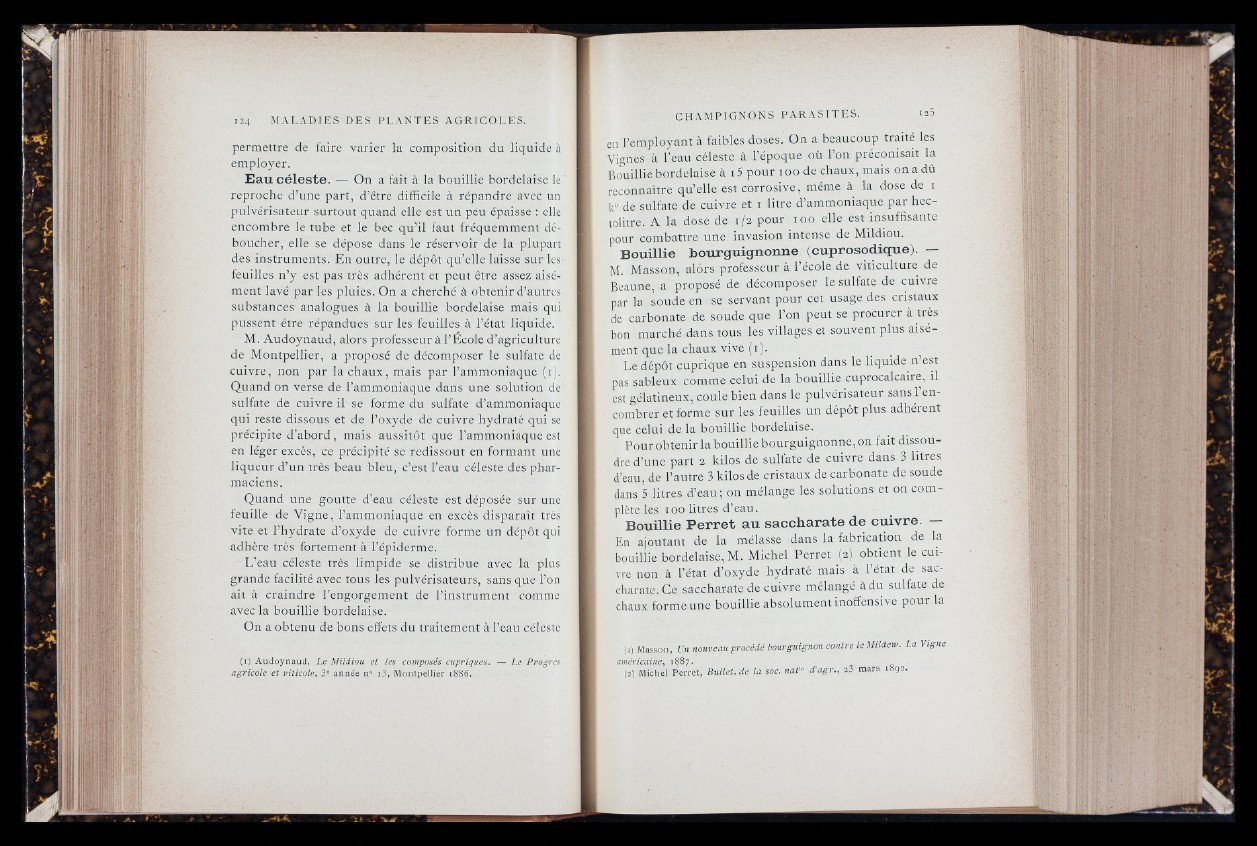
• 'I'.fi. A
ÎY
. y ; I | ;
, ' . , te, ’
■:
te'Éter •’
Ï
'( i"
li:'-; j*Y
Y !
permettre de faire varier la composition du liquide à
emjjloyer.
E a u c é le s t e . - - On a fait à la bouillie bordelaise le
reproche d’une part, d’être difficile à répandre avec un
pulvérisateur surtout quand elle est un peu épaisse : elle
encombre le tube et le bec qu’il faut fréquemment déboucher,
elle sc dépose dans le réservoir de la plupart
des instruments. En outre, le dépôt qu’elle laisse sur les
feuilles n’y est pas très adhérent et peut être assez aisément
lavé par les pluies. On a cherché à obtenir d’autres
substances analogues à la bouillie bordelaise mais qui
pussent être répandues sur les feuilles à l’état liquide.
M. Audoynaud, alors professeur à l’École d’agriculture
de Montpellier, a proposé de décomposer le sulfate de
cuivre, non par la chaux, mais par l’ammoniaque (i).
Quand on verse de l’ammoniaque dans une solution de
sulfate de cuivre il se forme du sulfate d’ammoniaque
qui reste dissous et de l’oxyde de cuivre hydraté qui se
précipite d’abord, mais aussitôt que l’ammoniaque est
en léger excès, ce précipité se redissout en formant une
liqueur d’un très beau bleu, c’est l’eau céleste des pharmaciens.
Quand une goutte d’eau céleste est déposée sur une
feuille de Vigne, l’ammoniaque en excès disparaît très
vite et l’hydrate d’oxyde de cuivre forme un dépôt qui
adhère très fortement à l’épiderme.
L'eau céleste très limpide se distribue avec la plus
grande facilité avec tous les pulvérisateurs, sans que l’on
ait à craindre l’engorgement de l’instrument comme
avec la bouillie bordelaise.
On a obtenu de bons effets du traitement à l’eau céleste
(i) Audoynaud, L e Mildiou et les composés cupriques. — L e Progrès
a g r ico le et viticole, 3» année n” i 3 , Montpellier 1886.
en l’employant à faibles doses. On a beaucoup traité les
Vignes à l’eau céleste à l’époque où l’on préconisait la
Bolillie bordelaise à 1 5 pour 100 de chaux, mais on a dû
reconnaître qu’elle est corrosive, même à la dose de i
k" de sulfate de cuivre et i litre d’ammoniaque par hectolitre.
A la dose de 1/2 pour 100 elle est insuffisante
pour combattre une invasion intense de Mildiou.
Bouillie bourguignonne (cuprosodique). —
M. Masson, alors professeur à l’école de viticulture de
Beaune, a proposé de décomposer le sulfate de cuivre
par la soude en se servant pour cet usage des cristaux
de carbonate de soude que l’on peut se procurer à très
bon marché dans tous les villages et souvent plus aisément
que la chaux vive (i).
Le dépôt cuprique en suspension dans le liquide n’est
pas sableux comme celui de la bouillie cuprocalcaiie, il
est gélatineux, coule bien dans le pulvérisateur sans 1 encombrer
et forme sur les feuilles un dépôt plus adhérent
que celui de la bouillie bordelaise.
Pour obtenir la bouillie bourguignonne, on fait dissoudre
d’une part 2 kilos de sulfate de cuivre dans 3 litres
d’eau, de l’autre 3 kilos de cristaux de carbonate de soude
dans 5 litres d’eau; on mélange les solutions et on complète
les 100 litres d’eau.
Bouillie P e r re t au saccharate de cuivre. —
En ajoutant de la mélasse dans la fabrication de la
bouillie bordelaise, M. Michel Perret (2) obtient le cuivre
non à l’état d’oxyde hydraté mais à l’état de saccharate.
Ce saccharate de cuivre mélangé à du sulfate de
chaux forme une b o u i l l i e absolument inoffensive pout la
(1) Masson, Un nouveau pro cédé bourguignon contre le Mildew. La Vigne
américaine, 1887.
(2) Michel Perret, Bullet, de la soc. «a/'® d’a g r ., 23 mars 1892-