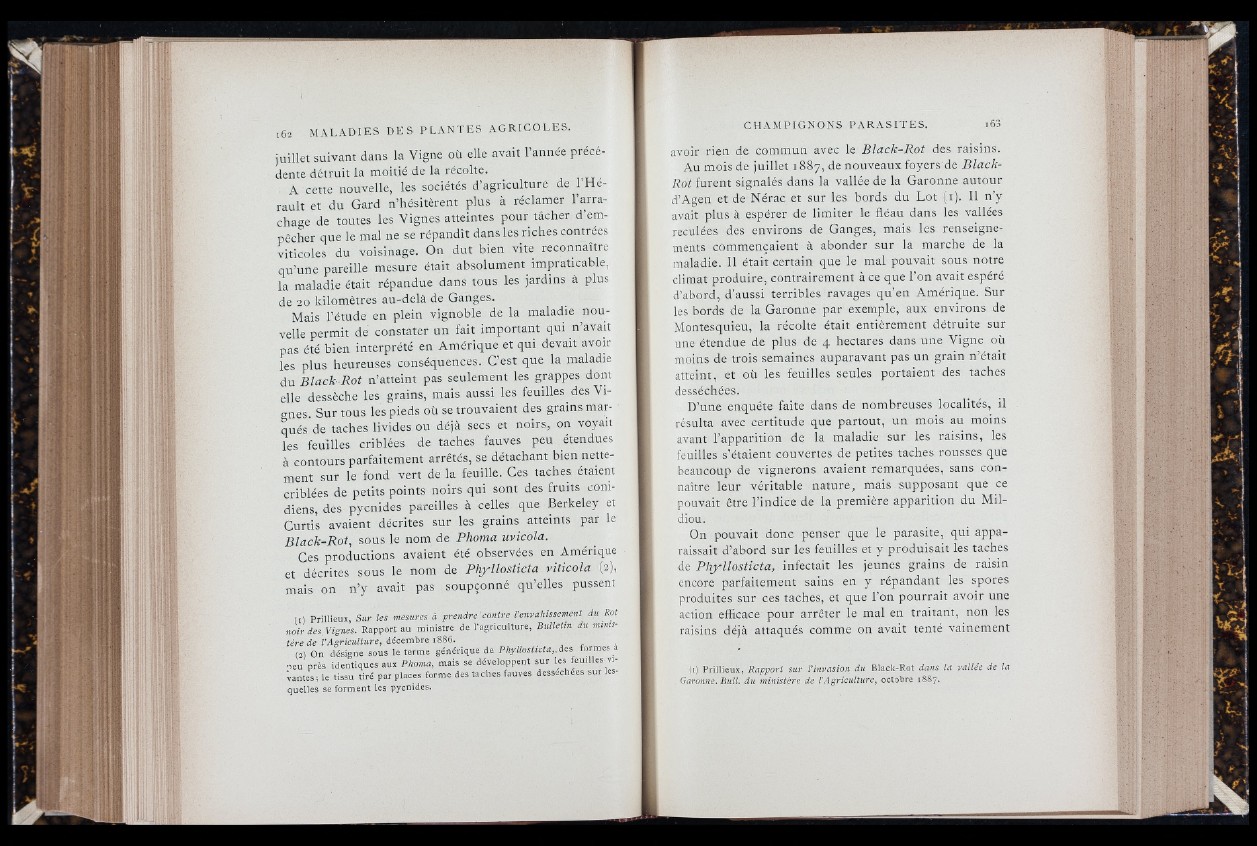
s ;
■ M i
1f
; -î
i l
î ' i
f I
■1 d
juillet suivant dans la Vigne où elle avait l’année précédente
détruit la moitié de la récolte.
A cette nouvelle, les sociétés d’agriculture de l'Hérault
et du Gard n’hésitèrent plus à réclamer l’arrachage
de toutes les Vignes atteintes pour tâcher d’empêcher
que le mal ne se répandît dans les riches contrées
viticoles du voisinage. On dut bien vite reconnaître
qu’une pareille mesure était absolument impraticable,
la maladie était répandue dans tous les jardins à plus
de 30 kilomètres au-delà de Ganges.
Mais l’étude en plein vignoble de la maladie nouvelle
permit de constater un fait important qui n avait
pas été bien interprété en Amérique et qui devait avoir
les plus heureuses conséquences. C’est que la maladie
du Black-Rot n’atteint pas seulement les grappes dont
elle dessèche les grains, mais aussi les feuilles des Vignes.
Sur tous les pieds où se trouvaient des grains marqués
de taches livides ou déjà secs et noirs, on voyait
les feuilles criblées de taches fauves peu étendues
à contours parfaitement arrêtés, se détachant bien nettement
sur le fond vert de la feuille. Ces taches étaient
criblées de petits points noirs qui sont des fruits conidiens,
des pycnides pareilles à celles que Berkeley et
Gurtis avaient décrites sur les grains atteints par le
Black-Rot, sous le nom de Phoma uvicola.
Ces productions avaient été observées en Amérique
et décrites sous le nom de Phyllosticta viticola (2),
mais on n’y avait pas soupçonné qu’elles pussent
(D Priliieux, S u r les mesures à p r en d re contre l’envahissement du Rot
no ir des Vignes. Rapport au ministre de l ’ agriculture, B u lle tin du ministè
re de l ’A g ricu ltu re , d é c em b re
(2) On désigne sous le terme générique de P h y llo s tic ta ,.d e s formes a
oeu près identiques aux Phoma, mais se développent sur k s feuilles vivantes;
le tissu tiré par places forme des taches fauves dessechees sui lesquelles
se forment les pycnides.
avoir rien de commun avec le Bla ck -R o t des raisins.
Au mois de juillet 1887, de nouveaux foyers de Black-
Rot furent signalés dans la vallée de la Garonne autour
d’Agen et de Nérac et sur les bords du Lot (i). 11 n’y
avait plus à espérer de limiter le fléau dans les vallées
reculées des environs de Ganges, mais les renseignements
commençaient à abonder sur la marche de la
maladie. Il était certain que le mal pouvait sous notre
climat produire, contrairement à ce que l’on avait espéré
d’abord, d’aussi terribles ravages qu’en Amérique. Sur
les bords de la Garonne par exemple, aux environs de
Montesquieu, la récolte était entièrement détruite sur
une étendue de plus de 4 hectares dans une Vigne où
moins de trois semaines auparavant pas un grain n’était
atteint, et où les feuilles seules portaient des taches
desséchées.
D’une enquête faite dans de nombreuses localités, il
résulta avec certitude que partout, un mois au moins
avant l’apparition de la maladie sur les raisins, les
feuilles s’étaient couvertes de petites taches rousses que
beaucoup de vignerons avaient remarquées, sans connaître
leur véritable nature, mais supposant que ce
pouvait être l ’indice de la première apparition du Mildiou.
On pouvait donc penser que le parasite, qui apparaissait
d’abord sur les feuilles et y produisait les taches
de Phyllosticta, infectait les jeunes grains de raisin
encore parfaitement sains en y répandant les spores
produites sur ces taches, et que l’on pourrait avoir une
action efficace pour arrêter le mal en traitant, non les
raisins déjà attaqués comme on avait tenté vainement
(i) Priliieux, Rapport sur l’invasion du Black-Rot dans la va llée de la
Garonne. Bull, du ministère de VAgriculture, octobre 1887.