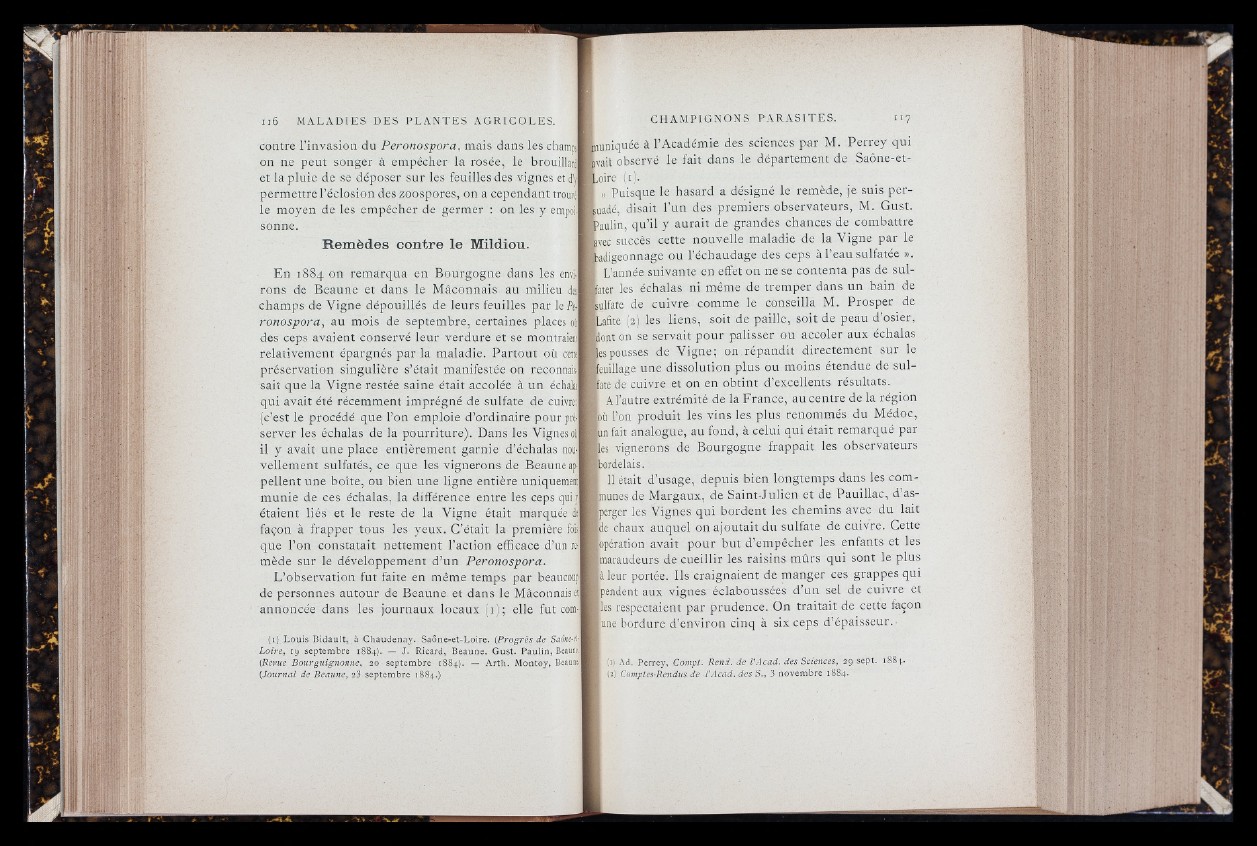
contre l’invasion du Peronospora, mais dans leschamps
on ne peut songer à empêcher la rosée, le brouillarj
et la pluie de se déposer sur les feuilles des vignes etdî
permettre l’éclosion des zoospores, on a cependant trouvi
le moyen de les empêcher de germer : on les y empoisonne.
Remèdes contre le Mildiou.
En 1884 011 remarqua en Bourgogne dans les envi
rons de Beaune et dans le Mâconnais au milieu dts
champs de Vigne dépouillés de leurs feuilles par le Pt-
ronospora, au mois de septembre, certaines places
des ceps avaient conservé leur verdure et se montraieni
relativement épargnés par la maladie. Partout où cette
préservation singulière s’était manifestée on reconnaissait
que la Vigne restée saine était accolée à un échalat
qui avait été récemment imprégné de sulfate de cuivre:
(c’est le procédé que l’on emploie d’ordinaire pour préserver
les échalas de la pourriture). Dans les Vignes oil
il y avait une place entièrement garnie d’échalas nouvellement
sulfatés, ce que les vignerons de Beaune appellent
une boîte, ou bien une ligne entière uniquemeni
munie de ces échalas, la différence entre les ceps qui t
étaient liés et le reste de la Vigne était marquée dt
façon à frapper tous les yeux. C’était la première foi:
que l ’on constatait nettement l’action efficace d’un remède
sur le développement d’un Peronospora.
L ’observation fut faite en même temps par beaucoup
de personnes autour de Beaune et dans le Mâconnais et
annoncée dans les journaux locaux n ) ; elle fut com-
( 0 Louis Bidault, à Chaudenay. Saône-et-Loir e. {P ro g rè s de Saône-tt-
L o ir e , 19 septembre 1884). — J . Ricard, Beaune. Gust. Paulin, Beaune.
[Repue B ourguignonne , 20 septembre 1884). — Arth. Montoy, Beaune,
[Jo u rn a l de Beaune, 23 septembre 1884.)
muniquée à l’Académie des sciences par M. Perrey qui
rait observé le fait dans le département de Saône-et-
Loire (i).
„ Puisque le hasard a désigné le remède, je suis persuadé,
disait l ’un des premiers observateurs, M . Cust.
Paulin, qu’il y aurait de grandes chances de combattre
avec succès cette nouvelle maladie de la Vigne par le
-'ibadigeonnage ou l’échaudage des ceps à l’eau sulfatée ».
■ L’année suivante en effet on ne se contenta pas de sulfater
les échalas ni même de tremper dans un bain de
sulfate de cuivre comme le conseilla M. Prosper de
Lafite ,,>) les liens, soit de paille, soit de peau d’osier,
dont on se servait pour palisser ou accoler aux échalas
les pousses de Vigne; on répandit directement sur le
feuillage une dissolution plus ou moins étendue de sulfate
de cuivre et on en obtint d’excellents résultats,
ta Al’autre extrémité de la France, aucentre de la région
|où l’on produit les vins les plus renommés du Médoc,
un fait analogue, au fond, à celui qui était remarqué par
les vignerons de Bourgogne frappait les observateurs
(bordelais.
Il était d’usage, depuis bien longtemps dans les com-
I munes de Margaux, de Saint-Julien et de Pauillac, d’asperger
les Vignes qui bordent les chemins avec du lait
chaux auquel on ajoutait du sulfate de cuivre. Cette
opération avait pour but d’empêcher les enfants et les
maraudeurs de cueillir les raisins mûrs qui sont le plus
à leur portée. Ils craignaient de manger ces grappes qui
pendent aux vignes éclaboussées d’un sel de cuivre et
les respectaient par prudence. On traitait de cette façon
une bordure d’environ cinq à six ceps d’ épaisseur.
(1) Ad. Perrey, Compt. Rend, de VAcad. des Sciences, 29 sept. 18
(2) Comptes-Rendus de l ’A cad. des S ., 3 novembre 18S4.
:SJS
fi
u*
■i'- A■■ m V- ! :;
'P'S.-‘ 1-- .Y■ I