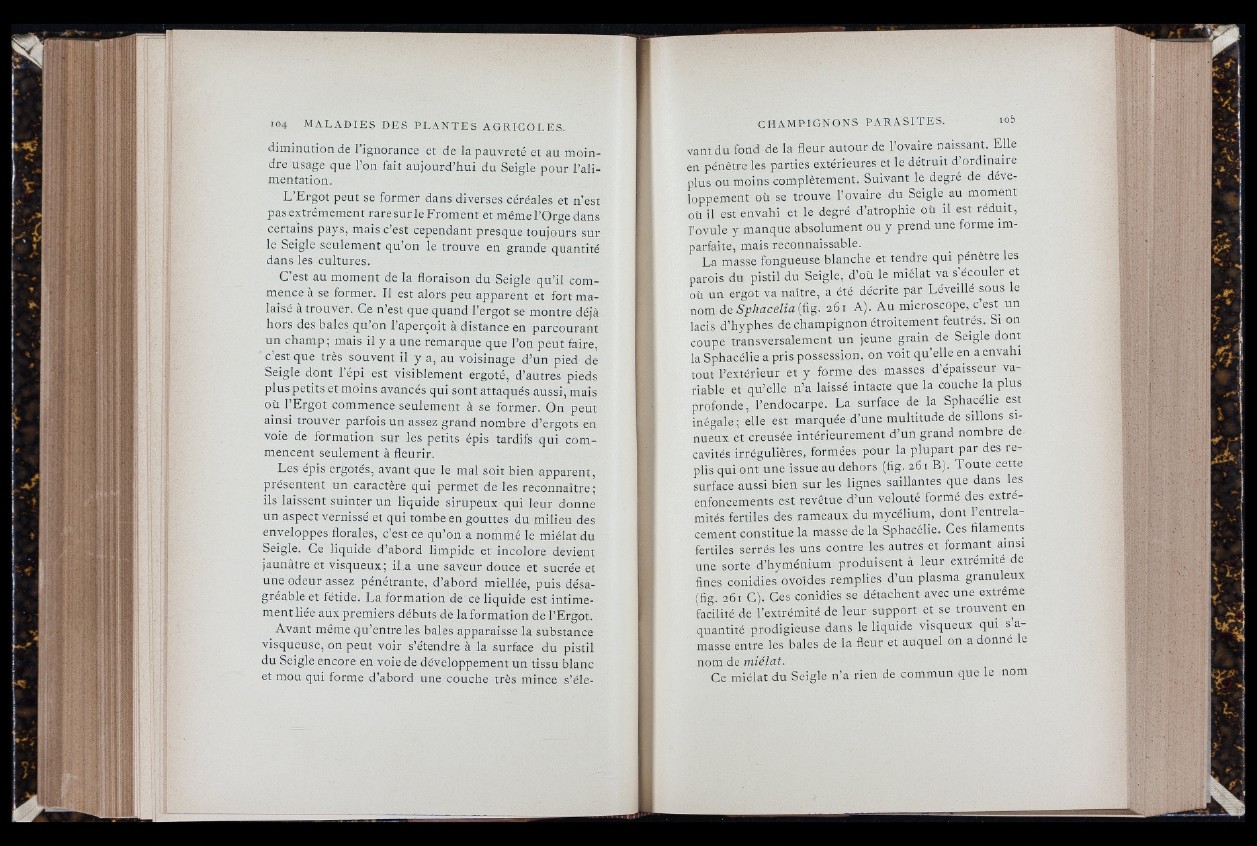
diminution de l’ignorance et de la pauvreté et au moindre
usage que l’on fait aujourd’hui du Seigle pour l’alimentation.
L ’Ergot peut se former dans diverses céréales et n’est
pas extrêmement rare surle Froment et même l’Orge dans
certains pays, mais c’est cependant presque toujours sur
le Seigle seulement qu’on le trouve en grande quantité
dans les cultures.
C’est au moment de la floraison du Seigle qu’il commence
à se former. Il est alors peu apparent et fort malaisé
à trouver. Ce n’est que quand l ’ergot se montre déjà
hors des baies qu’on l’aperçoit à distance en parcourant
un champ; mais il y a une remarque que l’on peut faire,
c’est que très souvent il y a, au voisinage d’un pied de
Seigle dont l’épi est visiblement ergoté, d’autres pieds
plus petits et moins avancés qui sont attaqués aussi, mais
où l ’Ergot commence seulement à se former. On peut
ainsi trouver parfois un assez grand nombre d’ergots en
voie de formation sur les petits épis tardifs qui commencent
seulement à fleurir.
Les épis ergotés, avant que le mal soit bien apparent,
présentent un caractère qui permet de les reconnaître;
ils laissent suinter un liquide sirupeux qui leur donne
un aspect vernissé et qui tombe en gouttes du milieu des
enveloppes florales, c’est ce qu’on a nommé le miélat du
Seigle. Ce liquide d’abord limpide et incolore devient
jaunâtre et visqueux; il a une saveur douce et sucrée et
une odeur assez pénétrante, d’abord miellée, puis désagréable
et fétide. La formation de ce liquide est intimement
liée aux premiers débuts de la formation de l’Ergot.
Avant même qu’entre les baies apparaisse la substance
visqueuse, on peut voir s’étendre à la surface du pistil
du Seigle encore en voie de développement un tissu blanc
et mou qui forme d’abord une couche très mince s’élevant
du fond de la fleur autour de l’ovaire naissant. Elle
en pénètre les parties extérieures et le détruit d’ordinaire
plus ou moins complètement. Suivant le degré de développement
où se trouve l’ovaire du Seigle au moment
où il est envahi et le degré d’atrophie où il est réduit,
l’ovule y manque absolument ou y prend une forme imparfaite,
mais reconnaissable.
La masse fongueuse blanche et tendre qui pénètre les
parois du pistil du Seigle, d’où le miélat va s’écouler et
où un ergot va naître, a été décrite par Léveillé sous le
nom àe Sphacelia [üg. 261 A). Au microscope, c’est^ un
lacis d’hyphes de champignon étroitement feutrés. Si on
coupe transversalement un jeune grain de Seigle dont
la Sphacélie a pris possession, on voit qu’elle en a envahi
tout l’extérieur et y forme des masses d’épaisseur variable
et qu’elle n’a laissé intacte que la couche la plus
profonde, l’endocarpe. La surface de la Sphacélie est
inégale : elle est marquée d’une multitude de sillons sinueux
et creusée intérieurement d’un grand nombre de
cavités irrégulières, formées pour la plupart par des replis
qui ont une issue au dehors (fig. 261 B). Toute cette
surface aussi bien sur les lignes saillantes que dans les
enfoncements est revêtue d’un velouté formé des extrémités
fertiles des rameaux du mycélium, dont l’entrelacement
constitue la masse de la Sphacélie. Ces filaments
fertiles serrés les uns contre les autres et formant ainsi
une sorte d’hyménium produisent à leur extrémité de
fines conidies ovoïdes remplies d’un plasma granuleux
(fig. 261 C). Ces conidies se détachent avec une extrême
facilité de l’extrémité de leur support et se trouvent en
quantité prodigieuse dans le liquide visqueux qui s a-
masse entre les baies de la fleur et auquel on a donné le
nom de miélat.
Ce miélat du Seigle n’a rien de commun que le nom
* *
ai