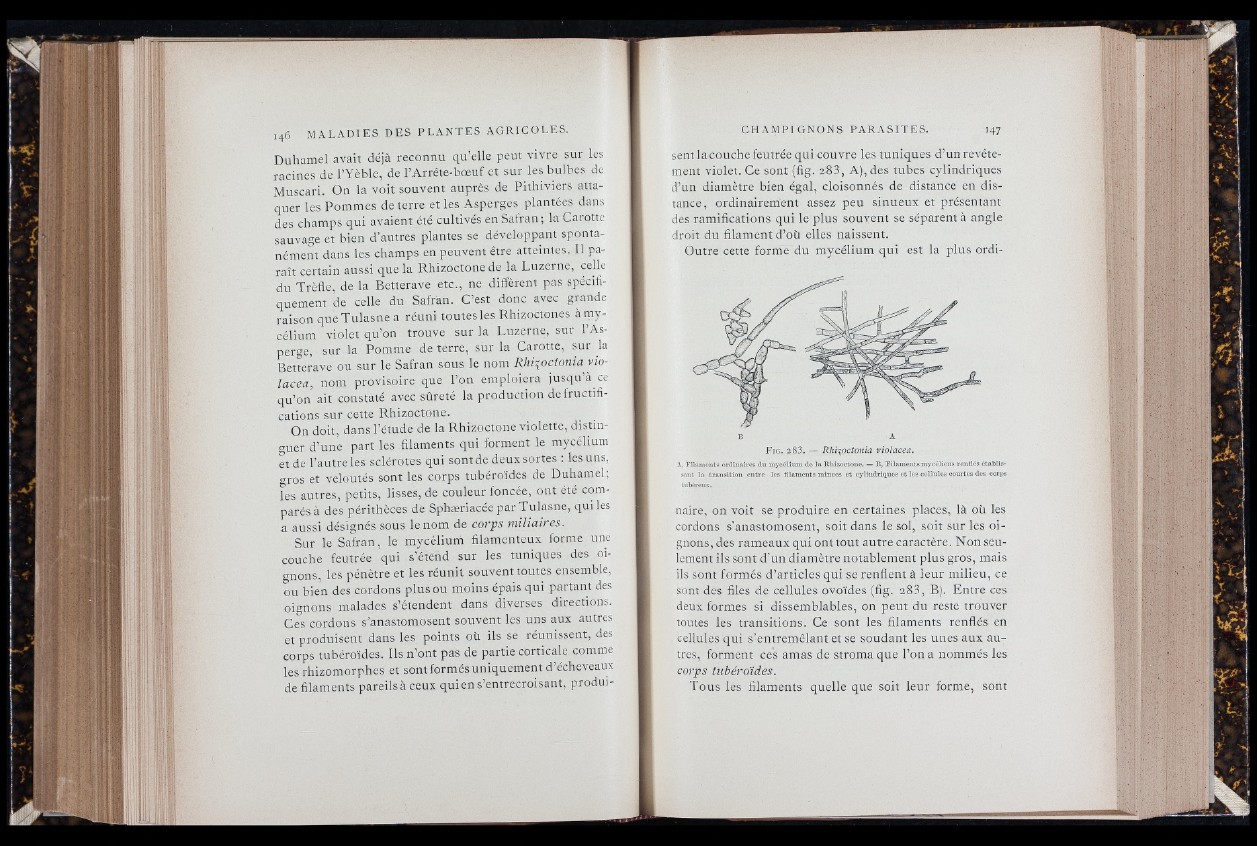
A ik I
Duhamel avait déjà reconnu qu’elle peut vivre sur les
racines de l’Yèble, de l’Arrête-boeuf et sur les bulbes de
Muscari. On la voit souvent auprès de Pithiviers attaquer
les Pommes de terre et les Asperges plantées dans
des champs qui avaient été cultivés en Safran; la Carotte
sauvage et bien d’autres plantes se développant spontanément
dans les champs en peuvent être atteintes. Il paraît
certain aussi que la Rhizoctone de la Luzerne, celle
du Trèfle, de la Betterave etc., ne diffèrent pas spécifiquement
de celle du Safran. C ’est donc avec grande
raison que Tulasne a réuni toutes les Rhizoctones à mycélium
violet qu’on trouve sur la Luzerne, snr l’Asperge,
sur la Pomme de terre, sur la Carotte, sur la
Betterave ou sur le Safran sous le nom Rhffocionia violacea,
nom provisoire que l’on emploiera jusqu à ce
qu’on ait constaté avec sûreté la production de fructifications
sur cette Rhizoctone.
On doit, dans l’étude de la Rhizoctone violette, distinguer
d’une part les filaments qui forment le mycélium
et de l’autre les sclérotes qui sont de deux sortes ; les uns,
gros et veloutés sont les corps tubéroïdes de Duhamel;
les autres, petits, lisses, de couleur foncée, ont été comparés
à des périthèces de Sphæriacée par Tulasne, qui les
a aussi désignés sous le nom de corps miliaires.
Sur le Safran, le mycélium filamenteux forme une
couche feutrée qui s’étend sur les tuniques des oignons,
les pénètre et les réunit souvent toutes ensemble,
ou bien des cordons pinson moins épais qui partant des
oignons malades s’étendent dans diverses directions.
Ces cordons s’anastomosent souvent les uns aux autres
et produisent dans les points où ils se réunissent, des
corps tubéroïdes. Ils n’ont pas de partie corticale comme
les rhizomorphes et sont formés uniquement d’écheveaux
de filaments pareilsàceux qui en s’entrecroisant, produisent
la couche feutrée qui couvre les tuniques d’un revêtement
violet. Ce sont (fig. 283, A), des tubes cylindriques
d’un diamètre bien égal, cloisonnés de distance en distance,
ordinairement assez peu sinueux et présentant
des ramifications qui le plus souvent se séparent à angle
droit du filament d’où elles naissent.
Outre cette forme du mycélium qui est la plus ordi-
A, Filaments ordinaires dn mycélimn de la Rhizoctone. — B, Filaments mycéliens renflés établissant
la transition entre les filaments minces ct cylindriques ct les cellitles courtes des corps
tubéreux.
naire, on voit se produire en certaines places, là où les
cordons s’anastomosent, soit dans le sol, soit sur les oignons,
des rameaux qui ont tout autre caractère. Non seulement
ils sont d’un diamètre notablement plus gros, mais
ils sont formés d’articles qui se renflent à leur milieu, ce
sont des files de cellules ovoïdes (fig. 283, B). Entre ces
deux formes si dissemblables, 011 peut du reste trouver
toutes les transitions. Ce sont les filaments renflés en
cellules qui s’entremêlant et se soudant les unes aux autres,
forment ces amas de stroma que l’on a nommés les
corps tubéroïdes.
Tous les filaments quelle que soit leur forme, sont