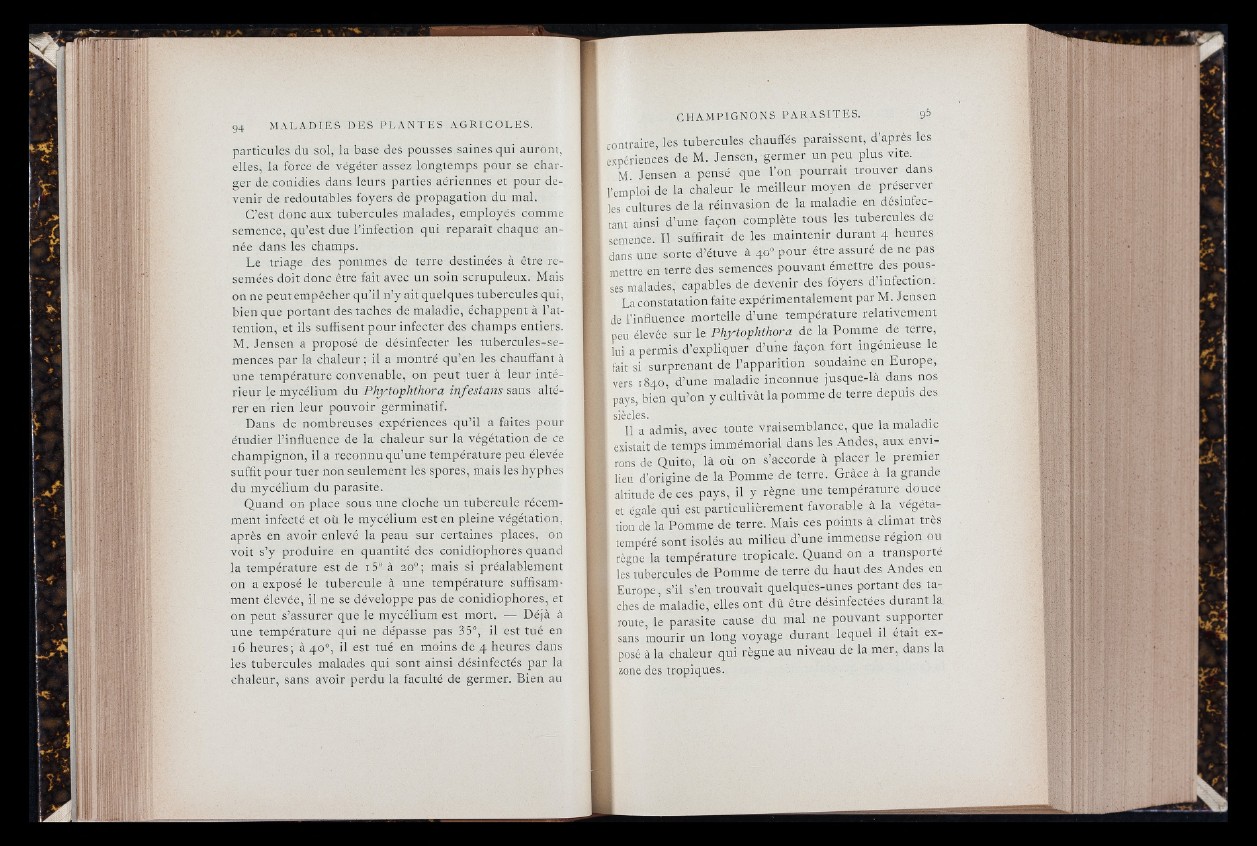
Y . 4;,
particules du sol, la base des pousses saines qui auront,
elles, la force de végéter assez longtemps pour se charger
de conidies dans leurs parties aériennes et pour devenir
de redoutables foyers de propagation du mal.
C’est donc aux tubercules malades, employés comme
semence, qu’est due l’infection qui reparaît chaque année
dans les champs.
Le triage des pommes de terre destinées à être resemées
doit donc être fait avec un soin scrupuleux. Mais
on ne peut empêcher qu’il n’y ait quelques tubercules qui,
bien que portant des taches de maladie, échappent à l’attention,
et ils suffisent pour infecter des champs entiers.
M. Jensen a proposé de désinfecter les tubercules-se-
mences par la chaleur ; il a montré qu’en les chauffant à
une température convenable, on peut tuer à leur intérieur
le mycélium du Phytophthora infestans sans altérer
en rien leur pouvoir germinatif.
Dans de nombreuses expériences qu’il a faites pour
étudier l’influence de la chaleur sur la végétation de ce
champignon, il a reconnu qu’une température peu élevée
suffit pour tuer non seulement les spores, mais les hyphes
du mycélium du parasite.
Quand on place sous une cloche un tubercule récemment
infecté et où le mycélium est en pleine végétation,
après en avoir enlevé la peau sur certaines places, on
voit s’y produire en quantité des conidiophores quand
la température est de i 5° à 20“ ; mais si préalablement
on a exposé le tubercule à une température suffisamment
élevée, il ne se développe pas de conidiophores, et
on peut s’assurer que le mycélium est mort. — Déjà à
une température qui ne dépasse pas 35“, il est tué en
16 heures; à 40 “, il est tué en moins de 4 heures dans
les tubercules malades qui sont ainsi désinfectés par la
chaleur, sans avoir perdu la faculté de germer. Bien au
contraire, les tubercules chauffés paraissent, d’après les
expériences de M. Jensen, germer un peu plus vite.
M. Jensen a pensé que l’on pourrait trouver dans
l’emploi de la chaleur le meilleur moyen de préserver
les cultures de la réinvasion de la maladie en désinfectant
ainsi d’une façon complète tous les tubercules de
semence. Il suffirait de les maintenir durant 4 heures
dans une sorte d’étuve à 40" pour être assuré de ne pas
mettre en terre des semences pouvant émettre des pousses
malades, capables de devenir des foyers d’infection.
La constatation faite expérimentalement par M. Jensen
de l’influence mortelle d’une température relativement
peu élevée sur le Phytophthora de la Ponime^ de terre,
lui a permis d’expliquer d’une façon fort ingénieuse le
fait si surprenant de l’apparition soudaine en Europe,
vers 1840, d’une maladie inconnue jusque-là dans nos
pays, bien qu’on y cultivât la pomme de terre depuis des
siècles.
Il a admis, avec toute vraisemblance, que la maladm
existait de temps immémorial dans les Andes, aux environs
de Quito, là où on s’accorde à placer le premier
lieu d’origine de la Pomme de terre. Grâce à la grande
altitude de ces pays, il y règne une température douce
et égale qui est particulièrement favorable à la vegetation
de la Pomme de terre. Mais ces points à climat très
tempéré sont isolés au milieu d’une immense région ou
règne la température tropicale. Quand on a transporte
les tubercules de Pomme de terre du haut des Andes en
Europe, s’il s’en trouvait quelques-unes portant des taches
de maladie, elles ont dû être désinfectées durant la
route, le parasite cause du mal ne pouvant supporter
sans mourir un long voyage durant lequel il était exposé
à la chaleur qui règne au niveau de la mer, dans la
zone des tropiques.
te
r
■ < '
■; • J •
:
L
■
' I l