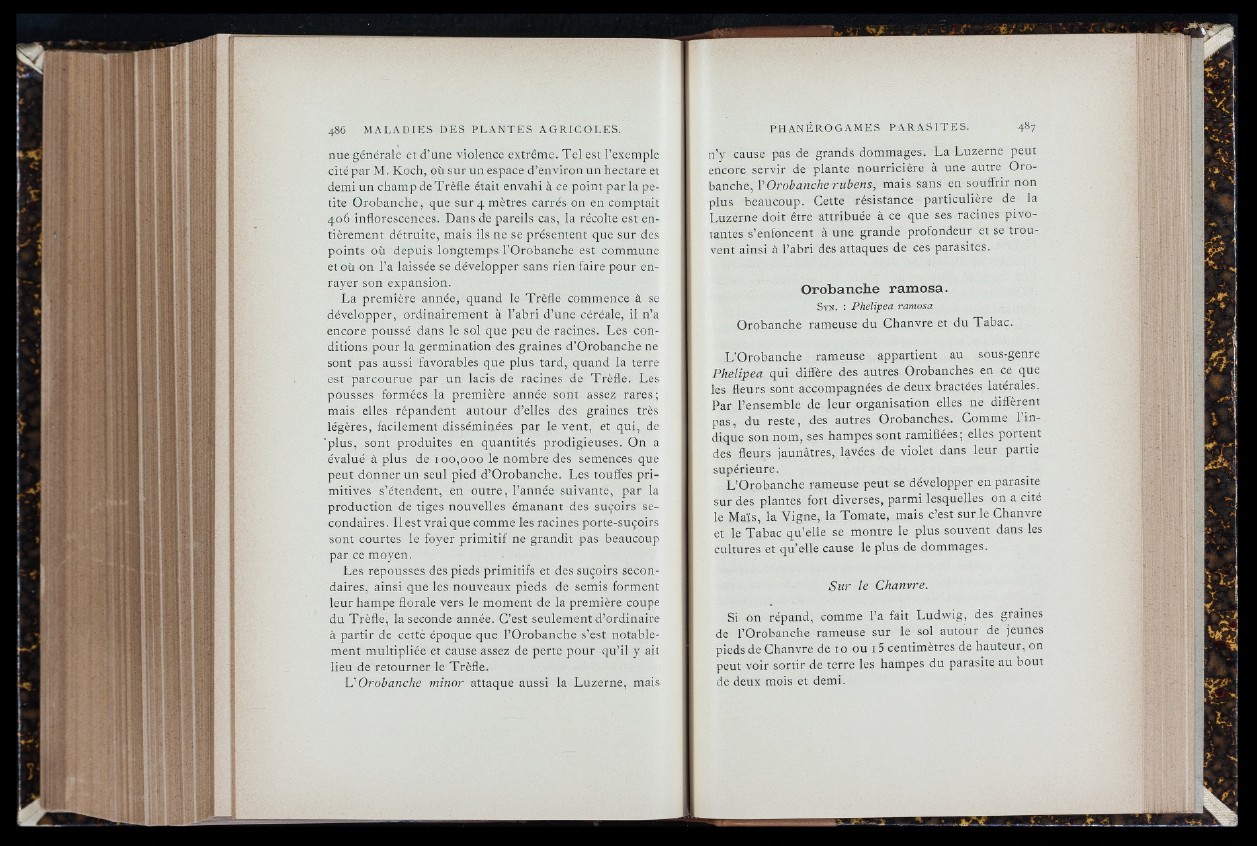
485 M A L A D I E S D E S P L A N T E S A G R I C O L E S .
nue générale et d’ une violence extrême. T e l est l ’exemple
cité par M. Koch, où sur un espace d’environ un hectare et
demi un champ de Trèfle était envahi à ce point par la petite
Orobanche, que sur 4 mètres carrés on en comptait
406 inflorescences. Dans de pareils cas, la récolte est entièrement
détruite, mais ils ne se présentent que sur des
points où depuis longtemps l ’Orobanche est commune
et où 011 l ’a laissée se développer sans rien faire pour enrayer
son expansion.
L a première année, quand le Trèfle commence à se
développer, ordinairement à l ’abri d’une céréale, il n’a
encore poussé dans le sol que peu de racines. Le s conditions
pour la germination des graines d’Orobanche ne
sont pas aussi favorables que plus tard, quand la terre
est parcourue par un lacis de racines de Trè fle . Les
pousses formées la première année sont assez rares;
mais elles répandent autour d’elles des graines très
légères, facilement disséminées par le vent, et qui, de
■plus, sont produites en quantités prodigieuses. On a
évalué à plus de 10 0 ,0 0 0 le nombre des semences que
peut donner un seul pied d’Orobanche. Les touffes primitives
s’étendent, en outre, l’année suivante, par la
production de tiges nouvelles émanant des suçoirs secondaires.
Il est vrai que comme les racines porte-suçoirs
sont courtes le foyer p rim itif ne grandit pas beaucoup
par ce moyen.
Les repousses des pieds primitifs et des suçoirs secondaires,
ainsi que les nouveaux pieds de semis forment
leur hampe florale vers le moment de la première coupe
du Trèfle, la seconde année. C’est seulement d’ordinaire
à partir de cette époque que l ’Orobanche s’est notablement
multipliée et cause assez de perte pour qu’il y ait
lieu de retourner le Trèfle.
VOrobanche minor attaque aussi la Luzerne, mais
P H A N É R O G A M E S P A R A S I T E S . 4 8 7
n’y cause pas de grands dommages. L a Luzerne peut
encore servir de plante nourricière à une autre Orobanche,
V Orobanche rubens, mais sans en souffrir non
plus beaucoup. Cette résistance particulière de la
Luzerne doit être attribuée à ce que ses racines p ivo tantes
s’ enfoncent à une grande profondeur et se trouvent
ainsi à l’abri des attaques de ces parasites.
Orobanche ramosa.
S y n . : P h e lip e a ramosa
Orobanche rameuse du Chanvre et du Tabac.
L ’Orobanche rameuse appartient au sous-genre
Phelipea qui diffère des autres Orobanches en ce que
les fieurs sont accompagnées de deux bractées latérales.
Par l ’ensemble de leur organisation elles ne diffèrent
pas, du reste, des autres Orobanches. Comme l’indique
son nom, ses hampes sont ramifiées; elles portent
des fieurs jaunâtres, lavées de violet dans leur partie
supérieure.
L ’Orobanche rameuse peut se développer en parasite
sur des plantes fort diverses, parmi lesquelles on a cité
le Maïs, la 'Vigne, la Tomate, mais c’est sur le Chanvre
et le Tabac qu’elle se montre le plus souvent dans les
cultures et qu’elle cause le plus de dommages.
S u r le Chanvre.
Si on répand, comme l’a fait Lu dw ig , des graines
de l’Orobanche rameuse sur le sol autour de jeunes
pieds de Chanvre de 10 ou 1 5 centimètres de hauteur, on
peut voir sortir de terre les hampes du parasite au bout
de deux mois et demi.