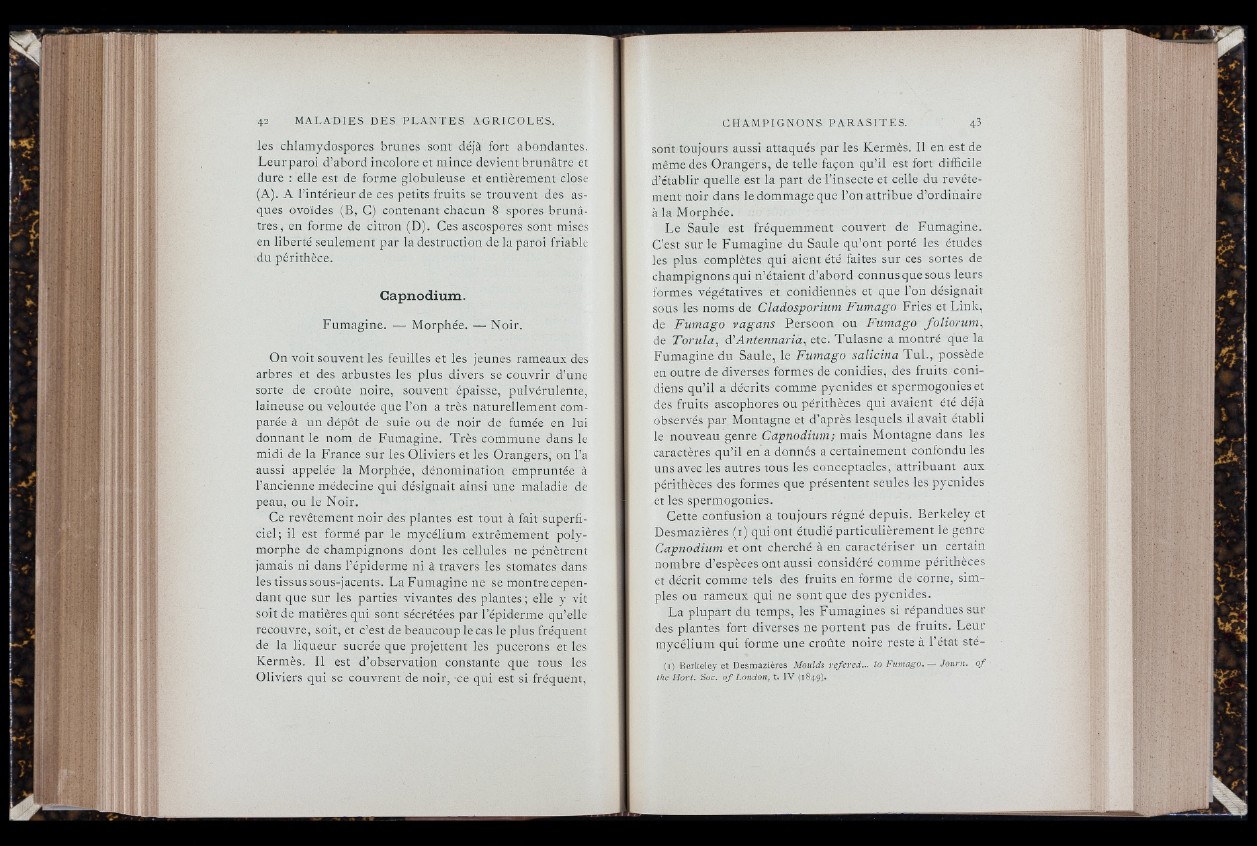
les chiamydospores brunes sont déjà fort abondantes.
Leurparoi d'abord incolore et mince devient brunâtre et
dure ; elle est de forme globuleuse et entièrement close
(A). A l’intérieur de ces petits fruits se trouvent des asques
ovoïdes (B, C) contenant chacun 8 spores brunâtres,
en forme de citron (D). Ces ascospores sont mises
en liberté seulement par la destruction de la paroi friable
du périthèce.
Capnodium.
Fumagine. — Morphée. — Noir.
On voit souvent les feuilles et les jeunes rameaux des
arbres et des arbustes les plus divers se couvrir d’une
sorte de croûte noire, souvent épaisse, pulvérulente,
laineuse ou veloutée que l’on a très naturellement comparée
à un dépôt de suie ou de noir de fumée en lui
donnant le nom de Fumagine. Très commune dans le
midi de la France sur les Oliviers et les Orangers, on l’a
aussi appelée la Morphée, dénomination empruntée à
l’ancienne médecine qui désignait ainsi une maladie de
peau, ou le Noir.
Ce revêtement noir des plantes est tout à fait superficiel;
il est formé par le mycélium extrêmement polymorphe
de champignons dont les cellules ne pénètrent
jamais ni dans l’épiderme ni à travers les stomates dans
les tissus sous-jacents. La Fumagine ne se montrecepen-
dant que sur les parties vivantes des plantes ; elle y vit
soit de matières qui sont sécrétées par l ’épiderme qu’elle
recouvre, soit, et c’est de beaucoup le cas le plus fréquent
de la liqueur sucrée que projettent les pucerons et les
Kermès. Il est d’observation constante que tous les
Oliviers qui se couvrent de noir, ce qui est si fréquent,
sont toujours aussi attaqués par les Kermès. Il en est de
même des Orangers, de telle façon qu’il est fort difficile
d’établir quelle est la part de l’insecte et celle du revêtement
noir dans le dommage que l’on attribue d’ordinaire
à la Morphée.
Le Saule est fréquemment couvert de Fumagine.
C’est sur le Fumagine du Saule qu’ont porté les études
les plus complètes qui aient été faites sur ces sortes de
champignons qui n’étaient d’abord connus que sous leurs
formes végétatives et conidiennes et que l’on désignait
sous les noms de Cladosporium Fumago Fries et Link,
de Fumago vagans Persoon ou Fumago foliorum,
de Torula, à'Antennaria, etc. Tulasne a montré que la
Fumagine du Saule, le Fumago sa lic in a F u i., possède
en outre de diverses formes de conidies, des fruits conidiens
qu’il a décrits comme pycnides et spermogonies et
des fruits ascophores ou périthèces qui avaient été déjà
observés par Montagne et d’après lesquels il avait établi
le nouveau genre Capnodium ; mais Montagne dans les
caractères qu’il en a donnés a certainement confondu les
uns avec les autres tous les conceptacles, attribuant aux
périthèces des formes que présentent seules les pycnides
et les spermogonies.
Cette confusion a toujours régné depuis. Berkeley et
Desmazières (i) qui ont étudié particulièrement le genre
Capnodium et ont cherché à en caractériser un certain
nombre d’espèces ont aussi considéré comme périthèces
et décrit comme tels des fruits en forme de corne, simples
ou rameux qui ne sont que des pycnides.
La plupart du temps, les Fumagines si répandues suides
plantes fort diverses ne portent pas de fruits. Leur
mycélium qui forme une croûte noire reste à l’état sté-
(i) Berkeley et Desmazières Moidds r e fe r ed ... to Fum a go . — Jo u n i. o f
îhe HorL. Suc. o f London, X. IV {1849).
i l ®
te