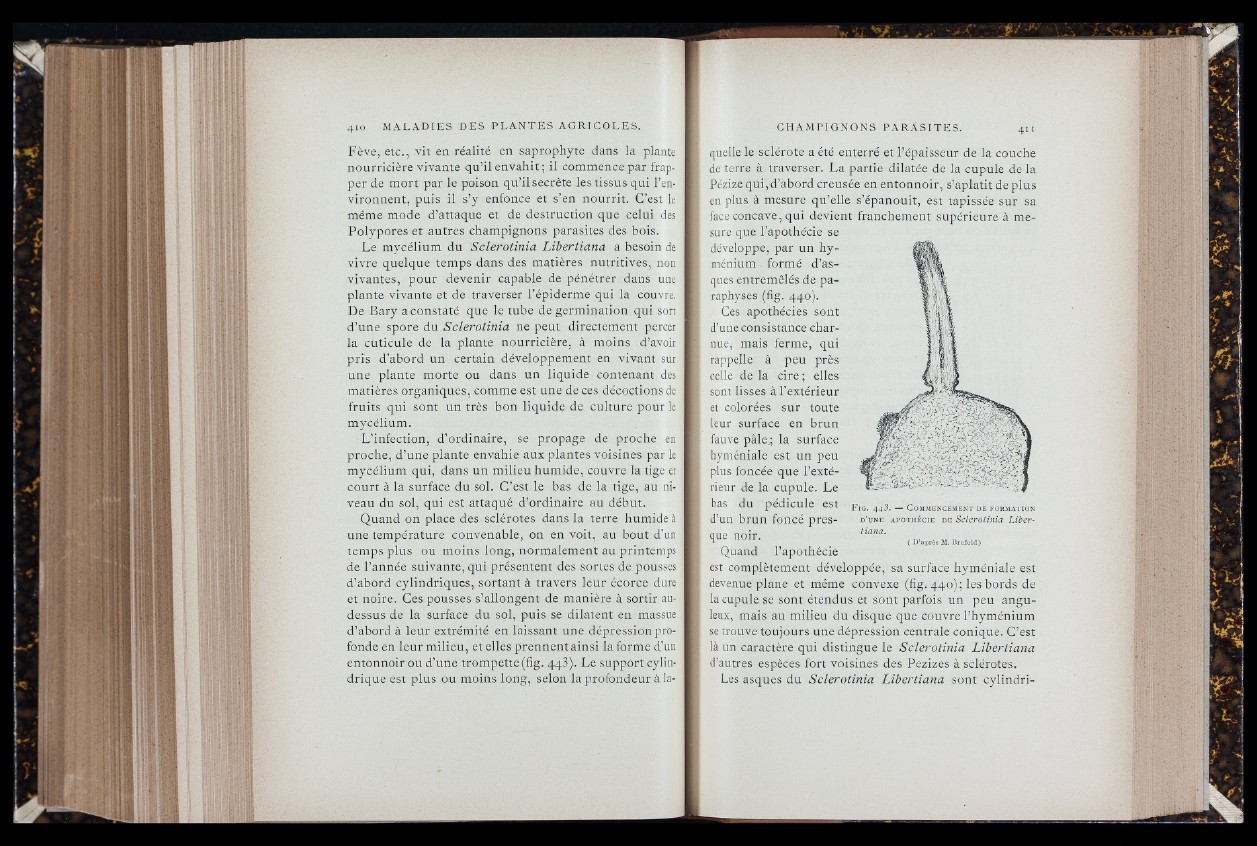
Fève, etc., vit en réalité en saprophyte dans la plante
nourricière vivante qu’il envahit ; il commence par frapper
de mort par le poison qu’il secrète lestissus qui l ’en-
vironnent, puis il s’y enfonce et s’en nourrit. C ’est le
même mode d’attaque et de destruction que celui des
Polypores et autres champignons parasites des bois.
Le mycélium du S c le ro tin ia L ib e r tian a a besoin de
vivre quelque temps dans des matières nutritives, non
vivantes, pour devenir capable de pénétrer dans une
plante vivante et de traverser l ’épiderme qui la couvre.
De B a ry a constaté que le tube de germination qui son
d’une spore du S c le ro tin ia ne peut directement percer
la cuticule de la plante nourricière, à moins d’avoir
pris d’abord un certain développement en vivant sur
une plante morte ou dans un liquide contenant des
matières organiques, comme est une de ces décoctions de
fruits qui sont un très bon liquide de culture pour le
mycélium.
L ’ infection, d’ordinaire, se propage de proche en
proche, d’une plante envahie aux plantes voisines par le
mycélium qui, dans un milieu humide, couvre la tige et
court à la surface du sol. C ’est le bas de la tige, au niveau
du sol, qui est attaqué d’ordinaire au début.
Quand on place des sclérotes dans la terre humide à
une température convenable, on en voit, au bout d’un
temps plus ou moins long, normalement au printemps
de l ’année suivante, qui présentent des sortes de pousses
d’abord cylindriques, sortant à travers leur écorce dure
et noire. Ces pousses s’allongent de manière à sortir au-
dessus de la surface du sol, puis se dilatent en massue
d’abord à leur extrémité en laissant une dépression profonde
en leur milieu, et elles prennent ainsi la forme d’un
entonnoir ou d’une trompette (fig. qqS). Le support cylindrique
est plus ou moins long, selon la profondeur à laquelle
le sclérote a été enterré et l ’épaisseur de la couche
de terre à traverser. L a partie dilatée de la cupule de la
Pézize q u i,d ’abord creusée en entonnoir, s’aplatit de plus
en plus à mesure qu’elle s’épanouit, est tapissée sur sa
face concave, qui devient franchement supérieure à mesure
que l ’apothécie se
développe, par un h y ménium
formé d’asques
entremêlés de paraphyses
(fig. 440).
Ces apothécies sont
d’une consistance charnue,
mais ferme, qui
rappelle à peu près
celle de la cire ; elles
sont lisses à l ’extérieur
et colorées sur toute
leur surface en brun
fauve pâle,; la surface
hyméniale est un peu
plus foncée que l’extérieur
de la cupule. Le
bas du pédicule est
d’un brun foncé presque
F ig . 4 4 3 . — C o m m e n c em e n t d e fo rm a t io n
d ’ u n e APOTHÉCIE DE S clevotinia L ib e r tiana.
noir.
( D’après M. Bre fe ld)
Quand l’apothécie
est complètement développée, sa surface hyméniale est
devenue plane et même convexe (fig. 440); les bords de
la cupule se sont étendus et sont parfois un peu anguleux,
mais au milieu du disque que couvre l ’hyménium
se trouve toujours une dépression centrale conique. C ’est
là un caractère qui distingue le S c le ro tin ia L ibe rtiana
d’autres espèces fort voisines des Pezizes à sclérotes.
Les asques du Sc le ro tin ia L ib e rtian a sont cylindri-