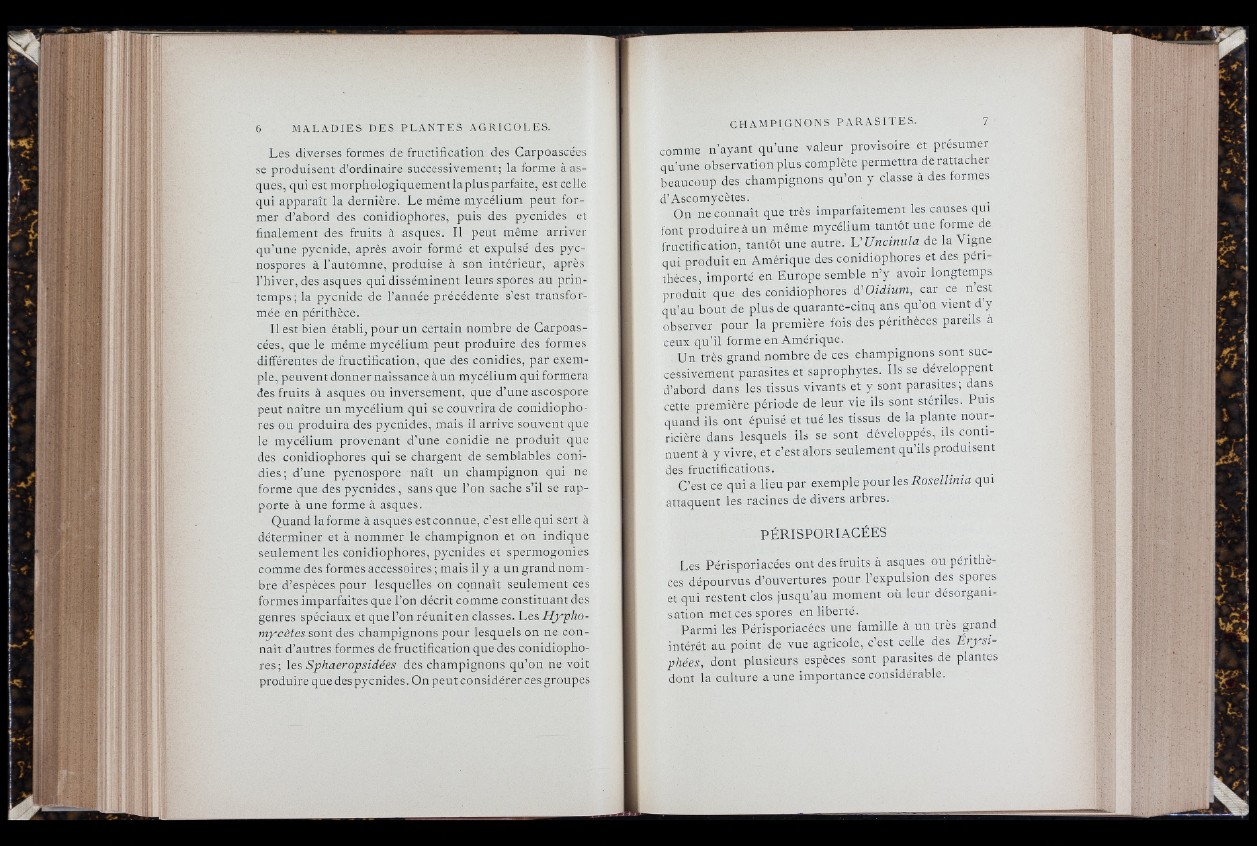
Les diverses formes de fructification des Carpoascées
se produisent d’ordinaire successivement; la forme à asques,
qui est morphologiquementlaplusparfaite, est celle
qui apparaît la dernière. Le même mycélium peut fo rmer
d’abord des conidiophores, puis des pycnides et
finalement des fruits à asques. I l peut même arriver
qu’une pycnide, après avoir formé et expulsé des pycnospores
à l’automne, produise à son intérieur, après
l ’hiver, des asques qui disséminent leurs spores au printemps;
la pycnide de l ’année précédente s’est transformée
en périthèce.
Il est bien établi, pour un certain nombre de Carpoascées,
que le même mycélium peut produire des formes
différentes de fructification, que des conidies, par exemple,
peuvent donner naissance à un mycélium qui formera
des fruits à asques ou inversement, que d’une ascospore
peut naître un mycélium qui se couvrira de conidiophores
ou produira des pycnides, mais il arrive souvent que
le mycélium provenant d’une conidie ne produit que
des conidiophores qui se chargent de semblables conidies;
d’une pycnospore naît un champignon qui ne
forme que des pycnides, sans que l’on sache s’il se rapporte
à une forme à asques.
Quand la forme à asques est connue, c’est elle qui sert à
déterminer et à nommer le champignon et on indique
seulement les conidiophores, pycnides et spermogonies
comme des formes accessoires ; mais il y a un grand nombre
d’espèces pour lesquelles on connaît seulement ces
formes imparfaites que l’on décrit comme constituant des
genres spéciaux et que l ’on réunit en classes. Le s H y p h o -
mycètes sont des champignons pour lesquels on ne connaît
d’autres formes de fructification que des conidiophores;
les Sphaeropsidées des champignons qu’on ne voit
produire que des pycnides. On peut considérer ces groupes
comme n’ayant qu’une valeur provisoire et présumer
qu’une observation p lus complète permettra derattacher
beaucoup des champignons qu’on y classe à des formes
d’Ascomycètes.
On ne connaît que très imparfaitement les causes qui
font produire à un même mycélium tantôt une forine de
fructification, tantôt une autre. U U n c in u la de la \ ig n e
qui produit en Amérique des conidiophores et des périthèces,
importé en Europe semble n’y avoir longtemps
produit que des conidiophores à'Oidium, car ce n est
qu’au bout de plus de quarante-cinq ans qu’on vient d’y
observer pour la première fois des périthèces pareils à
ceux qu’il forme en Amérique.
Un très grand nombre de ces champignons sont successivement
parasites et saprophytes. Ils se développent
d’abord dans les tissus vivants et y sont parasites; dans
cette première période de leur vie ils sont stériles. Puis
quand ils ont épuisé et tué les tissus de la plante nouro
ricière dans lesquels ils se sont développés, ils continuent
à y vivre, et c’est alors seulement qu’ils produisent
des fructifications.
C’est ce qui a lieu par exemple pour les qui
attaquent les racines de divers arbres.
P É R IS P O R IA C É E S
Les Périsporiacées ont des fruits à asques ou périthèces
dépourvus d’ouvertures pour l’expulsion des spores
et qui restent clos jusqu’au moment où leur désorganisation
met ces spores en liberté.
Parmi les Périsporiacées une famille à un très p-and
intérêt au point de vue agricole, c’est celle des É r y s i -
phées, dont plusieurs espèces sont parasites de plantes
dont la culture a u n e importance considérable.