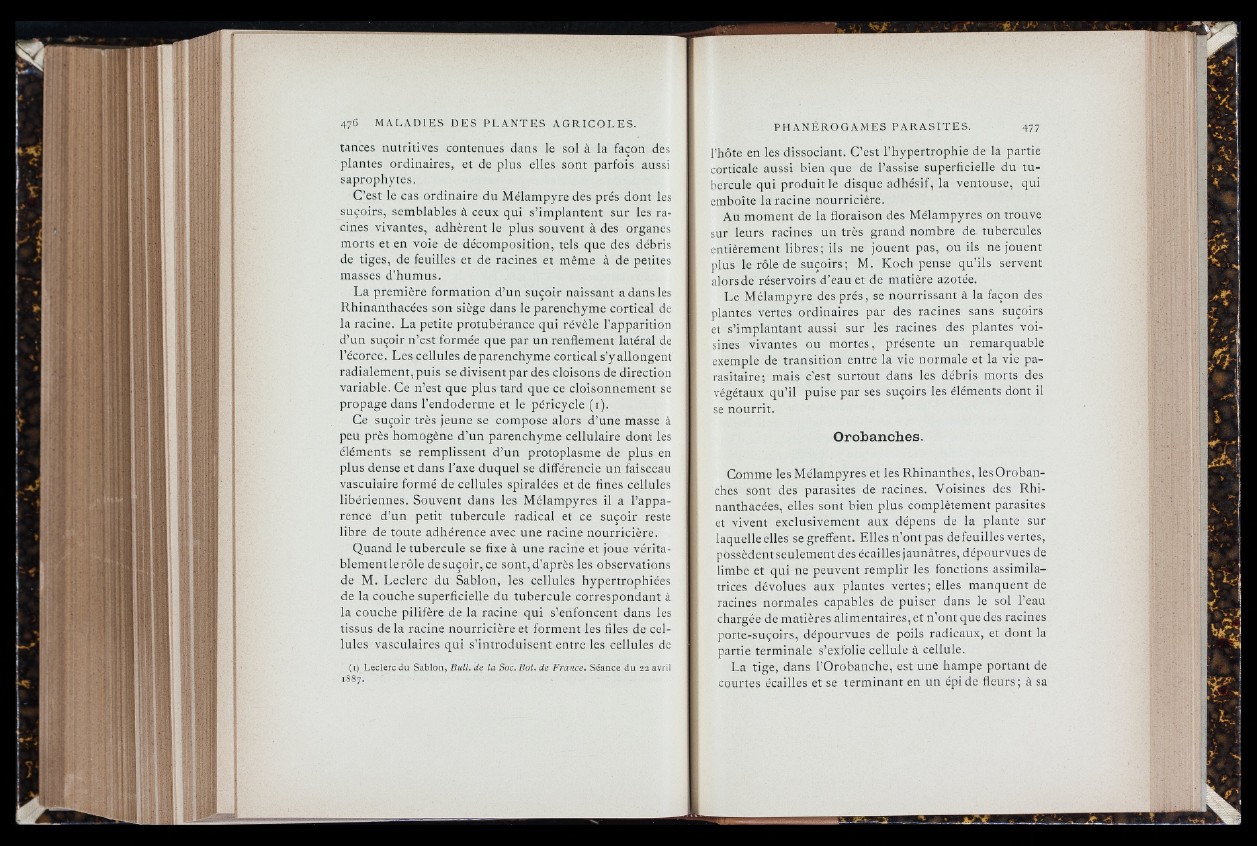
tances nutritives contenues dans le sol à la façon des
plantes ordinaires, et de plus elles sont parfois aussi
saprophytes.
C ’est le cas ordinaire du Mélampyre des prés dont les
suçoirs, semblables à ceux qui s’implantent sur les racines
vivantes, adhèrent le plus souvent à des organes
morts et en voie de décomposition, tels que des débris
de tiges, de feuilles et de racines et même à de petites
masses d’humus.
L a première formation d’un suçoir naissant a dans les
Rhinanthacées son siège dans le parenchyme cortical de
la racine. L a petite protubérance qui révèle l ’apparition
d’un suçoir n’est formée que par un renflement latéral de
l ’écorce. Le s cellules de parenchyme cortical s’y allongent
radialement, puis se divisent par des cloisons de direction
variable. Ce n’est que plus tard que ce cloisonnement se
propage dans l’endoderme et le péricycle (i).
Ce suçoir très jeune se compose alors d’une masse à
peu près homogène d’un parenchyme cellulaire dont les
éléments se remplissent d’un protoplasme de plus en
plus dense et dans l ’axe duquel se différencie un faisceau
vasculaire formé de cellules spiralées et de fines cellules
libériennes. Souvent dans les Mélampyres il a l’apparence
d’un petit tubercule radical et ce suçoir reste
libre de toute adhérence avec une racine nourricière.
Quand le tubercule se fixe à une racine et joue vérita-
blemenilerôle desuçoir,ce son t,d ’après les observations
de M. Leclerc du Sablón, les cellules hypertrophiées
de la couche superficielle du tubercule correspondant à
la couche pilifère de la racine qui s’enfoncent dans les
tissus de la racine nourricière et forment les files de cellules
vasculaires qui s’introduisent entre les cellules de
(i) L e cle rc du Sablón, B u ll, de la Soc. Bot. de F ra n c e . Séance du 22 avril
l’hôte en les dissociant. C’est l ’hypertrophie de la partie
corticale aussi bien que de l’assise superficielle du tubercule
qui produit le disque adhésif, la ventouse, qui
emboîte la racine nourricière.
Au moment de la floraison des Mélampyres on trouve
sur leurs racines un très grand nombre de tubercules
entièrement libre s; ils ne jouent pas, ou ils ne jouent
plus le rôle de suçoirs; M. Koch pense qu’ils servent
alors de réservoirs d’eau et de matière azotée.
L e Mélampyre des prés, se nourrissant à la façon des
plantes vertes ordinaires par des racines sans suçoirs
et s’ implantant aussi sur les racines des plantes vo isines
vivantes ou mortes, présente un remarquable
exemple de transition entre la vie normale et la vie parasitaire;
mais c’est surtout dans les débris morts des
végétaux qu’il puise par ses suçoirs les éléments dont il
se nourrit.
Orobanches.
Comme les Mélampyres et les Rhinanthes, les Orobanches
sont des parasites de racines. Voisines des R h inanthacées,
elles sont bien plus complètement parasites
et vivent exclusivement aux dépens de la plante sur
laquelle elles se greffent. E lle s n’ont pas de feuilles vertes,
pôssèdentseulementdesécaillesjaunâtres, dépourvues de
limbe et qui ne peuvent remplir les fonctions assimila-
trices dévolues aux plantes vertes; elles manquent de
racines normales capables de puiser dans le sol l ’eau
chargée de matières alimentaires, et n’ont que des racines
porte-suçoirs, dépourvues de poils radicaux, et dont la
partie terminale s’exfolie cellule à cellule.
L a tige, dans l’Orobanche, est une hampe portant de
courtes écailles et se terminant en un épi de fleurs; à sa