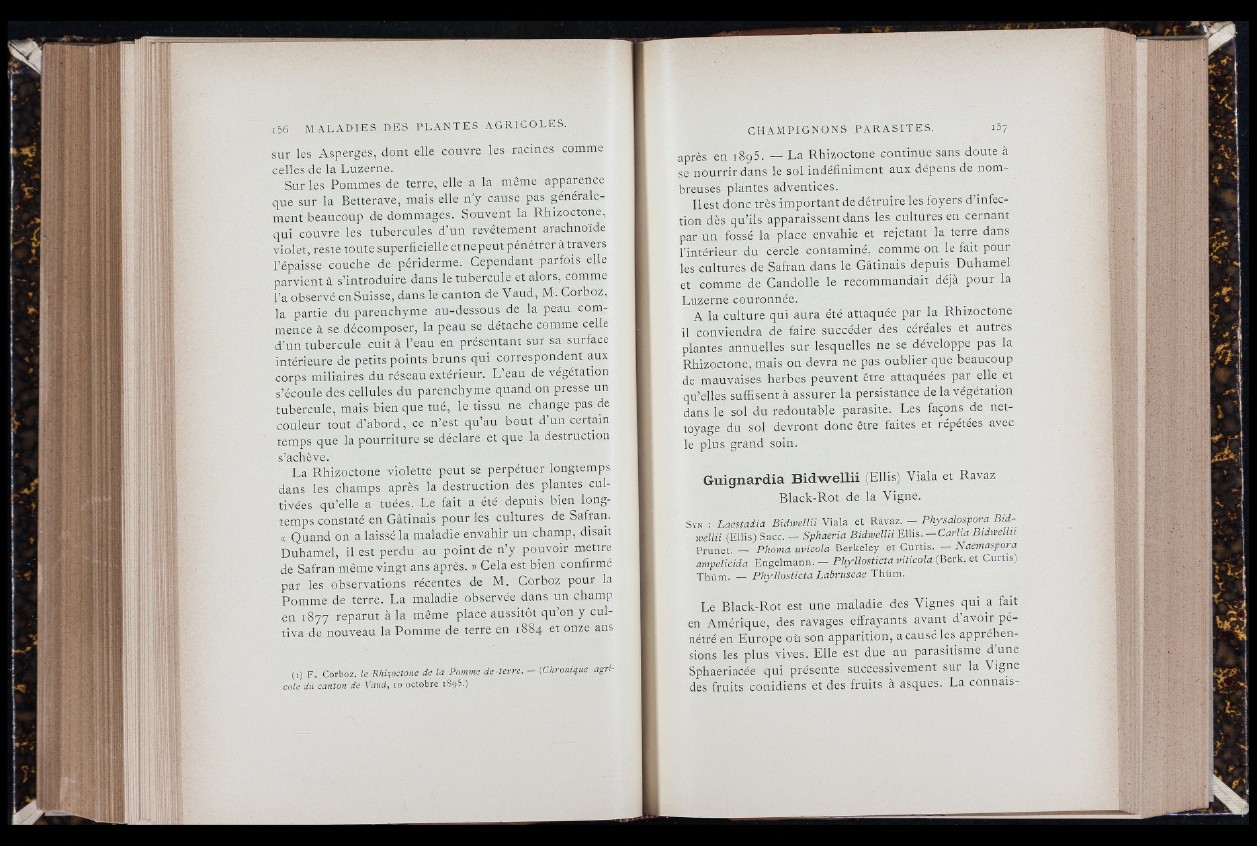
a
t;
IT
í
jï
.1 '
sur les Asperges, dont elle couvre les racines comme
celles de la Luzerne.
Sur les Pommes de terre, elle a la même apparence
que sur la Betterave, mais elle n'y cause pas généralement
beaucoup de dommages. Souvent la Rhizoctone,
qui couvre les tubercules d’un revêtement arachnoïde
violet, reste toute superficielle e t n e peut pénétrer à travers
l’épaisse couche de périderme. Cependant parfois elle
parvient à s’introduire dans le tubercule et alors, comme
l’a observé en Suisse, dans le canton de Vaud, M-. Corboz,
la partie du parenchyme au-dessous de la peau commence
à se décomposer, la peau se détache comme celle
d’un tubercule cuit à l’eau en présentant sur sa surface
intérieure de petits points bruns qui correspondent aux
corps miliaires du réseau extérieur. L ’eau de végétation
s’écoule des cellules du parenchyme quand on presse un
tubercule, mais bien que tué, le tissu ne change pas de
couleur tout d’abord, ce n’est qu’au bout d un certain
temps que la pourriture se déclare et que la destruction
s’achève.
La Rhizoctone violette peut se perpétuer longtemps
dans les champs après la destruction des plantes cultivées
qu’elle a tuées. Le fait a été depuis bien longtemps
constaté en Gâtinais pour les cultures de Safran.
« Quand on a laissé la maladie envahir un champ, disait
Duhamel, il est perdu au point de n’y pouvoir mettre
de Safran même vingt ans après. » Cela est bien confirmé
par les observations récentes de M. Corboz pour la
Pomme de terre. La maladie observée dans un champ
en 1877 reparut à la même place aussitôt qu’on y cultiva
de nouveau la Pomme de terre en 1884 et onze ans
(i) F . Corboz, le R h izo cto ne d e la P om m e d e t e r r e . — (C h r o n iq u e a g r ic
o le d u can ton d e Vau d, lo octobre i 8g 5.)
après en 1895. — La Rhizoctone continue sans doute à
se nourrir dans le sol indéfiniment aux dépens de nombreuses
plantes adventices.
Il est donc très important de détruire les foyers d’infection
dès qu’ils apparaissent dans les cultures en cernant
par un fossé la place envahie et rejetant la terre dans
l’intérieur du cercle contaminé, comme on le fait poulies
cultures de Safran dans le Gâtinais depuis Duhamel
et comme de Candolle le recommandait déjà pour la
Luzerne couronnée.
A la culture qui aura été attaquée par la Rhizoctone
il conviendra de faire succéder des céréales et autres
plantes annuelles sur lesquelles ne se développe pas la
Rhizoctone, mais on devra ne pas oublier que beaucoup
de mauvaises herbes peuvent être attaquées par elle et
qu’elles suffisent à assurer la persistance delà végétation
dans le sol du redoutable parasite. Les façons de nettoyage
du sol devront donc être faites et répétées avec
le plus grand soin.
Guignardia B id w e llii (Ellis) Viala et Ravaz
Black-Rot de la Vigne.
S y n : L a e s t a d i a B i d w e l l i i V i a l a e t R a v a z . - P h y s a l o s p o r a B i c i -
i v e l l i i ( E l l i s ) S a c c . — S p h a e r i a B i d w e l l i i F V iia . — C a r h a B i d w e l h i
P r u n e t . - P h o m a u v i c o l a B e r k e l e y et G u r t i s . - N a e m a s p o r a
a m p e l i c id a E n g e lm a n n . — P h y l l o s t i c t a v i t i c o l a ( B e r k . et C u r t í s )
T h ü m . — P h y l l o s t i c t a L a b r u s c a e T h ü m .
Le Black-Rot est une maladie des Vignes qui a fait
en Amérique, des ravages effrayants avant d’avoir pénétré
en Europe où son apparition, a causé les appréhensions
les plus vives. Elle est due au parasitisme d’une
Sphaeriacée qui présente successivement sur la Vigne
des fruits conidiens et des fruits à asques. La connais-
K ; . ® :