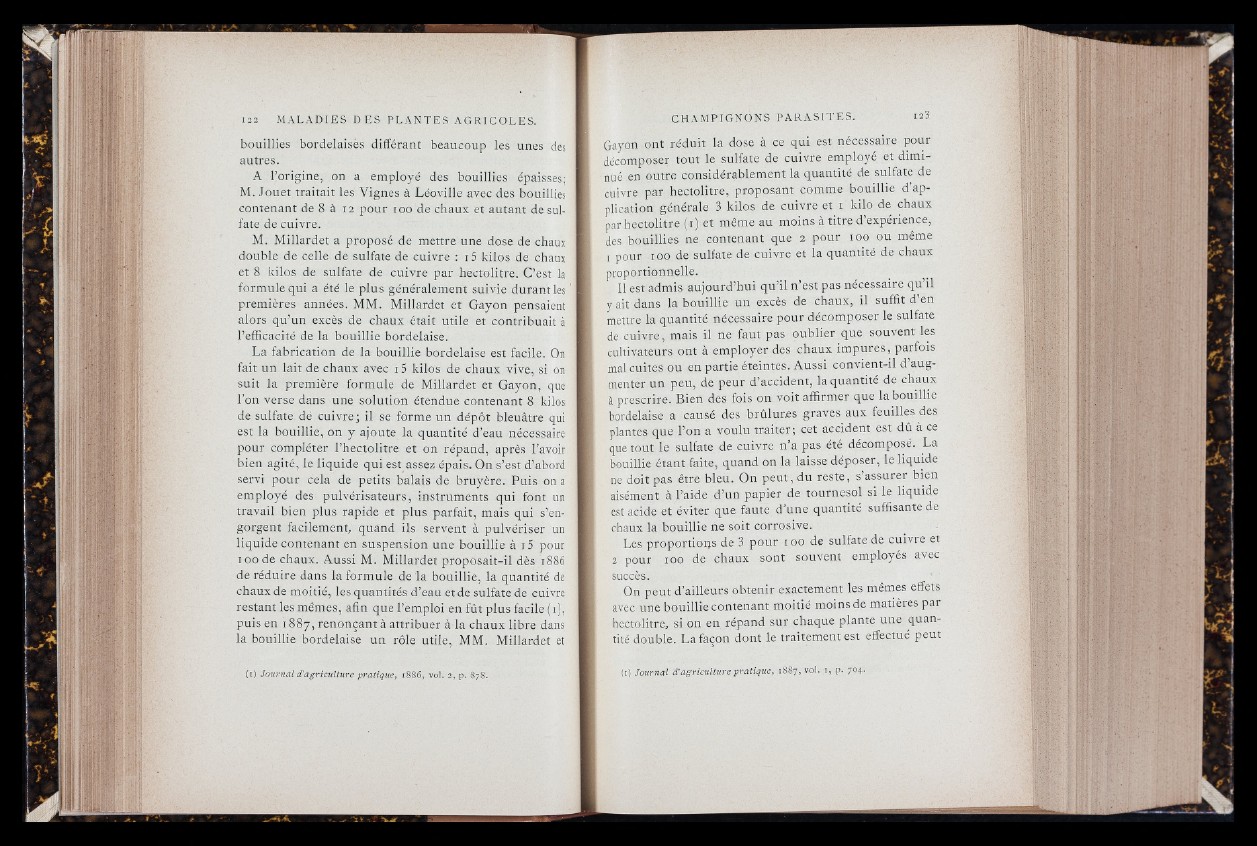
Y'' :
bouillies bordelaises différant beaucoup les unes des
autres.
A l’origine, on a employé des bouillies épaisses;
M. Jouet traitait les Vignes à Léoville avec des bouillies
contenant de 8 à 12 pour 100 de chaux et autant de sulfate
de cuivre.
M. Millardet a proposé de mettre une dose de chaux
double de celle de sulfate de cuivre : i 5 kilos de chaux
et 8 kilos de sulfate de cuivre par hectolitre. C’est la
formule qui a été le plus généralement suivie durant les
premières années. MM. Millardet et Gayon pensaient
alors qu’un excès de chaux était utile et contribuait à
l ’efficacité de la bouillie bordelaise.
La fabrication de la bouillie bordelaise est facile. On
fait un lait de chaux avec 1 5 kilos de chaux vive, si on
suit la première formule de Millardet et Gayon, que
l ’on verse dans une solution étendue contenant 8 kilos
de sulfate dé cuivre; il se forme un dépôt bleuâtre qui
est la bouillie, on y ajoute la quantité d’eau nécessaire
pour compléter l’hectolitre et on répand, après l ’avoir
bien agité, le liquide qui est assez épais. On s’est d’abord
servi pour cela de petits balais de bruyère. Puis on a
employé des pulvérisateurs, instruments qui font un
travail bien plus rapide et plus parfait, mais qui s’engorgent
facilement, quand ils servent à pulvériser un
liquide contenant en suspension une bouillie à i5 pour
100 de chaux. Aussi M. Millardet proposait-il dès 1886
de réduire dans la formule de la bouillie, la quantité de
chaux de moitié, les quantités d’eau et de sulfate de cuivre
restant les mêmes, afin que l’emploi en fût plus facile (1),
puis en 1 887, renonçant à attribuer â la chaux libre dans
la bouillie bordelaise un rôle utile, MM. Millardet et
(i) Jo u rn a l d 'a g r icu ltu re pratique, 1886, vol. 2, p. 878.
Gayon ont réduit la dose à ce qui est nécessaire pour
décomposer tout le sulfate de cuivre employé et diminué
en outre considérablement la e|uantité de sulfate de
cuivre par hectolitre, proposant comme bouillie d’application
générale 3 kilos de cuivre et i kilo de chaux
par hectolitre (i) et même au moins à titre d’expérience,
des bouillies ne contenant que 2 pour 100 ou même
I pour 100 de sulfate de cuivre et la quantité de chaux
proportionnelle.
11 est admis aujourd’hui qu’il n’est pas nécessaire qu’il
y ait dans la bouillie un excès de chaux, il suffit d’en
mettre la quantité nécessaire pour décomposer le sulfate
de cuivre, mais il ne faut pas oublier que souvent les
cultivateurs ont à employer des chaux impures, parfois
mal cuites ou en partie éteintes. Aussi convient-il d augmenter
un peu, de peur d’accident, la quantité de chaux
à prescrire. Bien des fois on voit affirmer que la bouillie
bordelaise a causé des brûlures graves aux feuilles des
plantes que l’on a voulu traiter; cet accident est dû à ce
que tout le sulfate de cuivre n’a pas été décomposé. La
bouillie étant faite, quand on la laisse déposer, le liquide
ne doit pas être bleu. On peut, du reste, s’assurer bien
aisément à l’aide d’un papier de tournesol si le liquide
est acide et éviter que faute d’une quantité suffisante de
rhaux la bouillie ne soit corrosive.
Les proportions de 3 pour 1 00 de sulfate de cuivre et
2 pour 100 de chaux sont souvent employés avec
succès.
On peut d’ailleurs obtenir exactement les mêmes effets
avec une bouillie contenant moitié moins de matièies par
hectolitre, si on en répand sur chaque plante une quantité
double. La façon dont le traitement est effectué peut
(i) Jo u rn a l d’a g r icu ltu re p ra tiqu e , 1887, vol. i , p. 704.