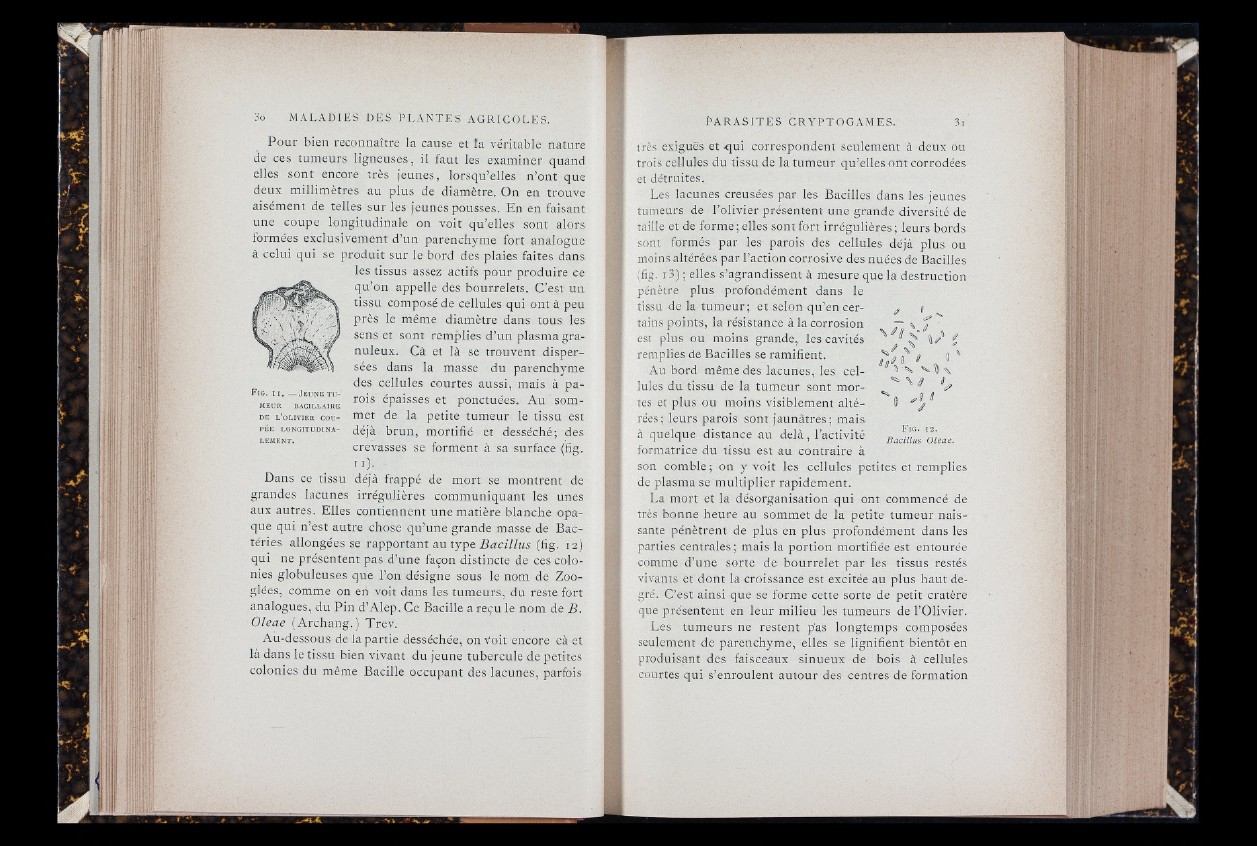
Mi!.
liiii
i i.'jiïi.
1 |i/i
! lllivl:
V'
‘iMHi
Pour bien reconnaître la cause et la véritable nature
de ces tumeurs ligneuses, il faut les examiner quand
elles sont encore très jeunes, lorsqu’elles n’ont que
deux millimètres au plus de diamètre. On en trouve
aisément de telles sur les jeunes pousses. En en faisant
une coupe longitudinale on voit qu’elles sont alors
formées exclusivement d’un parenchyme fort analogue
à celui qui se produit sur le bord des plaies faites dans
les tissus assez actifs pour produire ce
qu’on appelle des bourrelets. C ’est un
tissu composé de cellules qui ont à peu
près le même diamètre dans tous les
sens et sont remplies d’un plasma granuleux.
Cà et là se trouvent dispersées
dans la masse du parenchyme
des cellules courtes aussi, mais à parois
épaisses et ponctuées. Au sommet
de la petite tumeur le tissu est
déjà brun, mortifié et desséché; des
crevasses se forment à sa surface (fig.
'0 -
F i g . u . — J e u n e t u m
e u r BACILLAIRE
DE l ’o l iv i e r co u p
é e LONGITUDINALEMENT.
Dans ce tissu déjà frappé de mort se montrent de
grandes lacunes irrégulières communiquant les unes
aux autres. Elles contiennent une matière blanche opaque
qui n’est autre chose qu’une grande masse de Bactéries
allongées se rapportant au type (fig. 12)
qui ne présentent pas d’une façon distincte de ces colonies
globuleuses que l’on désigne sous le nom de Zooglées,
comme on en voit dans les tumeurs, du reste fort
analogues, du Pin d’Alep. Ce Bacille a reçu le nom de B .
Oleae (Archang.) Trev.
Au-dessous de la partie desséchée, on Voit encore cà et
là dans le tissu bien vivant du jeune tubercule de petites
colonies du même Bacille occupant des lacunes, parfois
très exiguës et <[ui correspondent seulement à deux ou
trois cellules du tissu de la tumeur qu’elles ont corrodées
et détruites.
Les lacunes creusées par les Bacilles dans les jeunes
tumeurs de l ’olivier présentent une grande diversité de
taille et de forme ; elles sont fort irrégulières; leurs bords
sont formés par les parois des cellules déjà plus ou
moins altérées par l ’action corrosive des nuées de Bacilles
(fig. i 3) ; elles s’agrandissent à mesure que la destruction
pénètre plus profondément dans le
tissu de la tumeur; et selon qu’en cer- ^ s
tains points, la résistance à la corrosion
est plus ou moins grande, les cavités
i
remplies de Bacilles se ramifient.
y y
3 "
Au bord même des lacunes, les cellules
■ S N
i L
du tissu de la tumeur sont mortes
et plus ou moins visiblement altérées;
leurs parois sont jaunâtres; mais
Fig. 1 2 .
à quelque distance au delà, l ’activité
B acillus Oleae.
formatrice du tissu est au contraire à
son comble; on y voit les cellules petites et remplies
de plasma se multiplier rapidement.
La mort et la désorganisation qui ont commencé de
très bonne heure au sommet de la petite tumeur naissante
pénètrent de plus en plus profondément dans les
parties centrales; mais la portion mortifiée est entourée
comme d’une sorte de bourrelet par les tissus restés
vivants et dont la croissance est excitée au plus haut degré.
C’est ainsi que se forme cette sorte de petit cratère
que présentent en leur milieu les tumeurs de l ’Olivier.
Les tumeurs ne restent pas longtemps composées
seulement de parenchyme, elles se lignifient bientôt en
produisant des faisceaux sinueux de bois à cellules
courtes qui s’enroulent autour des centres de formation