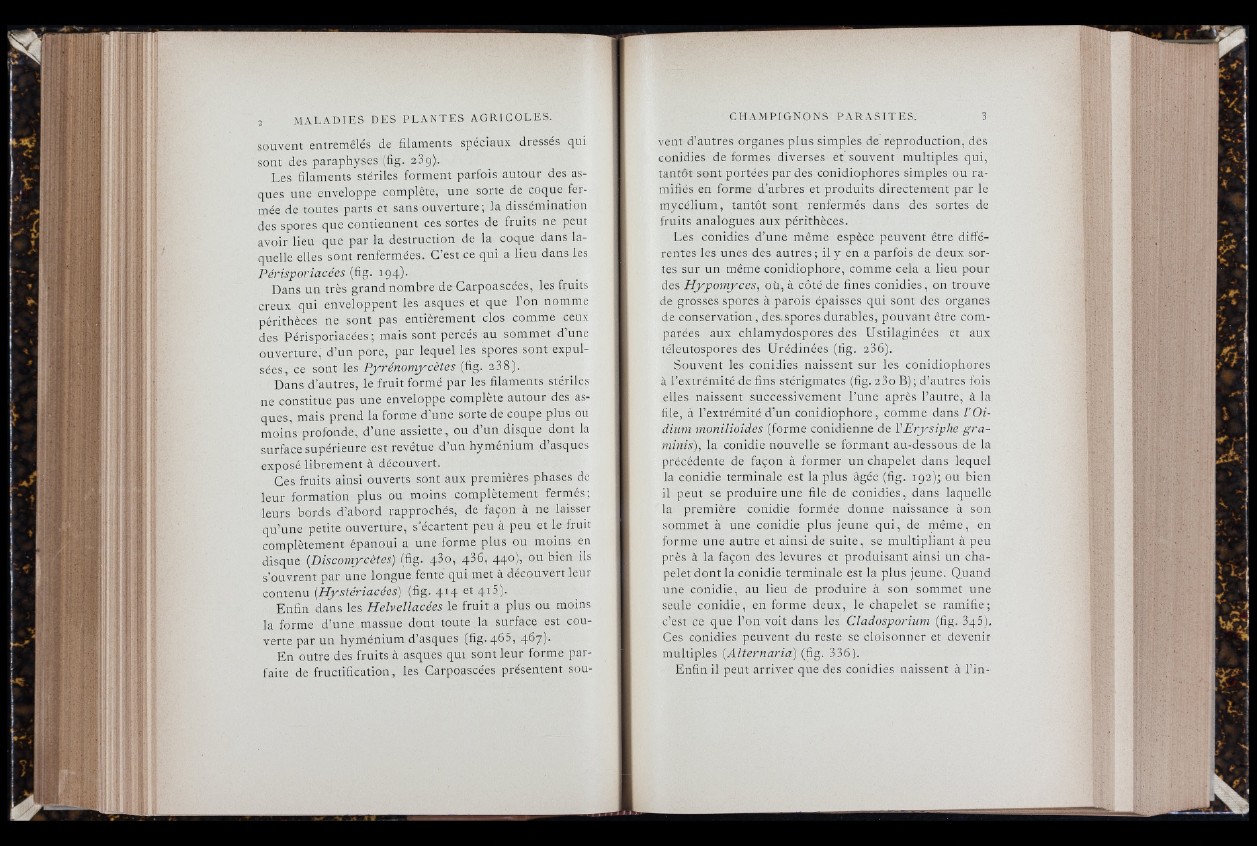
souvent entremêlés de filaments spéciaux dressés qui
sont des paraphyses (fig. aSg).
Les filaments stériles forment parfois autour des asques
une enveloppe complète, une sorte de coque fermée
de toutes parts et sans ouverture; la dissémination
des spores que contiennent ces sortes de fruits ne peut
avoir lieu que par la destruction de la coque dans laquelle
elles sont renfermées. C ’est ce qui a lieu dans les
P é risp oria c é e s (fig. 194).
Dans un très grand nombre de Carpoascées, les fruits
creux qui enveloppent les asques et que l’on nomme
périthèces ne sont pas entièrement clos comme ceux
des Périsporiacées; mais sont percés au sommet d’une
ouverture, d’un pore, par lequel les spores sont expulsées,
ce sont les P y rén om y c è te s (fig. 3 3 8 ).
Dans d’autres, le fruit formé par les filaments stériles
ne constitue pas une enveloppe complète autour des asques,
mais prend la forme d’une sorte de coupe plus ou
moins profonde, d’une assiette, ou d’un disque dont la
surface supérieure est revêtue d’un hyménium d’asques
exposé librement à découvert.
Ces fruits ainsi ouverts sont aux premières phases de
leur formation plus ou moins complètement fermés;
leurs bords d’abord rapprochés, de façon à ne laisser
qu’une petite ouverture, s'écartent peu à peu et le fruit
complètement épanoui a une forme plus ou moins en
disque {Discomycètes) (fig. q3o, 4 3 6 , 440), ou bien ils
s’ouvrent par une longue fente qui met à découvert leur
contenu (Hystériacées) (fig. 4 14 et 4 1 5).
Enfin dans les H e lv e lla c é e s le fruit a plus ou moins
la forme d’une massue dont toute la surface est couverte
par un hyménium d’asques (fig. q65, 467).
En outre des fruits à asques qui sont leur forme parfaite
de fructification, les Carpoascées présentent souvent
d’autres organes plus simples de reproduction, des
conidies de formes diverses et souvent multiples qui,
tantôt sont portées par des conidiophores simples ou ramifiés
en forme d’arbres et produits directement par le
mycélium, tantôt sont renfermés dans des sortes de
fruits analogues aux périthèces.
Les conidies d’une même espèce peuvent être différentes
les unes des autres; il y en a parfois de deux sortes
sur un même conidiophore, comme cela a lieu pour
des Hypomyces, où, à côté de fines conidies, on trouve
de grosses spores à parois épaisses qui sont des organes
de conservation, des.spores durables, pouvant être comparées
aux chiamydospores des Usiilaginées et aux
téleutospores des Urédinées (tig. 336).
Souvent les conidies naissent sur les conidiophores
à l’extrémité de fins stérigmates (fig. 23o B) ; d’autres fois
elles naissent successivement l’une après l’autre, à la
file, à l’extrémité d’un conidiophore, comme dans V Oidium
moniiioides (forme conidienne de VErysiplie g ra minis),
la conidie nouvelle se formant au-dessous de la
précédente de façon à former un chapelet dans lequel
la conidie terminale est la plus âgée (fig. 192); ou bien
il peut se produire une file de conidies, dans laquelle
la première conidie formée donne naissance à son
sommet à une conidie plus jeune qui, de même, en
forme une autre et ainsi de suite, se mullipiliant à peu
près à la façon des levures et produisant ainsi un chapelet
dont la conidie terminale est la plus jeune. Quand
une conidie, au lieu de produire à son sommet une
seule conidie, en forme deux, le chapelet se ramifie;
c’est ce que l’on voit dans les Cladosporium (fig. 3q 5),
Ces conidies peuvent du reste se cloisonner et devenir
multiples [Alternaria] (fig. 3 3 6 ).
Enfin il peut arriver que des conidies naissent à Fin