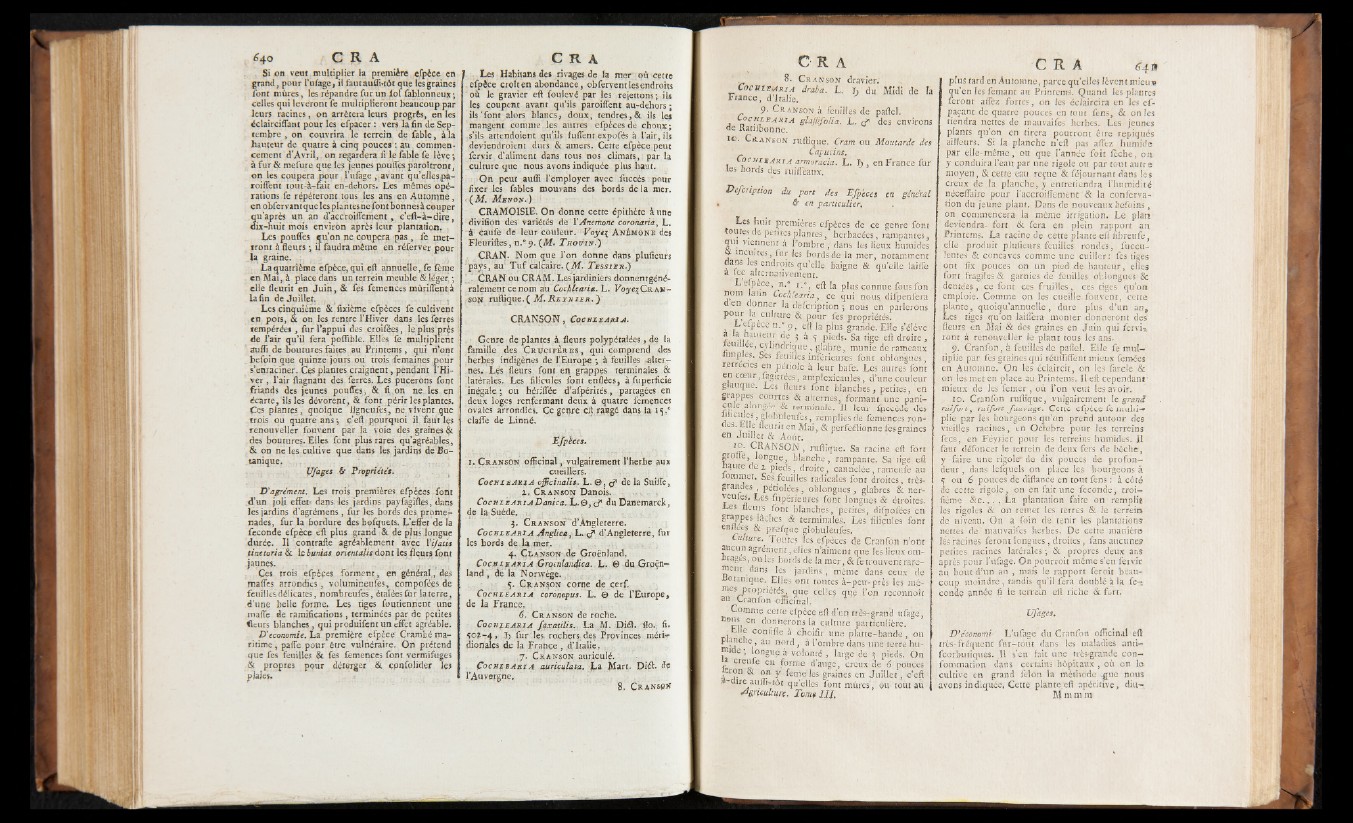
Si on veut multiplier la première espèce en
grand, pour i’ufage* il fautaufiHôt que les graines
font mûres, les répandre fur un lo i fablonneux ;
celles qui lèveront fe multiplieront beaucoup par
leurs racines, on arrêtera leurs progrès, en les
éclairciffant pour les efpacer : vers la fin de Septembre
, on couvrira le terrain de fable, à la
hauteur de quatre à cinq pouces : au commencement
d’Avril, on regardera fi le fable fe lève ;
à fur & mefure que les jeunes pouffes paraîtront,
on les coupera pour l’ufage , avant qu’elles,pa-
roiffent tout-à-fait en-dehors. Les mêmes opérations
fe répéteront tous les ans en Autoiqne,
en obfer vint que les plan tes ne font bonnesà couper
u’après un an d’accroiffement, c’e ft-à -d ir e ,
ix-nuit mois environ après leur plantation. •
Les pouffes qu’on ne coupera pas , fe mettront
à fleurs ; il faudra même en réferver pour
la graine. ;
La quatrième efpèce, qui çft annuelle, fe fème
en Mai, à place dans un terrein meuble & léger] ;
elle fleurit en Ju in , & fes femences mûriffentà
la fin de Juillet.
Les çinquième & fixième efpèces fe cultivent
en pots, & on les rentre l’Hiver dans lesfçrrçs
tempérées , fur l’appui des çroifées, le plus près
de l’air qu’il fera poffible. Elles fe multiplient
aufli de boutures faites au Printems, qui n’ont
befoin que quinze jours ou trois femaines pour
s’enraciner. Ces plantes craignent, pendant l ’Hiver
, l’air flagnam des ferres. Les pucerons font
friands des jeunes pouffes, & fi,on ne les.en
écarte, ils les dévorent, & font périr les plantes.
Ççs plantes, quoique ligneufes,, ne,vivent que
trois ou quatre ans •, ç’eft pourquoi il faut lçs
renouveller fouvent par }a voie des graines $c
des boutures. Elles font plus rares qu’agréables,,
& on ne les cultive que dans les jardins de Botanique.
\Tfages & Propriétés.
D'agrément. Les trois premières efpèces font
d’un joli effet» dans les jardins payfagiflçs, dans
les jardins d’agrémens , fur le? bords des prome*-
nades, fur la bordure des bofquets. L’effet de la
fécondé efpèce eft plus grand & de plus longue
duréç. Il contrafle agréablement avec Vijatps
tinetoria & le bunias orientais dont les fleur^ font
jaunes.
Ces trois efpëçes forment, en général,, des
maffes arrondies , volumineufes, compofées de
feuilles délicates, nombreufés, étalées für la terre,
d’une belle forme. Les tiges Contiennent une
maffe de ramifications , terminées par de petites |
fleurs blanches , qui produifent un effet agréable.
D'économie. La première efpèce' Crambé maritime,
paffe pour être vulnéraire. On prétend
que fes feuilles & fes femences font vermifuges
& propres pour déterger & çpnfolider lçs
plaies, . e
f Les Habhans des rivages de la mer où cette
efpèce crolten abondance, obfervent les endroits
où le gravier efl foulevé par les rejettons; iû
les coupent avant qu’ils paroiffent au-dehors ;
iis'font alors blancs, doux, tendres,& ils les
mangent comme. .les autres efpèces de choux ;
s’ils attendoient qu’ils fuffenr expofés à l’air, ils
deviendraient durs & amers. Cetre efpèce peut
fervir d’aliment dans tous nos climats, par la
culture que nous avons indiquée plus haut.
On peut aufli l’employer avec fuccès : pour
fixer les fables mouvans des bords de la mer.
(Af. Menon.) 1
CRAMOISIE. On donne cette épithète à une
divifion des variétés de Y Anémone coronaria, L.
à caufe de leur couleur. Voyez Anémone des
Fléuriftes, n .°9 . (iH. Thoxïiw.')
CRAN. Nom que l’on donne dans plufieurs
pays, au T u f calcaire. (Af. Tessier.)
CRAN ou CRAM. Les jardiniers donnenrgéné-
ralemenf ce nom au Cocfilearia. L. Voyez Cr an -
son ruftique. ( M. Re yr ier . )
CRANSON, CocwiEAfliji.
Genre de plantes à fleurs polypétalées, de la
famille des Ç r t jc if è r e s , qui comprend des
herbe? indigènes de l’Europe •, à feuilles alternes..
Lçs fleurs, font en grappes terminales &
latérales. Les filicules font enflées, à fuperfide
inégale- ; ou hériffée d’afpérités, partagées en
deux loges renfermant deux à quatre femences
ovales arrondies. Çe genre efl rangé dans la i5 ,e
claffe de Linné.
E j p è c c s .
i. C ranson officinal, vulgairement l’herbe aux
cueillèrs.
Cochieakja officinalif. L. 0 , de la Suiffe,
xf. Cransoisi Danois. -, - .
CocnzEARiADanica. L .© , çf du Danemarck,
de la; Suède.
3. Cr a n s o n 'd’ÀBgleterre.
Cochzearia Anglica, L d’Angleterre, fur
lçs bords de . la. mer.
4. Ç lanson .de Groenland,
CoçMLfARiA Grocnlanélica. L. © du Groenland
, dé la Nprwège. ’
5. Grançon corne de cerf.
CocHzÉARiA coronoçus. L. © de fÊurope,
de la France. 1
6. C ranson de roche.
Cocuf,Ea r ia faxatilis., La )M. Diéh flo.T fi.
i 5o?.- 4 , T) fur les. rochçrS; des Provinces mérir
: fiionales de la France , d’Italie,
; .7. Cranson aurjculé.
Çochïbaria auriçulata, La Mart. Diéh dç
l’Auvergne.
8. C ranson
J M
8. Cranson dravier.
Cocuzearia draba. L. h du Midi de la
France, d’Italie.
p* C ranson à feuilles de paftel.
j „ c? f EARIA glajiifolia. L. n* des environs
de Ratilbonne.
ïo. Cranson ruftique. Cram ou Moutarde des
Capucins.
Cochxraria armoracia. L. h , en France fur
les bords des ruiffeaux.
Defcripùon du port des Efpèces en général
* & en particulier.
Les huit premières efpèces de ce genre font
toutes de petites plantes, herbacées, rampantes,
qui viennent à Fombre y dans les lieux humides
qt incultes , fur les bords de la mer, notamment
dans les endroits quelle baigne & quelle Iaifle
a lec alternativement.
L efpèce, n.° efl la plus connue fous fo n ,
nom lann Cochlearia, ce qui nous, difpenfera
d en donner la dèfcription ; nous en parlerons
P ° j f j.a cuflore & pour fes propriétés. .
1 ?-pèçe n.° 9 , efl la plus grande. Elle s’élève
f Ue^ 3 a 5 pieds. Sa tige efl droite,
remuée, cylindrique , glabre, munie de rameaux
11mpies. Ses feuilles inférieures font oblongues,
rétrécies en pétiole à leur bafe. Les autres font
en coeur,fagirtées, amplexicaules, d’une couleur
glauque. Les fleurs font blanches, petites, en
grappes courtes’ & alternes, formant une pani-
cule alongée & terminale. Il leur fpccède des
îhciileë , globuleufes, remplies de femences ron-
des. h ile fleurit en Mai, & perfectionne fes graines
en Juillet & Août. "
î ^- CRANSON, ruflique. Sa racine efl fort
grolle, longue, blanche, rampante. Sa tige efl
naute de 2 pieds, droite, cannelée, rameufe au :
iommer. Ses feuilles radicales font droites, très- i
grandes pétiolées-, oblongues, glabres & ner-
veules. Les fupërieures font longues & étroites.
I-.es fleurs font blanches, petites, difpofées en
grappes lâches & terminales. Les filicules font
enflées & prefque globuleiifes.
Culture. Toute? les efpèces de Cran fon n’ont
aucun agrément, elles n’aiment que les lieux ombrages,
ou les bords de la mer, & fe trouvent rarement
dans les jardins, même dans ceux de
■Botanique. Elles ont toutes à-peir-près les mêmes
propriétés, que celle? que l’on reconnoît
au Cranfon omcinal. '
Comme cette efpèce efl d on très-grand ufage,
nous en donnerons la culture particulière.
. ^ confifle à choifîr une platte-bande, ou
planche au nord, à l’ombre dans une terre hu-
; longue à volonté, large de 3 pieds. On
ƒ creip e ea forme d’auge, creux de 6 pouces
leron & on y leme les gr-aines en Juillet, c’eft
4 - dire aufli-.tôt quelles font mûres, ou tout au
Agriculture. Tome XII.
C R A 64.11
1 plus tard en Automne, parce qu’elles lèvent mieu»
| qu’en les femant au Printems. Quand les plantes
. feront affêz fortes, on les éclaircira en les ef-
paçant de quatre pouces en tout fens, & on les
tiendra nettes de mauvaifes herbes. Les jeunes
plants qu’on en tirera pourront être repiqués
ailleurs. Si la planche n’efl pas affez humide
par elle-même, ou que l’année foit lèche, on
y conduira l’eau par une rigole ou par tout autre
moyen, & cette eau reçue & féjournant dans les
creux de la planche, y entretiendra l’humidité
néceffaire pour l’accroiffement ’ & la conferva-
tion du jeune plant. Dans de nouveaux befoins,
on commencera la même irrigation. Le plan
deviendra- fort & fera en plein rapport an
Printems. La racine de cette plante efl fibreufe,
elle produit plufieurs, feuilles rondes , fuccu-
îentes & concaves comme une cuiller: fes tiges
ont fix pouces on un pied de hauteur, elles
font fragiles & garnies de feuilles oblongues &
dentées, ce font ces fn iille s, ces tiges qu’on
emploie. Comme on les cueille fouvent, cette
plante, quoiqu’annuelle, dure plus d’un an,
Les tiges qu’on iaiffera monter donneront des
fleurs en Mai & des graines en Juin qui fervix
ront à renouveller le plant tous les ans.
9. Cranfon, à feuille
tiplie par fes graines qu
de paflel. Elle fe mul-
réufliffent mieux femées
en Automne. On les éclaircit, on les farcie &
on les met en place au Printems. Il efl cependant
mieux de les femer , où l’on veut les avoir.
10. Cranfon ruflique, vulgairement le grand
raifort, raifort Jauvage. Cette efpèce fe nui!ri-»
plie par les bourgeons qu’on prend autour des
vieille? racines, en Oélobre pour les terreins
feçs, en Février pour les terreins humides. Il
faut défoncer le terrein de deux fers de bêche,
y faire une rigoler de dix pouces de profondeur
, dans lefquels on place les bourgeons à
5 ou 6 pouces de diflance en tout fens : à côté
de cette rigole, on en fait une fécondé, troi—
flème &c. . . , La plantation faite on remplie
les rigoles St on remet les terres & le terrein
de niveau. On a foin de tenir les plantation»
nettes de mauvaifes herbes. De cette manière
lés racines feront longues , droites, fans aucune»
petites racines latérales ; & propres deux ans
après pour l’ufage. On pourrait même s’en fervir
au bout d’un an , mais le rapport feroit beaucoup
moindre , tandis qu’il fera doublé à la fe~î
condç année fi le tçrrein efl riche & fort,
Ufages.
Diéconomi L’ufage du Cranfon officinal efl
très-fréquent fur-tout dans les maladies anti-
feorbutiques. Il s’en fait une très-grande c o n -
fommation dans certains hôpitaux , où on le
cultive en grand félon la méthode .gue nous
avons indiquée. Cette plante efl apéritive, diu—,
M ni m ni
M H