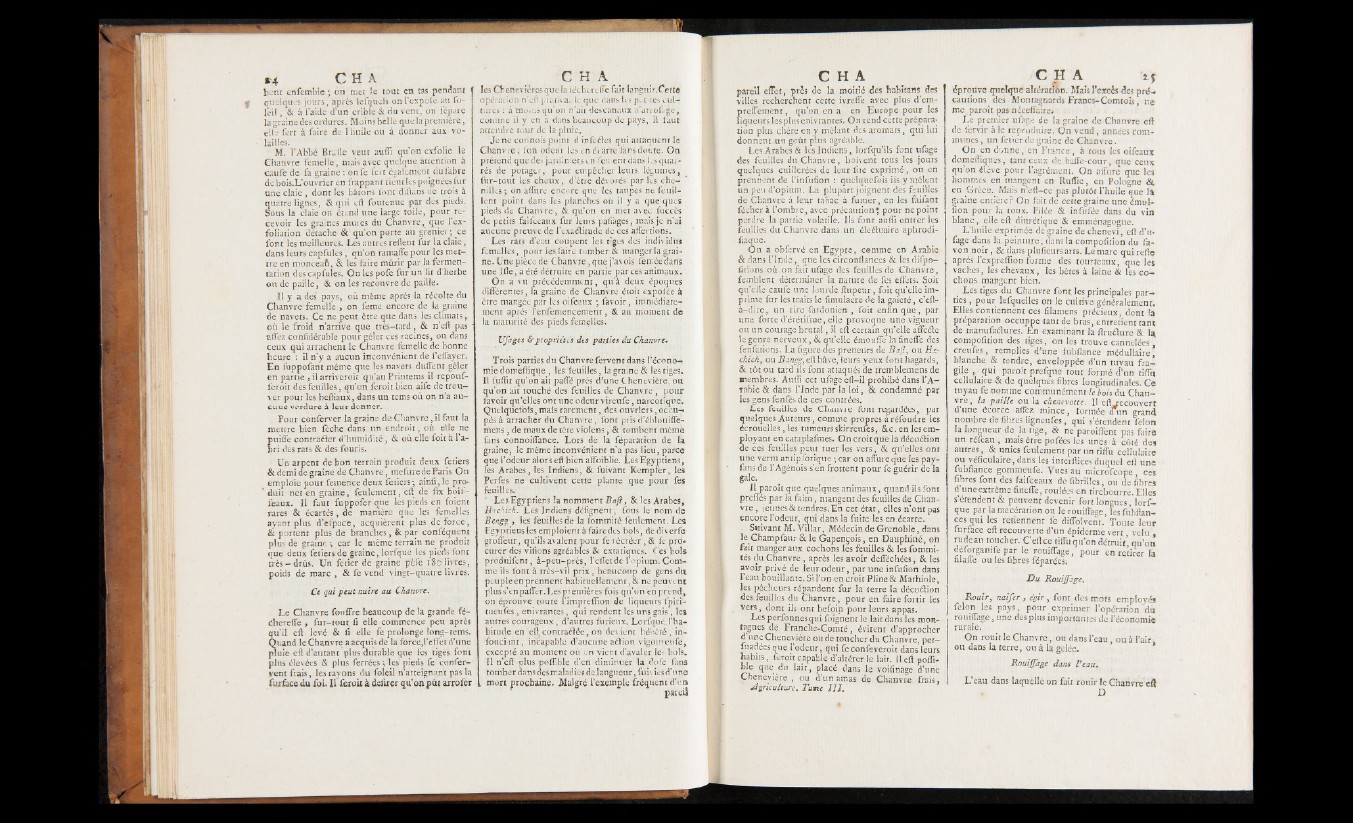
»4 C H A
bent enfemble • on met le tout en tas pendant
quelques jours, après lefquels on Fexpoie au fb-
le il, & à i’aicle d’un crible &. du vent, on l'épare
la graine des ordures. Moins belle que la première,
elle fert à faire de l’huile ou à donner aux volailles.
M. l’Abbé Bralle veut aufli qu’on exfolie le
Chanvre femelle, mais avec quelque attention à
caufe de fa graine : on fe fert également du labre
de bois.L’ouvrier en frappant tient les poignées fur
une claie , dont les bâtons font diftans de trois à
quatre lignes, &. qui <~ft foutenue par des pieds.
Sous la claie on étend une large toile, pour recevoir
les graines mures du Chanvre, que l’ex-
foliation détache & qu’on porte au grenier ; ce
font les meilleures. Les autres relient lur la claie,
dans leurs capfules, qu’on ramafle pour les mettre
en monceaft, & les faire mûrir par la fermentation
des capfules. On les pofe fur un lit d'herbe
ou de paille, & on les recouvre de paille.
11 y a des pays, où même après la récolte du
Chanvre femelle , on leme encore de la graine
dé navets. Ce ne peut être que dans les climats,
où le froid n’arrive que très-tard, & n’efl pas ■
affez confidérable pour geler ces racines, ou dans
ceux qui arrachent le Chanvre femelle de bonne
heure : il n’y a aucun inconvénient de i’effayer.
En fuppofant même que les navets duffent gêler
en partie , il arriveroit qu’au Printems il repouf-
l'eroit des feuilles, qu’on feroit bien aife de trouver
pour les befiiaux, dans un tems où on n’a au-
cuue verdure à leur donner.
Pour conferver la graine de Chanvre, il faut la
mettre bien fèche dans un endroit, où elle ne
puifle contrarier d’humidité, & où elle foit à l’abri
des rats & des fouris.
Un arpent de bon terrain produit deux fetiers
& demi de graine de Chanvre, mefurede Paris. On
emploie pour femenee deux fetiers; ainfi, le pro-
* duit net en graine, feulement, eft de fix boif■-
féaux. 11 faut fuppofer que les pieds en foient
rares & écartés, de manière que les femelles
ayant plus d’efpace, acquièrent plus de force,
& portent plus de branches, & par conféq.uent
plus de graine *, car le même terrain ne produit
que deux fetiers de graine, lorfque les pieds font
très-drùs. Un fetier de graine pèfe 180 livres,
poids de marc , & fe vend vingt-quatre livres.
Ce qui peut nuire au Chanvre.
Le Chanvre fouffre beaucoup de la grande fé-
cherefle , fur-tout, fi elle commence peu après
qu’il eft levé & fi elle fe prolonge long-tems.
Quand le Chanvre a acquis de la force,l’effet d’une
pluie eft d’autant plus durable que fes tiges font
plus élevées & plus ferrées ; les pieds fe' çonfer--
yent frais, les rayons du foleil n’atteignant pas la
fvixftce du fol. Il feroit à defirer qu’on pût arrofer
les Cfcenevi’ères que la lècherefle fait languir.Ceftô
opération n’cft praticable que dans k s p^ t tes cultures
: à moins qu’on n’ait descanaux a’arrofsge,
comme il y en a dans beaucoup de pays, il faut
attendre tour de la pluie.
Je ne connois point dinfeéles qui attaquent le
Chanvre ; Ion odem les en écarte fans doute. On
prétend que des jardiniers en fen entdans l.squar-
rés de potager,, pour empêcher leurs légumes,
fur-tout les choux, d’être dévorés par les chenilles
; on aflure encore que les taupes ne fouillent
point dans les planches où il y a quelques
pieds de Chanvre, & qu’on en met avec fuccès
de petits faiiceatix fur leurs palîàges, mais je n’ai
aucune preuve de l’exaélimde de ces alfertions.
Les rats d’eau coupent les tiges des individus
femelles , pour les faire tomber & manger la graine.
Une pièce de Chanvre, que j’avois fenvée dans
une Jfle, a été détruite en partie pàrceS animaux.
On a vu précédemment, qu’à deux époques
différentes, la graine de Chanvre étoir expofée à
être mangée par les oifeaux ; favoir, immédiatement
après l’enfemencement, & au moment de
la maturité des pieds femelles.
Vfages & propriétés des parties du Chanvre.
Trois parties du Chanvre fervent dans l’écono-r
mie domeftique , les feuilles, la graine & les tiges.
Il fuffit qu’on ait paffé près d'une Chenevière, ou
qu’on ait touché des feuilles de Chanvre , pour
lavoir qu’elles ont une odeur vireufe, narcotique.
Quelquefois, mais rarement, des ouvriers, occupés
à arracher du Chanvre , font pris d’éblouiffe-
mens, de maux de tête violens, & tombent même
fans connoiffance. Lors de la féparation de la
graine, le même inconvénient n’a pas lieu, parce
que l’odeur alors eft bien affoiblie. Les Egyptiens,
les Arabes, les Indiens, & fuiv'ant Kempfer, les
Perfes'ne cultivent cette plante que pour fes
feuilles.
‘ Les Egyptiens la nomment Bafi, & les Arabes,
Hrchich. Les Indiens défignént, fous le nom de
Beng\y , les feuilles de la fommité feulement. Les
Egyptiens les emploient à faire des bols, de diverfe
groneur, qu’ils avalent pour fe récréer, & fe procurer
des vifions agréables & extatiques. C es bols
produifent, à-peu-près, l’effet de l’opium. Comme
ils font à très-vil prix, beaucoup de gens du
peuple en prennent habituellement, & ne peuvent
plus s’en paffer. Les premières fois qu’on en prend,,
on éprouve toute l’impreflion de liqueurs fpiri-
tueufes , enivrantes, qui rendent les uns gais , les
autres courageux, d'autres furieux, LorfqutU’ha-
bitude en eft, contrariée, on devient hébété , in-
fouci-snt, incapable d’aucune aélion vigoureufe,
excepté au moment où en vient d’avaler t e bols.
Il n’eft plus pofllble d’en diminuer la do le fans
tomber dans desmaladies delangueur, fui\ iesd’une
, mort prochaine. Malgré l’exemple fréquent d’c.n
pareil effet, près de la moitié des hahitatis des
villes recherchent cètte ivreffe avec plus d’em-
preffement, qu’on en a en Europe pour les
liqueurs les plus enivrantes. On rend cette préparation
plus chère en y mêlant des aromars, qui lui
donnent .un goût plus agréable.
Les Arabes & les Indiens, lorfqu’ils font ufage
des feuilles du Chanvre, boivent tous les jours
quelques cuillerées de leur lue exprimé, ou en
prennent de Finfufion : quelquefois ils y mêlent
un peu d’opium. La plupart joignent des feuilles
de Chanvre à leur tabac à fumer, en les faifant
fécher à l’ombre, avec précaution* pour ne point
perdre la partie volatile. Ils font auftt entrer les
feuilles du Chanvre dans un éleéhiaire aphrodi-
- fiaque.
On a obfervé en Egypte, comme en Arabie
& dans l’ Inde, que les circonftances & les difpo-
firions où on fait ufage des feuilles de Chanvre,
femblent déterminer la nature de fes effets. Soit
qu’elle caufe une lourde ftupeur, foit qu’elle imprime
fur les trairs le fimulacre de la gaieté, c’eft-
à-dire, un rire fardonien , foit enfin que, par
une forte d’érétifrae, elle provoque une vigueur
ou un courage brutal, il eft certain qu’elle affeéle
le genre nerveux, & qu’elle émouffe la fineffe des
fenfations. La figure des preneurs de Bafl, ou Hs.-
ckich, ou Banggs eft hâve, leurs yeux font hagards,
& tôt ou tard ils font attaqués de tremblemens de
membres. Auffi cet ufage efi-il prohibé dans l ’Arabie
& dans l’Inde par la loi, & condamné par
les gens fenfés de ces Contrées. „
Les feuilles de Chanvre font regardées, par
quelques Auteurs, comme propres-à réfoudre les
écrouelles, les tumeurs skirreules, &c. en les employant
en cataplafmes. On croit que la décoélion
de ces feuilles peut tuer les vers, & qu'elles ont
line vertu an tip Torique ; car on allure que les'pay-
fans de l’Agénois s’en frottent pour fe guérir de la
gâte :..
II paroît que quelques animaux, quand ils font
preffés par la faim, mangent des feuilles de Chanvre
, jeunes & tendres. En cet état, elles n’ont pas
encore l’odeur, qui dans la fuite les en écarte.
Suivant M. Villar, Médecin de Grenoble, dans
le Champfaur & le Gapençois, en Dauphiné, on
fait manger aux cochons les feuilles & les fommi-
tés du Chanvre, après les avoir defféchées, & les
avoir privé de leur odeur, par une infufion dans
l’eau bouillante. Si l’on en croit Pline & Mathiole,
les pêcheurs répandent fur la'terre la décoélion
des feuilles du Chanvre, pour en faire fortir les
vers, dont ils ont befoin pour leurs appas.
Les perfonnesqui foignent le lait dans les montagnes
de Franche-Comté, évitent d’approcher
d une Chenevière onde toucher du Chanvre, per-
luadées que l odeur, qui feconfeveroit dans leurs
habits, feroit capable d’altérer le lait. Il eft poffi-
ble que du lait, placé dans le voifinage d’une
Chenevière , ou d’un amas de Chanvre frais,
Agriculture. Tune JJ J.
éprouve quelque altération. Mais l'excès des précautions
des Montagnards Francs-Comtois, ne
me paroît pas néceftbire;
Le premier ufage de la graine de Chanvre eft
de fervir à le reproduire. On vend, années communes,
un fericrde graine de Chanvre.
On en donne, en France, à tous les oifeaux
domeftiques, tant ceux de.baffe-cour, que ceux
qu’on élève pour l’agrément. On affure que les
hommes en mangent en Ruflie, en Pologne &,
en Grèce. Mais n’eft-ce pas plutôt l’huile que lâ.
graine entière? On fait de cette graine une émul-
fion pour la toux. Pilée & infufée dans du vin
blanc, elle eft diurétique & emménagogue.
L ’huile exprimée de graine de chenevi, eft cTu«
fage dans la peinture, dans la compofition du fa-
von noir, & dans plufieitrsarts. Le marc qui refte
après l’expreffion forme des tourteaux, que les
vaches, les chevaux, les bêtes à laine & les cochons
mangent bien.
Les tiges du Chanvre font, les principales parties
, pour lefquelles on Je cultive généralement.
Elles contiennent ces filamens précieux, dont la
préparation occuppe tant de bras, entretient tant
de manufaélures. En examinant la ftruélure &
compofition des tiges, on les trouve cannelées
creufes, remplies d'une fubftance médullaire*
blanche & tendre, enveloppée d’un tuyau fragile
, qui paroît prefque tout formé p u à tiffu
cellulaire &d e quelques fibres longitudinales. Ce
tuyau fe nomme communément le bois du Chanvre
, la paille ou la chenevotte. Il eft recouvert
d une écorce allez mince, formée cPun grand
nombre de fibres ligneufes, qui s’étendent félon
la longueur de la tige, & ne paroiffent pas faire
un réfeau , mais être pofées les unes à côté des
autres , & unies feulement par un tiffu cellulaire
ou véficulaire, dans les imerftices duquel eft une
fubftance gommeufe. Vues au microfcope, ces
fibres font des faifeeaux de fibrilles , ou de fibres
d’une extrême fineffe, roulées en tirebourre. Elles
s’étendent & peuvent devenir fort longues, lorfque
par la macération ou le rouiffage, les fubfian-
ces qui les retiennent fe diffolvent. Toute leur
furface eft recouverte d’un épiderme vert, velu ,
rude au toucher. C’eftce tiffu qu’on détruit, qu’on
déforganife par le rouiffage, pour en retirer la
fiiaffe ou les fibres féparées;
Du RouiJJ'age.
Rouir, naifer , égir, font des mots employés
félon les pays, pour exprimer l’opération 'du
rouiffage , une des plus importantes de l’économie
rurale.
On rouit le Chanvre, ou dans l’eau, ou à l’air.
ou dans la terre, ou à la gelée.
Rouijfage dans Veau.
L’eau dans laquelle on fait rouir le Chanvre cil
D