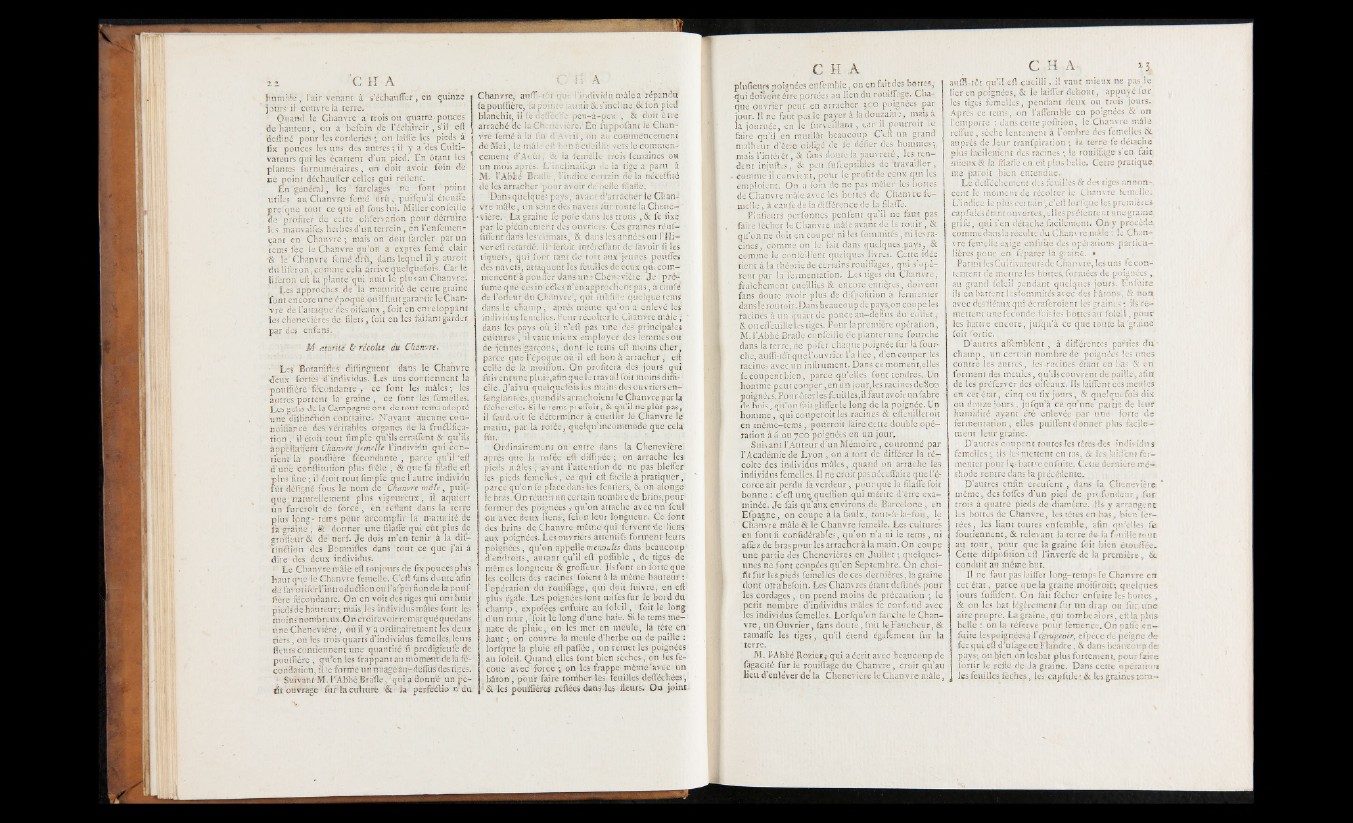
1 1 C |i A
humide, l'air venant à s’échauffer, en quinze
jours il couvre la terre.
• Quand le Chanvre a trois ou quatre-pouces
de hauteur, on a befôin de l’éclaircir , s’il eft |
Üeftiné pour les corderiés-', on taille les pieds à
fix pouces les uns des autres*, il y a des Culti-
vateurs qui les écartent d’un pied. En ôtant les
plantes i’urnuméraires , on doit avoir foin de
ne point déchauffer celles qui relient.
En général , lesv farci âges ne font poin t
utiles au Chanvre femé drû, pu'ifqu’il étouffe |
prelque tout ce qui eft fous lui. Miller conleille «
de profiter de cette obfervation pour détruire
ks mauvaifés herbes d’un terrein , èn l’enfemen-
cant en Chanvre ; mais on doit farder par un
rems fec le Chanvre qu’on a exprès femé clair
■ & le' Chanvre femé dru, dans lequel il y aurait
du liferon, céiraie cela arrive quelquefois. Car le
iiferbli efi ta plante qui nuit le plus au Chanvre:
Lès approches fté la maturité de cette graine
font encore une époque où il faut garantir le Chanvre
de l’attaque des oiféaux , foit en enveloppant
les chenevières de filets, foit en les faifantgarder,
par des enfans.
M aturité & récolte du Chanvre.
• Les Botanistes distinguent dans le Chanvre
deux fortes d’individus.. Les uns contiennent la
poufitère fécondante » ce font les mâles -, les
autres portent la - graine , ce font les femelles.
Les gehs de la Campagne ont de tout teins adopté
une difiindidn contraire- N’ayant aucune con-
nôifiance des; véritables organes de là fructification
, il étoît tout Simple qu’ils erraffent & qu’ils
àppèîiaffent Chanvre femelle l’individu qui contient
la ppufîiè.re fécondante , parce' qu’il *eft
d’une conftmnion plus frêle , & que fa filaffe eft
plus fine ; il étoit tout (impie que l'autre individu
fût déligné fous le nom cîe Chanvre mâle, puif-
que; naturellement plus vigoureux , il aquiert
un furcrôit dé force , en reftant dans la terré
plus! long- terns pour accomplir la maturité de
fa graine , & ’ donner, une filaflæ qui eût .plus de
groffeur & de nerf. Je dois m’eù tenir .à la dif-
tinClibn des Botaniftes dans tout ce que j’ai à
dire des', deux individus.
: Le Chanvre mâlè eft toujours de fix pouces plus
haut que le Chanvre femelle. C’eft fans doute afin
de favoriferrintroduCïion ou I’àfpéffiQn de la; pouk
fière fécondante. On en voit des tiges qui ont hüit
pieds de hauteur ; mais, lès individus mâles font les
moins1 .nombreux .On crôiravoirfemarquéquédans'
line Chenevière , où il y a ordinairement les deux
tiers, ou les trois quarts d’individus femelles, leurs
fleurs contiennent une quantité ft prodigieufe de
pouffière , qu’en lés frappant au moment de la fécondation,
il fe formé un miageâu-deffuS des tiges:"
‘ Suivant M. FAJibé Brâfle, qui a domië un p'e--
è t ouvragé fur la culture ■ & la perféètio n du
Chanvre, aufli-tét que i individu mâle a répandu
fa pouffière, fa pointe jaunir&s’inci:ne1&’ (on pied
blanchit, il fe deffèdîe peu-â-peu , & doit être
arraché de la Cheuev sere. En fuppofant le Chanvre
femé à la iin d’Avril, ou au commencement
de M ai, le mai : eft bon à cueilliç vers le commencement
d’A eût, & la feméile trois femaines ou
un mois après. L inclinaifivn >!e la tige a paru à
M. l’Abbé Brade, i’indicé certain de la néceffité
de les arracher pour avoir de'belle filafie.
Dans'quelques pays, avant d’arracher le Chanvre
mâle, on sèiné des navets fur routé la Chetic-
• vière. La graine fe poi'e dans les trous , & fe fixe
par le piétinement des ouvriers. Ces graines rëuf-
(iffent dans les‘climats, & dans les années ou l’Hiver
eft retardé. Il ’ferbit intéreffant de lavoir li les
tiquets, qui font tant de tort aux'jeunes poulies
des navets, attaquent les feuilles de ceux qui commencent
à pouffer dans une Chènevièr.e. Je préfume
que ces imèéles,n’en approchent pas, â caufé
de l’odeur du Chanvre’“, qui fubfiiîè quelque te ms
danis le champ , après même qu’on a enlevé les1
individus femelles.. Pour récolter le Chanvre mâle ; '
dans lès pays où il n’eft pas une dés principales
cultures', il vaut mieux employer des femmes ou
de jeunes'garçons,. dont le tems eft moins cher,
parce que l’époque où il eft bon à arracher , eft
celle -de là moiflon. On profitera dès jours qui
fuiventunepluie,afin que le travaillait moins difficile.
J ’ai vu quelquefois les mains des ouvriers en-
fenglantéès,quand fis arrâchoienr le Chanvre par la
fëchereffe. Si le tems preffoit, & qu’il ne plût pas ,
il faudrait fé déterminer à cueillir lé Chanvre le
matin, par la rofée, quelqu’incommodé que cela
fût.O
rdinairement on entre dans la Chenevière!
après que la rofée efkdiffipée on arrache les
pieds mâles ; ayant l’attention de ne pas bleffer
; les pieds femelles, ce qui eft facile à pratiquer,
parce qu’on fe place ft ans les fentiers, & on alonge
i le bras. On réunit un certain nombre de brins,pour
; former des poignéesqu’on attache avec ira feûl
; ou avec deuk liens-,félon leur longueur. Ce font
des brins de Chanvre même' qui fervent de liens
aux poignées. Les ouvriers attentifs foraient leurs
poignées , qu’on appelle menoults dans beaucoup
d’endroits, autant qu’il eft poffible , de-tiges de
mêmes longueur & groffeur. ïlsfont èn forte que
lés Collets dés racines'foient à la même hauteur :
l'opération du rouiffage, qui doit fuiyre, en eft
plus.ëgale. Lés poignées lont miles fur le bord du
j champ, expoféesènfuire au (oleih, foit le long
, d’un mur, foit le'long d’une haie. Si le tems me-'
naee de pluie-,' on les met en meule, la tête en
haut ; on couvre la meule d’herbe ou de paillé :
lorfque la pluie eft paffée, on remet les poignées
au foleil. Quand elles lont bien sèches-, on les fe-
coue avec forcé ; on les frappe même 'avec- un
bâton, pour faire tomber lès- feuilles 'deflîéchées ,
* & ;ies pouffîèrég reftées dans les fleurs. Ou joint
C H ,A
pîufieurs poignées enfemble, on en fai t des botte-S;
qui doivent être portées ail lien du rouiffage. Chaque
ouvrier peut en arracher 3e0 poignées par
jour. 11 né faut pas. le payer à la douzaine, mais à
la journée, en le furvëiHant, car il pourrait le
faire qu’il en mutilât beaucoup C eft un grand
malheur d’être obligé de fe défier des hommes j,
maïs 1’intérêt, Si fans doute- la pauvreté, les rendent
injuftes, & peu .lûfceptibles de travailler ,
. comme il convient, "pour le profit de ceux qui les
emploient. On a foin de ne pas mêler les bottes
de Chanvre mâle avec-les .bottes de Chanvre femelle
, à caufe de la différence de la filaffe.
Fiufieurs perfonnes penfent qu’il ne faut pas
faire fécher le Chanvie mâle avant de le rouir, &
qu’on ne doit en cotipér ni les fommités, ni 1 enracines.,
comme on le fait dans quelques,pays, &
comme le confeillent quelques livres. Cette idée
tient à la théorie de certains rouillages, qui s opèrent
par la fermentation. Les tiges du Chanvre,
fnüchement cueillies & encore entières-, doivent
fans doute avoir plus de dlfpofition à fermenter
danslerquroir. Dans beaucou p de pays,on coupé les
racines à un qü.art de pouce au-dèffüs du collet ,-
& on effeuille les tiges. Pour la première opération,
M. l’Àbhé Brafle confeillç c!e planter une fourche
dans la terre, de pôfer chaque poignée fur la fourche,
aufli-tÔt que l’ouvrier l’a liée, d’en couper les
racines avec un infiniment. Dans ce moment,elles
fe coupent bien, parce qu’elles font tendres. Un
homme peur couper, en un jour, tes racines de 800 ;
poignées.Pour ôtet les feuilles,il faut avoir unfabre
de bois * qu on fait gliffer k long de la poignée. Un
homme , qui couperait les racines & effeuillerait
en même-teins, pourrait faire cette double opération
à o 0117QO poignées en un jour.
Suivant l’Auteur d’un Mémoire, couronné par
l’Académie de Lyon , on a tort de différer la récolte
des individus mâles, quand on arrache les
individus femelles. 11 ne croit pas ncceffaire que l’écorce
ait perdu fa verdéur, pour que la filaffe foie
bonne : c’eft une,queftion qui mérite.d'être examinée.
Je fais qu’aux environs de Barcelone , en
Efpagne,.on coupe à la faulx, tout-à-la-fois, le
Chanvre mâle & le Chanvre femelle. Les cultures
en font fi confidérables, qu’on n’a ni le tems, ni
allez de bras pour les arracher a la main. On coupe
une partie des Chenevières en Juillet ; quelques-
unes ne font coupées qu’en Septembre. On choi-
fitfiir les pieds femelles de ces dernières, la graine
dont onabefoin. Les Chanvres étant deftinés pour
les cordages, on prend moins de précaution ; le
petit nombre d’individus mâles fe confond avec
les individus femelles. Lorfqu’on fauche le Chanvre,
un Ouvrier, fans doute, fuit le Faucheur, &
ramaffe les tiges, qu’il étend également fur la
terre.
M. lAAbbé RozieEÿ-qui a écrit avec beaucoup de
fâgacité furie rouiffage du Chanvre, croir qu’au
heu d’enlever de la Chenevière le Chanvre mâle,
C H A H
aufS-tôt qu’il eft cueilli, il vaut mieux ne pas le
lier en poignées, & le laiffer debout, appuyé fur
les tiges femelles, pendant deux ou trois jours.
Après ce rems, on l’affemble en poignées Si on
l’emporte : dans cette pofition, le Chanvre mâle
reflue, sèche lentement à l’ombre des femelles &
auprès de jeu r rranfpiration ; la terre fe détache
plus fiicilejiient des racines ; le rouiffage s’en fait
mieux & la fîiaffe en eft pins belle. Cette pratique
me paraît bien entendue.
Le defféchemenr des feuilles & des tiges annoncent
le moment de récolter le Chanvre femelle.
L’indice le plus certain, c’ell lorfque ks premières
capfulës étant ouvertes, elles p ré (en ter t une graine
grife, qui s’en détache facilement. On y procède
commedansia récolte du Chanvreptâle : le Chanvre
femelle exige enfuite des opérations particulières
pour en fé parer la graine. •
Parmi les Cultivateurs de Chanvre, les uns ie contentent
de mettre lès bottes, formées de poignées
au grand foleil pendant quelques jours. Enfuite
ils en battent les fommités avec des bâtons, & non
avec des'flëaux qui écraferoient les graines : ils remettent
une fécondé fois ks bottesau foleil, pour
les battre encore, jufqu’à ce que toute la'graine
foit foftie.,
D’autres affemblent , à différentes parties du •
champ , un certain nombre de poignées lès unes
contre les autres, ks -racines étant en bas & en
forment des. meules, qu’ils couvrent de paille, afin
de les préferver des oiféaùx. Ils 1 aillent ces meules
en cet état j cinq ou fix jours, & quelquefois dix
i" ou douze jours, jufqu’à ce qu’une pas tic de leur
| humidité ayant été enlevée par une forte de
fermentation, elles puiffentdonner plus facilement
leur graine.
D’autres coupent toutes tes tête-s des individus
femelles,*, ils les mettent en tas, & les? lai-lient fermenter
pour l^s battre ,enfui te. Cette dernière méthode
rentre dans la précédente.
D’autres enfin c renient , dans la Chenevière
même-,, des foflès d’un pied de profondeur , fur
trois à quatre pieds de diamètre. Ils- y arrangent
les bottes de Chanvre, les têtes en bas, bien ferrées
, les liant toutes enfemble, afin qu’elles fe
fou tiennent, & relevant la terre de-la fouillé tout
au tour, pour que la graine foit bien étouffée-
Cette difpofition eft l’inverfe de la première , 6c
conduit an même but.
Il ne faut pas laiffer long-temps le Chanvre en
cet état, parce que la graine moifiroit; quelques
] jours fuffifenr. On fait fécher enfuite les bottes,
; & on les bat légèrement fur un drap ou fiir, une
’ aire propre., La graine, qui tombe alors, eft la plus
• belle : on la réferve pour feraer.ee. On paffe en -
fuite lespoiguéesà l'égrügeoir, efpèce de peigne de
fer. qui eft d’ufage..en Flandre, & dans beaucoup de
pays; ou fiien on ks bat plus fortemen t, pour faire
fortir le refle de ,1a graine. Dans cette opératror»
( les feuilles fèches, les cap fuie? & les graines tom—