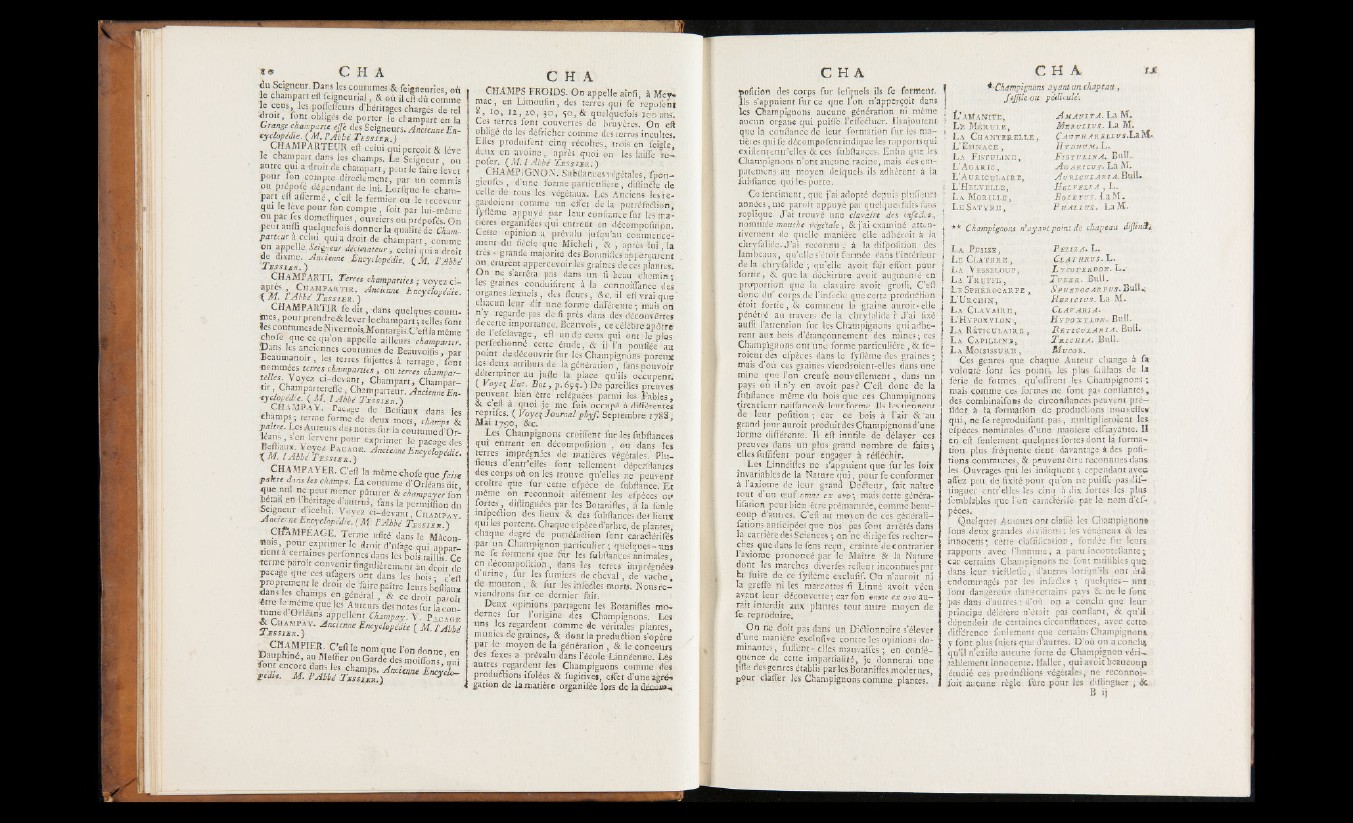
•du Seigneur. Dans les coutumes & feigneuries où
le champart eft feigneuriai, & où il elt dû comme :
If c.eDS:$. ^cs P°^ueurs ^héritages chargés de tel
■ droit, font obligés de porter le champart en la
tr range champ cru. ejfe des Seigneurs. Ancienne Encyclopédie.
(_M. l’Abbé Tessier, )
CHAMPARTEUR eft celui qui perçoit & lève
le champart dans les champs. Le Seigneur, ou
autre qui a droit de champart, peut le faire lever
pour ion compte directement, par un commis
ou prépoft dépendant de lui. Lorf'que le champart
eft affermé, c'efl le fermier ou.le receveur
qui le levepour (on compte , foit par lui-même
ou par (es dorocfliqjies, ouvriers ou prépofés. On
peut aiiiii quelquefois donner la qualité de Chain- \
paru ur a celm qui a droit de chatppàrt, comme
on appelle Seigneur décimateur, celui quia droit
de dixme. Ancienne Encyclopédie. (M l ’Abbé •
T essier.') *
CHAMPARTI. Terres champ ani es ; voyeze'-
Eac* cw dk-
CHAMPARTJR Ledit, dans quelques coutumes
, pour prendre & lever le champart ; telles font
les coutumes de Nivernois,Montargis.C,e(l la même '
chofe que ce qu on appelle ailleurs champarter.
Vans les anciennes coutumes de Beauvoifis, par '
Æeaumanoir, les terres fujettes à terrage, font :
■ nommées terres champarcies , ou terres champar-
ulles Voyez ci-devant, Champart, Champar-
f " ^ 3mparteur. Ancienne Encyclopedce.
( M. t Abbé Tessier. )
, h ^ MPAY' / aca"e de Befliaux dans les
champs, terme formé de deux mots, champs &
paître. Les Auteurs des notes fur la coutume d'Or-
Jéans, s en fervent pour exprimer le pacage des I
1“ “ K “ " Ancienne Encyclopédie. ;
CHAMP AYER. C’efl la mêmechofe que faire
paître dans les champs. Lacontume d'Orféans dit
que nul ne peut mener pâturer & champayer fon
bétail en 1 héritage d autrui, fans la penniffion du
Seigneur d »celui. Voyez ci-devant, Ctiampay.
Ancienne Encyclopédie. ( M . F Abbé Tessier.)
ClftiMPÉAGE. Terme ufité dans le Mâcon-
flots pour exprimer le droit d’ufage qui appar-
uent a certaines perfohnes dans lès bois taillis Ce
terme paroit convenir finguJiêremcnt .im droit de
p«c.tge que ces ufagers ont dans les bois- c’efl
proprement le droit de'fairepaître leurs h’eflianx
dans les champs en .général , & ce droit B Ï 3
f ^même que ks Auteurs des notes fur la cou-
tu me d Oéléa-ns appellent Chcmpay. Y . P * T “e
T essiV rF) Y' Ancume Encyclopédie ( M . l ’Abbé
CHAMPS FROIDS. On appelle aînft, à Meyv
mac, en Limoufin, des terres qui fe repofen»
8, io , 12, 20., 50, 50, & quelquefois-iôè ans.
Ces terres font couvertes de bruyères. On eft
obligé de les défricher comme des terres incultes.
Elles produilcnt cinq récoltés, trois en leigle,
deux en avoine, après quoi on les laiffe re-
pofer. ( M. I Abbé Tessier . )
CHAMPIGNON. Sufcilancesvégétales, fpon-
gieuies , d’une forme particulière, dillinéle de
celle dé tous les végétaux- Les Anciens les ’re-
gardoient comme un effet de la putréfaélion,
lyflême appuyé par leur confiance fur les matières
organifées qui entrent en décompofitipn.
Cette..opinion a prévalu jufqu’au commencement
du fiècle que Micheli, & , après lu i , la
très - grande majorité des Botanilles appèrgurént
oit crurent appercevoirles graines de ces plantes.
On ne ,5 arrêta pas dans un fi-beau chemin •
les graines conduilirenr a la connoiffance des
organes fexuels, des fleurs, &c. il eft vrai que'
chacun leur dit nue forme différente ; mais on
n’y regarderas de fi près dans dès découvertes
deceite importance. Bcâuvois, ce célèbre apôtre
de 1 efclavage, eft un de deux qui .ont: le plas
pericclionné cette étude, & il l’a poufléè au
point de découvrir fur les Champignons poreux
les deux atributs de la génération , fans pouvoir
déterminer au jufle la. place qu’ils occupent.
C *oye\ Eue. Bot 3 p. De pareilles preuves
peuvent bien être'reléguées parmi les Fables,
& ceft à quoi je me fuis occupé à différentes
repnfes. ( Voye^ Journal phyf. Septembre 1788,
Mai 1790, '&C.
Les Champignons croiffent fur k s fubflances
qui entrent en décompofîtion , ou dans ks
terres imprégnées de matières végétales. Plusieurs
d enrr’elles font tellement dépendantes
des corps où on les trouve qu’elles ne peuvent
croître que fur cette efpèce de fûbftance. Et
même on reconnoît aifément les efpèces 01*
fortes , distinguées par ks Botaniftes, à la feule
mfpeétion des lieux '& des fubflances des lieux
qui ks portent. Chaque efpèce d’arbre, de plantes,
chaque degré de putréfaction font cara&érifés
; !Par un Champignon particulier -, quelques-uns
■ ne fe forment que fur les fubflances' animales,
• en décompofîtion , dans les terres imprégnées
; dunne, fur les fumiers de cheval, de' vache,
de mou ton , & fur les iîife6ies morts. Nous re—
' -viendrons fur ce dernier fait.
Deux opinions partagent les Botanilles modernes
fur l ’origine des Champignons. Les
uns les regardent comme de véritales plantes,
munies de graines, & dent la production s’opère
par -le moyen de là génération , & le concours
des fexes a prévalu dans l’école Linnécnae. Lés
autres regardent les Champignons comme des
productions ifolées & fugitives, effet d’une agré-*
( gation de la matière organifée lors de ladécoiB^
pofitkn des corps fur lefquels ils fe forment.
Ils s’appuient fur ce que Ion n’apperçoit dans
k s Champignons aucune génération ni même
aucun organe qui puifle l’efleCtuer. Ils ajourent
que la confiance de leur formation fur ks matières
quife déçompofent indique les rapports qui
exiftententr’elles & ces fubflances. Enfin que les.
Champignons n’ont aucune, racine, mais des em-
patemens au moyen defquels ils adhèrent à la
fûbftance qui les porte.
Ce fèntiment, que j’ai adopté depuis plufieurs
années, me parolt appuyé par quelques faits fans
répliqué. J ’ai trouvé une clavaire des infedes.,
nommée mouche végétale, & j’ai examiné attentivement
de quelle manière elle adliéroic à la
chryfalide. J ’ai reconnu, à la difpofition des
lambeaux, qu’elle s’étoit formée dans [’intérieur
de la chryfalide ; qu’elle ayoit fait effort pour
for tir, & que la déchirure avoir augmenté en
proportion que la clavaire avoit grofli. C’efl
donc du' corps de l’infeCle que cette production
étoit fortie, & comment la graine auroit* elle
pénétré au travers de la chryfalide ? J ’ai fixé
auffi l’attention fur les Champignons qui adhèrent
aux bois d’étançonnement des mines; ces
Champignons ont une forme particulière , & fe~
roient des efpèces dans le fyfîême dos graines;
mais d’où ces graines viendroient-elks dans une
mine que l’on creufe nouvellement, dans un
pays où il n’y en avoit pas ? C’efl donc de la
fubfïance même du bois que ces Champignons
tirentkur naiffance& leurforme. Ils les tiennent
de leur pofition ; car ce bois à l’air & au
grand jourauroit produitdesChampigtsonsd’une
forme différente. Il eft inutile de délayer ces
preuves dans un plus grand nombre de faits $
ellesfuffifent pour engager à réfléchir.
Les Linnéiftes ne s’appuient que fur les loix
invariables de la Nature qui, pour fe conformer
à l’axiome de leur grand Pcéteur, fait naître
tout d’un oeuf omne ex ovo\ mais cette généra-
lifation peut bien être prématurée, comme beaucoup
d’autres.. C’eil au moyen de ces générali-
fations anticipées que nos pas font arrêtés dans
la carrière des Sciences ; qn ne dirige fes recherches
qùedans le fens reçu, crainte de contrarier
l’axiome prononcé par le Maître & la Nature
dont les marches diverfes relient inconnues par
te fuite de ce fyftême exclufif. On n’aurok ni
la greffe n ik s marcottes fi Linné avoit vécu
avant leur découverte; car fon emne ex ovoau-
rait interdit aux planres tout autre moyen de
fe reproduire.
5 doit pas dans un Diélionnaire s’élever
dune manière exclufive contre les opinions dominantes
, fuflen t - elles mauvaifes ; en confé— !
quence de cette impartialité, je donnerai une <
lifte des genres établis par les Botaniftes modernes,
pour claffer ks Champignons comme plantés*
Champignons ayant un. chapeau,
JeJJilc ou pédicule*
j L’AlfANlfE, A m an ita . La M.
: Le Mérui.e , jMervlivs. La M.
• L a Chanterelle,. Ca nth a r e h us. La M-
; L’Esinace Hydnum. L.
La F istulike, Fxstulina. Bull.
. L’Agarîc, A garicvss La M.
L’Auriculaire,. A uricul ARIA.
L ’Hllvelle, HszVELLA , L.
L a Morille, Boletus. LaM.
. Le Satyre - P hallus. LaM.
** Champignons n’ayaHpoint de chapeau diflinSi
La Pesise, Peziza. L.
L e Clatiire , Cla theus. L.
L a Vesseloup, L ycoperdow. L .
La Truffe,, v T uber. Bull..
Le Spherocarpe , Spherocarpus. Bull*;
L’Ur chin, ' Hericlus. La M*
La Clavaire, Cl AVAR! A a
L’Hypoxylon', Hypoxylon. Bull.
L à Réticulaire , B.eticulAr ia . Bull.'
L a Capilline, T r ich ia . Bull.
La Moisissure , Mu cor.
Ces genres que chaque Auteur change à fa
volonté font les points les plas faillans de la
férié de formes qu’offrent les Champignons ;
mais comme ces formes ne font pas confiantes,
des combinaifons de circoaftances peuvent pré—
fider à la formation de produèlions nouvelle«',
qui, ne fe reproduifant pas, mtiltiplierôicnt les
efpèces nominales d’une manière effrayante. II
en eft feulement quelques fortes dont la formation
plus fréquente tient davantage à des portions
communes , Sa peuvent être reconnues dans
les Ouvrages qui fes indiquent ; cependant avec
affez peu de fixité pour qu’on ne puifle pas distinguer
entr elles les cinq à dix fortes .ks plus
femblabks que l’on caracîérife par le nom d’ef»
pèces.
Quelques Auteurs ont clafié ks Champignons1
fous deux grandes divisons ; les vénéneux & les
innocens; cette clafEfication, fondée fur leurs
rapports avec l’homme, a paru incontefiante^
car certains Champignons ne font nuilibles que.
dans leur vieilleffe, d’aunes lorfqù’iis ont étà
endommagés par ks infe&s ; quelques- uns
font dangèreux dans certains pays & ne le font
pas dans d’autres : d’où on a conclu que leur
principe délétère n’étoit pas confiant, & qu’il
dépendoit de certaines circonftances, avec cette
différence feulement que certains Champignons
y font plus fujets que d’autres. D’où on a conclu
.qu’il n’èxifte aucune forte de Champignon v é r i tablement
innocente. Haller, qui avoit beaucoup
’étudié ces productions végétales, ne reconnoi-
jfoit aucune règle, fure pour ks diffinguer , &