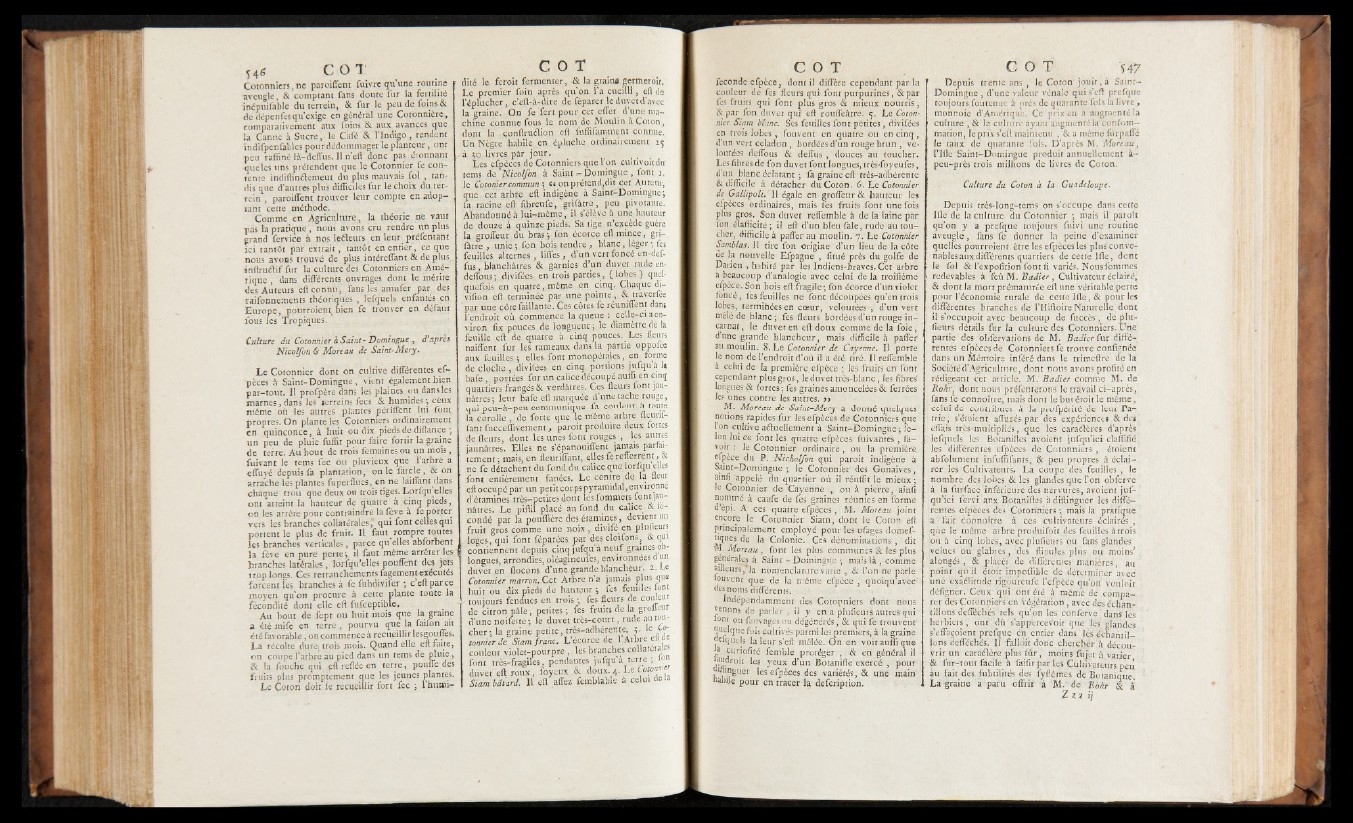
54S C O T
Cotonniers, ne paroiffent fuivre qu’une routine
aveugle, & comptant fans doute fur la fertilité
inépuifable du terrein, & fur le peu de foins &
de dépenfes qu’exige en général une Cotonnière,
comparativement aux foins & aux avances que
la Canne à Sucre, le Café 8c l’Indigo , rendent
indifpenfables pour dédommager le planteur, ont
peu raffiné là-deflus. Il n’eft donc pas étonnant
que les uns prétendent que le Cotonnier fe contente
indiftinélemeut du plus mauvais fol , tandis
que d'autres plus difficiles fur le choix du ter-
rein , paroiffent trouver leur compte en adoptant
cette méthode.
Comme en Agriculture;, la théorie, ne vaut
pas la pratique , nous avons cru rendre un plus
grand fervice à nos Ieéteurs en leur préfentant
ici tantôt par extrait, tantôt en entier, ce que
nous avons trouvé de plqs intéreffant & de plus,
«nftruébf fur la culture des Cotonniers en Amérique
, dans différents ouvrages dont le mérite
des Auteurs eft connu', fans les amufèr par de§
raifonnements théoriques , lefquels enfantés en
Europe, pourroient bien fe trouver en défaut
fous les Tropiques.
Culture du Cotonnier h Saint- Domingue , d apres
Nicolfon & Moreau de Saint-Mery.
Le Cotonnier dont on cultive différentes e s pèces
à Saint-Domingue, vient également bien
par-tout. Il profpère dans les plaines ou dans les
marnes, dans les lerreins fecs 8t_ humides ; ceux
même où les autres plantes périffent lui font
propres. On plante les Cotonniers ordinairement
en quinconce, à huit ou dix pieds de difiance ;
un peu de pluie fuffit pour faire fortir la graine
de terre. Au bout de trois femaines ou un mois ,
fui van t le tems fec ou pluvieux que 1 arbre a
effuyé depuis fa plantation, on le farcie, & on
arrache les plantes fuperflues, en ne îaiffant dans
chaque trou que deux ou trois tiges. Lorfcju elles
ont atteint la hauteur de quatre à cinq pieds,
on les arrête pour contraindre la fève à fe porter
vers les branches collatérales* qui font celles qui
portent le plus de fruit. Il faut ^ rompre toutes
les branches verticales, parce quelles abforbent
la fève en pure perte-, il faut même arrêter les
branches latérales , lorfqufélles pouffent des jets
trop longs. Ces retranchements fagement exécutés
forcent les branches à fe fubdivifer ; c eft parce
moyen qu’on procure à cette plante toute la
fécondité dont elle eft fufceptible.
Au bout de fept ou huit mois que la graine
a été mife en terre , pourvu que la faifon ait
été favorable, on commence à recueillir lesgouffes.
La récolte durej trois mois. Quand elle eft faite,
on coupe l’arbre au pied dans un tems de pluie,
& la Touche qui eft reliée en te r re p o u ffe des
fruits plus promptement que les jeunes plantes.
Le Coton doit le recueillir fort fec ; rhunaidité
le feroit fermenter, & la grain* germeroit.
Le premier foin après qu’on l’a cueilli, eft de
l’éplucher, c’eft-à-dire de féparer le duvet d’avec
la graine. On fe Yert pour cet effet d’une machine
connue fous le nom de Moulin a Coton,
dont la çonflruélion eft fuffifammçnt connue.
Un Nègre habile en épluche ordinairement 25
, à 3.0 livres, par jour.
Les efpèces de Cotonniers que l ’on cuhivoitdu
tems de Nicolfon à Saint- Domingue, font 1.
le Cotoniercommun $ et on prétendait cet Auteur,
que cet arbre eft indigène à Sainr-Domingue ;
fa, racine eft fibreufe, grifâtre , peu pivotante.
Abandonné à lui-miême, il s'élève à une hauteur
de douze à quinze pieds. Sa tige n’excède guère
la groffeur du bras, fon écorce eft mince, grifâtre
, unie *, fon bois tendre, blanc, léger ; fes
feuilles alternes , liftes, d’un vert foncé en-def-
fus, blanchâtres & garnies d’un duvet rude en-
deffous; divifées en trois parties,,,( lobes ) quelquefois
en quatre, même en cinq. Chaque di-
vifton eft terminée par une pointe,,8c traverfée
par une côte Taillante. Ces côtes fe réunifient dans
l’endroit où commence la queue : celle-ci a en-
I viron lïx pouces de longueur $ le diamètre de la
feuille eft de quatre à cinq pouces. Les fleurs
naiffent fur les rameaux dans la partie oppofée
aux feuilles -, elles font monopétales, en forme
de cloche;, divifées en cinq portions jufqu’à la
bafe,. portées fur un calice découpé auffi en cinq
quartiers frangés & verdâtres. Ces fleurs font jau- ■
nôtres-, leur bafe eft marquée d’une tache rouge,
qui peu-à-peu communique fa couleur à toute
la corolle , de forte que le même arbre fleurif-
fant fucceffivement, paroit produire deux fortes
de fleurs, dont les unes font rouges , les autres
jaunâtres. Elles ne s’épanouiffent jamais parfaitement,
mais, en fleuriffant, elles ferefferrent,&
rie fe détachent du fond du calice que lorfqu elles
font entièrement fanées. Le centre ,dç- la fleur
eft occupé par un petit corps pyramidal, environne
d’étamines très-petites dont les fommets font jaunâtres.
Le piftil placé au fond du calice & fécondé
parla pouflière desétamines, devient un
fruit gros comme une noix, divifé en plufieurs
loges, qui font féparées par descloifons, & qui
contiennent depuis cinq jufqu’à neuf graines ob-
longues, arrondies, oiéagineufes, environnées d un
duvet en flocons d’une grande blancheur. 2. Le
Cotonnier marron. Cet Arbre n a jamais plus que
huit ou dix pieds de hauteur ; fes feuilles font
- ' toujours fendues en trois -, fes fleurs de couleur
de citron pâle, petites -, fes fruits de la groffeur
d’une noifeite; le duvet très-court, rude au toucher,
la graine petite, très-adhérente. 3. le
tonnierde Siam franc. L ’écorce de l’Arbre elt de
couleur violet-pourpre , les branches collaréra
font très-fragiles, pendantes jufqu’à terre ; m
duvet eft roux, foyeux & doux. 4. Le Cotomt
Siam bâtard. 11 eft affez femblabie à celui de la
fécondé efpèce, dont il diffère cependant par la
couleur de fes fleurs quiv font purpurines, & par
fes fruits qui font plus gros & mieux nourris,
& par fon duvet qui eft rouffeâtre. 5. L.c Cotonnier
Siam blanc. Ses feuilles font petitesdivifées
en trois lobes, fouvent en quatre ou en cinq,
d’un vert céladon , bordées d’un rouge brun , veloutées
deffous & deffus > douces au toucher.
Les fibres de fon duvet font longues, irès-foyeufes,
d’un blanc éclatant -, fa graine eft rrès-adhérente
& difficile à détacher du Coton. 6. Le Cotonnier
de Gallipoli.' Il égale en groffeur & hauteur les
efpèces ordinaires, mais fes fruits font une fois
plus gros. Son duvet reffemble à de la laine par
ion élafticité ; il eft d’un bleu fale, rude au toucher,
difficile à pafferau moulin. 7. Le Cotonnier
Samblas. Il tire fon origine d’uii lieu de la côte
de la nouvelle Efpagne , fitué près du golfe de
Darien , habité par les Indiens-braves. Cet arbre
a beaucoup d’analogie avec celui de la troifième.
efpèce. Son bois eft fragile; fon écorce d’un violet
foncé, fes feuilles ne font découpées qu’en trois
lobes, termihéesen coeur, veloutées y d’un vert
mêlé de blanc ; fes fleurs bordées d’un rouge incarnat
, le duvet en eft doux comme de la foie,
dune grande blancheur, mais difficile à paffer
au moulin. 8. Le Cotonnier de Cayenne. Il porte
le nom de l’endroit d’où il a été tiré. Il reffemble
à celui de la première efpèce ; les fruits en font
cependant plus gros, le duvet très-blanc, les fibres’
longues & fortes; fes graines amoncelées & ferrées
les unes contre les autres, n
M. Moreau de Saint-Mery a donné quelques;
notions rapides fur les efpèces de Cotonniers que
Ion cultive aéluellement à Saint-Domingue; félon
lui ce font les quatre efpèces fuivantes , fa-
voir : le Cotonnier ordinaire, ou la première.,
efpèce du P. Nickolfon qui paroit indigène à
Saint-Domingue ; le Cotonnier des Gonaivès,
ainfi'appelé du quartier où il réuffit le mieux;
le Cotonnier de Cayenne , ou à pierre, ainfi
nommé à caufe de fes graines réunies en forme
d’épi. A ces quatre efpèces, M. Mo?eau joint
encore le Cotonnier Siam, dont le Coron eft
principalement employé pour les ufagès domef-
tiqües de la Colonie. Ces dénominations , dit
IM. Moreau , font les plus, communes & les plus ■
générales à Saint - Domingue ; mais là , comme
rtdleurs^la nomenclature varie , & l’on ne parle
10uv ent que de la même efpèce , qüoiqu’avec
des noms différents.
Indépendamment des Cotonniers dont nous ;
tenons de parler, il y en a plufieurs autres qui
011 f 911 fauvâges ou dégénérés, & qui fe trouvent
quelquefois cultivés parmi les premiers, à la graine
defquels lalenr.s’eft mêlée. On en voit auffi que 1
3 curiofité femble protéger , & en général il ■
audroit les yeux d’un Botanifte exercé , pour .
îflmguer les efpèces des variétés, 8c une «îain j
namle pour en tracer la defeription. i
Depuis trente ans , le Coton jouit, à Sainr-
Domingue , d’une valeur vénale qui s’eft prefque
toujours foutenue à près de quarante fols la livre,
monnoie d’Amérique. Ce prix en a augmenté la
culture , 8c la culture ayant augmenté la eonfom-
mation, le prix séft maintenu , 8c a même fürpaffé
le taux de quaranre fois. D’après M. Moreau,
Hile Saint-Domingue produit annuellement à-
peu-près trois millions de livres de Coton.
Culture du Coton a la Guadeloupe.
Depuis très-long-tems on s’occupe dans cette
: Ifle de la culture du Cotonnier ; mais il paroît
qu’on y a prefque toujours fuivi une routine
aveugle, fans fe donner la peine d’examiner
quelles pourroient être les efpèces les plus convenables
aux différents quartiers de cette Ifle, dont
le fol 8c l’expofition font fi variés. Nousfommes
redevables à feû M. Badier , Cultivateur éclairé,
8c dont la mort prématurée eft une véritable perte
pourT économie rurale de cette Ifle, 8c pour les
différentes branches cle l’Hiftoire Naturelle dont
il s’occupoir avec beaucoup de fuccès, de phir
fleurs détails fur la culture des Cotonniers. Une
partie des obfërvations de M. Badier fur différentes
efpèces de Cotonniers fe trouve confignée
dans un Mémoire inféré dans le trimeftre de la
Sociétéd’Agriculture, dont nous avons profité en
rédigeant cet article. M. Badier comme M. de
Rokr} dont nous préfentèrons le travail ci-après,
fans fe connoître, mais dont le butétoit le même,
celui de contribuer à là profpérité de leur Patrie;
s’éloient affûtés par des expériences 8c des
effais très-multipliés, que les caractères d’après
lefquels les Botaniftes avoient jufqu’ici claffifié
les différentes efpèces de Cotonniers , étoienc
abfolument infumfants, 8c peu propres à éclairer
les Cultivateurs. La coupe des feuilles , le
nombre des lobes 8c les glandes que l’on obfèrve
à la furface inférieure des nervures, avoient jufqu’ici
fervi aux Botaniftes àdiftinguer les différentes
efpèces des Cotonniers; mais la pratique
a fait connoître à ces cultivateurs éclairés ,
que le même arbre produifoit des feuilles à trois
où à cinq lobes, avec plufieurs ou fans glandes
velues ou; glabres, des ftipules plus ou moins*,
alongés, & placés de différentes' manières, au
point qu’il ëtoir impofiible de déterminer avec
une exactitude rigoureufe l’efpèce qu’on vouloit
défigner. Ceux- qui ont été à même de comparer
dès Cotonniers en végétation, avec des échantillons
clefféchés tels qu’on les conferve dans les
herbiers, ont dû s’appercevoir que les glandes
s’effaçoient prefque èn entier dans les échantillons
defféehés. 11 falloit donc chercher à découvrir
un caràéîère plus fû r , moins fujet à, varier
8c fur-tout facile à faifirpar Les Cultivateurs peu
au fait des. fubtilités des fyfiênîes de Botanique.
La graine a paru offrir à M. de R6hr 8c à
Z z x ij