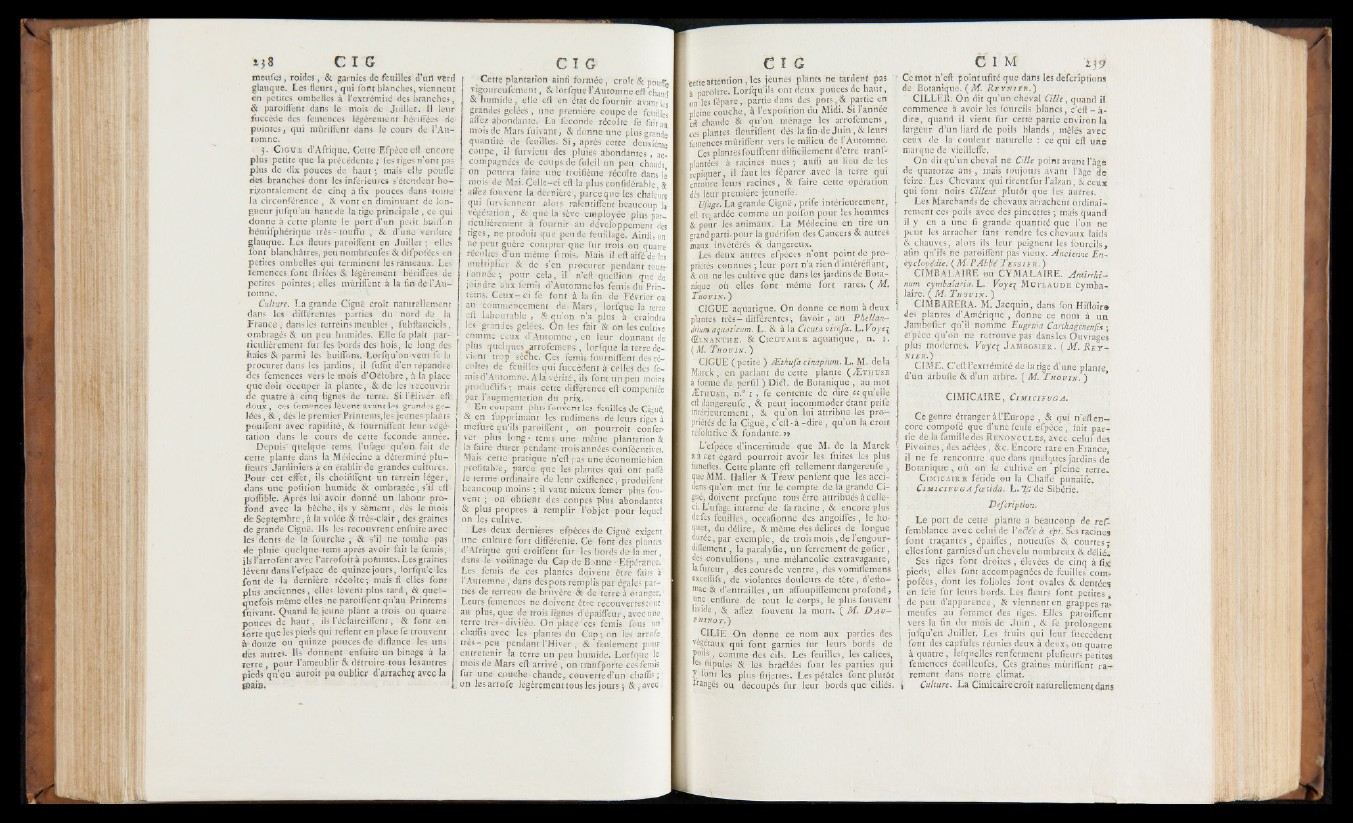
i j 8 C I G
meufes, roides, & garnies de feuilles d’ut! verd
glauque. Les fleurs, qui font blanches, viennent
en petites ombelles à l’extrémité des branches,
& paroiflent dans le mois de Juillet. Il leur
fuccède des feménces légèrement hérifFées de1
pointes, qui mûriffent dans le cours de l’Automne.
3. Ciguë d’Afrique. Cette Efpèceeft encore
plus- petite que la précédente ; les tiges n’ont pas
plus de dix pouces de haut ; mais elle pouffe
des branches dont les inférieures s’étendent horizontalement
de cinq à fix pouces dans toute'
la circonférence , & vont en diminuant de longueur
jufqu’au haut de la tige-principale , ce qui
donne à cette plante le port d’un petit, buiflon
hémifphérique très - touffu , & d’une verdure
glauque. Les fleurs paroiflent en Juillet ; elles
font blanchâtres, peu nombreufes & difpofées en
petites ombelles qui terminent les rameaux. Les
femeneês,font flriées & légèrement hérifl’ées de
petires pointes; elles mûriffent à la fin'de l’Automne.
Culture. La grande Ciguë croît naturellement
dans les différentes parties du nord de la
France ,- dans les terreins meubles, fubftanciels, .
ombragés & un peu humides. Elle fe plaît particulièrement
fur les bords des bois, le long des
haies & parmi les' buifibns. Lorfqu’omvetn feda
procurer dans les jardins, il fuffit d’en répandre-
des femences vers le mois' d’Oèlobre, à la place
que doit Occuper la plante, & de les ^recouvrir
de quatre à cinq lignes de terre. Si-THiver- eft’
doux, ces femences lèvent1 avant les grandes gelées
, & , dès le premier Primeras,les jeunes plants
pouffent avec rapidité, & fôumifleiït leur végé- i
tation dans le cours de cetre fécondé année.
Depuis" quelque tèmsi l’ufage qu’on, fait de
cette plante dans la Médecine a déterminé plu-
freurs Jardiniers à-en établir de grandes cultures.
Pour cet effet, ils choififfent un terrera léger,
dans une pofition humide & ombragée, s’il eft
poftible. Après lui avoir donné un labour profond
avec la bêche, ils y sèment y dès le mois
de Septembre, à la volée & très-clair , des graines
de grande Ciguë. Ils les recouvrent enfuite arec
les dents de la fourche , & s’il ne tombe pas
de pluie quelque-tems après avoir fait le ferais,
ik l’arrofént avec Pârrofoirà pofnmes. Les graines
lèvent dans l’éfpace de quinze-jours, lorfqu’elles
font de la dernière récolte; mais fi elles font
plus anciennes, elles lèvent plus tard, & quelquefois
même elles ne paroiflent qu’au Prinrems
fuivant. Quand le, jeune plant a trois ou quatre
pouces dê haut, ils l’éclairciffent, & font en
forte que les pieds qui reftent en place fe trouvent
à douze ou quinze pouces de diftance les uns
dés autres. Ils donnent enfuite un binage à la
terre , pour l’ameublir & détruire tous les autres
pieds’qu'on auroit pu oublier d’arrachef avec la
jnaip, l
C I G
Cette plantation ainfi formée, croît 5c poufle I
vigoureufemenr, & lorfque l’Automne eft chaud I
& humide, elle eft en état de fournir avant les I
grandes gelées, une première coupe de feuilles I
affez abondante. La fécondé récolte Te fait au I
mois de Mars fuivant , & donne une plus grande ! I
■ quantité de feuilles. S i, après cette deuxième I
coupe, il furvient des pluies abondantes, ac- i l
compagnéés de coups de foleil un peu chauds I
" on pourra faire une troifième réco'lte dans le |
mois de Mai. Celle-ci eft la plus confidérable, & K
affez fou vent la dernière, parce que les chaleurs |
qui furviennenr alors ralentiffent beaucoup I
végétation, & que la sève employée plus par- I
ticulièrement à fournir au développement des I
tiges, ne produit que pende feuillage. Ainfi, on K
ne peut guère compter que fur trois ou quatre |
récoltes d’un même ft mis. Mais il eft aifé de les j I
multiplier & de s’en procurer pendant toute |
i année; pour cela, il n’eft queftion que de I
joindre aux femis d’Automneles ferais duPrin- 1
tems. C e u x - c i fe font à la fin de Février ou I
: aii commencement de Mars, lorfque la terre I
; eft labourable , & qu’on n’a plus' à ■ craindre I
lés grandes gelées. On les fait & on les cultive I
comme ceux cl’Automne, en leur donnant de I
; P}as quelques arrofemens , lorfque la terre de- I
vient trop sèche. Ces ferais fourniffent des ré- I
coites de feuilles qui fuccèdent à celles dés fe- I
mis d’Automne. A la vérité , ils font un peu moins 11
• produélifs ; mais cette différence eft compenféc I
par l'augmentation du prix.
En coupant plus fouvent les feuilles de Ciguë, I
& en fu'p-primant les rudimens de leurs tiges à I
mefure qu’ils paroiflent, on pourroit confer* I
: ver plus long- tems. une même plantation & I
: % faire durer pendant trois années confécutives. I
Mais cette-pratique n’eft pas une économie bien I
profitable.., parce que les plantes qui ont paffé I
le terme ordinaire de leur exiflenee, produifent I
: beaucoup moins ; il vaut mieux femer plus fou- I
vent; on obtient des coupes plus abondantes I
& plus propres à remplir l’objet pour lequel I
on les. cultive.
Les deux dernières efpèces de Ciguë exigent I
une culture fort différente. Ce font des plantes I
d’Afrique qui eroiffent fur les bords de* la mer, I
dans le y ©binage du Cap de Bonne - Efpé rance. 1
Les ferais de ces plantes doivent être faits à I
l’Automne, dans despors remplis par égales parties
de terreau de bruyère & de terre à oranger. -
Leurs femences ne doivent être recouvertes tout
au plus, que'de trois lignes d’épài fleur, avec une .
terre très-divifée. On place 'ces femis fous un
chaftis avec les plantes du Cap ; on les arrofe.
très-peu pendant l’Hiver , & feulement pour
entretenir la terre un peu humide. Lorfque le
mois de Mars eft arrivé , on tranfporte ces femis
fur une couche chaude,, couverte d’un chaftis;1 j
on les arrofe légèrement tous les jours ; & , avec
CIG
cette attention, ks jeunes plants ne tardent pas |
à parotae. Lorfqu’ils ont deux polices de haut,
i „„(es fépare, partie dans des pots, & partie en
! pleine couche, à l’expofirion du Midi. Si l’année
ed chaude & qu’on ménage les arrofemens,
ces plantes fleuriflent dès la fin-de Juin, & leurs
femences mûriffent vers le milieu de l’Automne.
Ces plantesfouffrent difficilement d’être tranf-
! plantées à racines nues ; auffi au lieu de les
[repiquer, il faut les féparer .avec la terre qui
entoure leurs racines/ & faire cette opération |
[dès leur première jeuneffe. . . !
Ufage. La grande Ciguë, prife intérieurement,
eft re; ardée comme un poifon pour les hommes
& pour les atiimâux. La Médecine en tire un j
Igrandparti-pour la guérifon des Cancers & autres ;
[maux invétérés & dangereux.
Les deux autres efpèces n’ont point de pro- j
priérés connues ; leur port n’a rien d’intéréüant, \
I & on ne les cultive que dans les jardins de Botanique
où elles font même fort rares. ( M.
Thqvin. )
CIGUË aquatique. On donne ce nom à deux f
plantes très- différentes'; fàvoir, au Phellan-
drium aquaticum. L. & à la Cicuta virofa. L. Voyez
(Elnanthe. & Cicutaire aquatique, n. 1.
( M. Tho v in . )
CIGUË (petite ) Æthufacinapium. L. M. delà j
Marck, en parlant de cette plante (Æ thuse !
à forme de perfil ) Diét. de Botanique , au mot
Æthuse, n.° 1 , fe contente dé dire c< qu’elle
eft dangereufe , & peut incommoder étant prife
; intérieurement, & qu’on lui attribue les propriétés
de la Ciguë, c’eft-à -d ire , qu’on la croit
réfolutive & fondante.
L’efpèce d’incertitude que M. de la Marck
; a à cet égard pourroit avoir les fuites les plus
funeftes. Cette plante eft tellement dangereufe ,
que MM. Haller & Tfew penfent que les acci-
dens qu’on met fur le compte de la grande Ciguë:,
doivent prefque tous être attribués à celle-
ci. L ’ufage interne de fa racine , & encore plus
I defes feuilles , occafionne des angoiffès, le ho- ;
quet, du délire , & même des délires de longue
durée, par exemple, de trois m ois, de l’engour-
difl'ement, la paralyfie, un ferrement de gofier,
dès convulfions, une mélancolie extravagante,
h fureur, des cours de ventre, des vomiffemens
exceflifs, de violentes douleurs de tête, d’efto-
tnac & d’entrailles, un affoupiffement profond,
Une enflure de tout le corps, le plus fouvent
livide, & affez fouvent la mort., ( M. D av—
ïhinot .)
CILIÉ. On donne ce nom aux parties des
i végétaux qui font garnies fur leurs bords de
poils, comme des cils. Les feuilles, les calices,
j les ftipules & les bradées font les parties qui
y font les -plus fujettes. Les pétales font plutôt
frangés ou découpés fur leur bords que ciliés.
C I M
Ce mot n’eft point ufité que dans les deferiptions
de Botanique. ( M. R e y n i e r .)
CILLER. On dit qu’un cheval C ille , quand il
commence à avoir les foureils blancs, c’ert - à-
dire, quand il vient fur cette partie environ la
largeur d’un liard de poils blands, mêlés avec
ceux de la couleur naturelle : ce qui eft une
marque de vieilleffe.
On dit qu’un cheval ne Cille point avant l’âge
de quatorze ans, mais toujours avant l’âge de
feize. Les Chevaux qui tirent fur l’alzan, & ceux
qui font noirs Cillent plutôt que les autres.
Les Marchands de chevaux arrachent Ordinairement
ces poils avec des pincettes ; mais quand
il y en a une fi grande quantité que l’on ne
peut les arracher- fans rendre les chevaux laids
& chauves, alors ils leur peignent les foureils,
afin qu’ils né paroiflent pas vieux. Ancienne Encyclopédie.
(_M. l ’ Abbé T e s s ie r . )
CIMBALA1RE où CYMALAIRE. Antirrhi-
num cymbalana. L. Voye^ Muflaude cymba-
Taire. ( M. T hùvin. ) '
CIMBARERA. M. Jacquin, dans fon Hiftoir®
des plantes d’Amérique , donne ce nom à un
Jambofier qu’ il nommé Eùgènia Carthagénenlis ■
efpèce qu’on ne retrouve pas dans les Ouvrages
plus modernes. Voÿ ei J ambobier. ( M . R e y -
n ie r '.J
CIME. C’eft l’extrémité de la tige d’une plante
d’un arbufte & d’un arbre. ( M . T h o v in . )
CIMICAIRE, ClMlCIEVGA.
Ce genre étranger à l’Europe , & qui n’eft encore
compofé que d’uné feule êfpëee , fait partie
de la famille des Renoncules, avec celui des
Pivoines (des aélées, &c. Encore rare en France
il ne fe rencontre que dans quelques jardins de
Botanique , où on le cultivé en pleine terre.
CimicaiRe fétide ou la Cliàffé punaife.
Cim i c ie v g a feetida. L. de Sibérie.
Defcription.
Le port de cette plante a beaucoup de re£
femblance avec celui de VaBéea épi’. Ses racines
font traçantes , épaiffes, noueufes & courtes-,
elles font garnies d’un chevelu nombreux & délié.
Ses rigès font droites , élevées de cinq à fix'
pieds; elles font accompagnées de feuilles'coin-
■ pofées, dont les folioles font ovales & dentées
en feie fur leurs bords. Les fleurs font petites
j de peu d’apparence, & viennent en grappes ra-
J meufes au fommet des tiges. Elles paroiflent
j vers la fin du mois de J u in , & fe prolongent
1 jufqu’en Juillet. Les fruits qui leur fuccèdent
font des capfules réunies deux à deux, ou quatre
à quatre, lelquelles renferment plufieurs petites
' femences écailleufès. Ces graines mûriffent ra-
, rement dans notre climat,
i Culture. La Cimicaire crôît naturellement dans