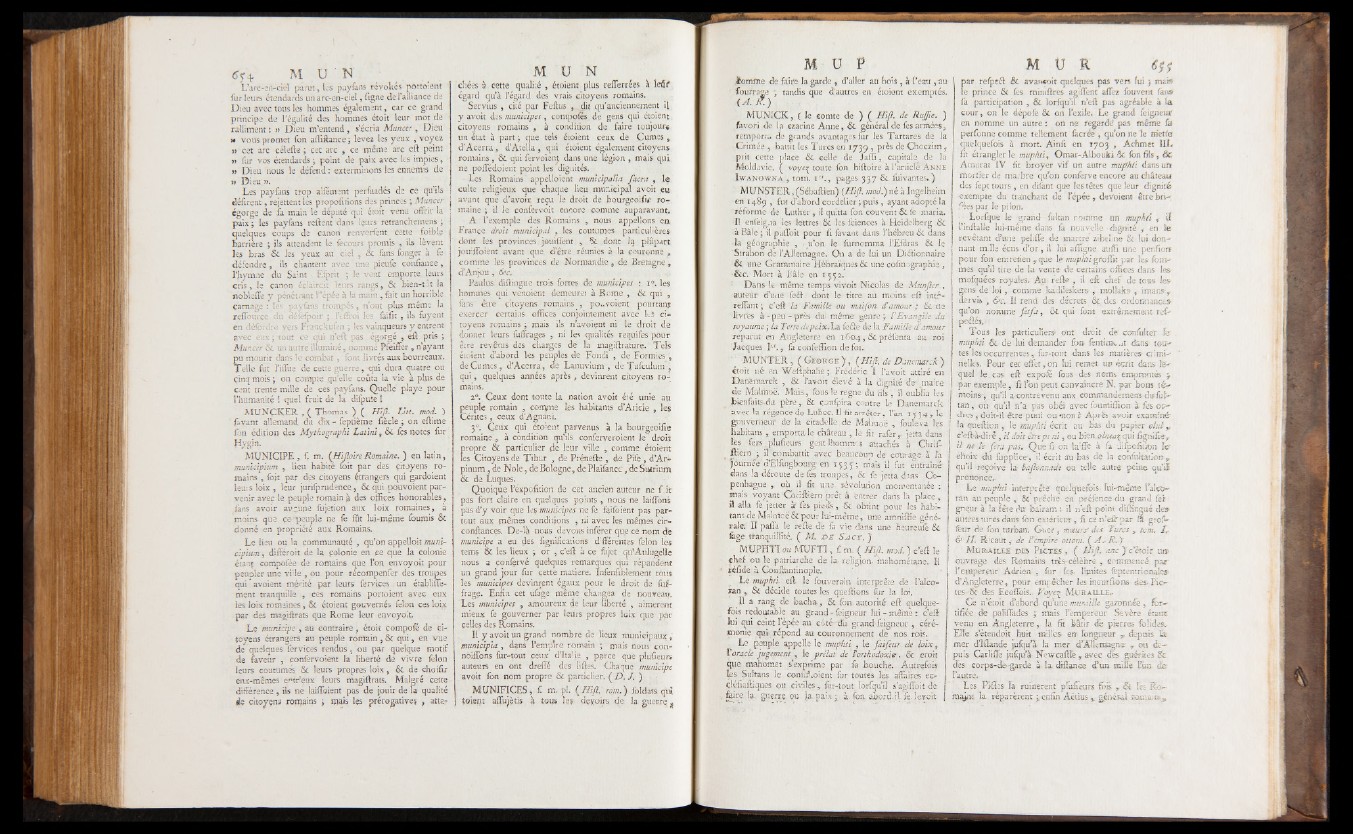
M U N
L’arc-en-cièl parut, les payfans révoltés portaient
fur leurs étendards un arc-en-ciel, figne de l’alliance de
Dieu avec tous les hommes également, car ce grand
principe de l’égalité des hommes étoit leur mot de
ralliment : » Dieu m’entend, s’écria Muncer , Dieu
» vous promet fon alfiftance ; levez les yeux , voyez
j> cet arc célefte ; cet arc , ce même arc eft peint
j> fur vos étendards ; point de paix avec les impies,
» Dieu nous le défend : exterminons les ennemis de
» Dieu ».
Les payfans trop aifément perfuadés de ce qu’ils
défirent, rejettent les propofitions des princes ; Muncer I
égorge de fa main le député qui ét'oit venu offrir la
paix ; les payfans reftent dans leurs retranchemens ;
quelques coups de canon renverfent cette foible
barrière ■; ils attendent le fècours promis , ils lèvent
les bras & les yeux au ciel , Ôc fans fonger à fe
défendre, ils chantent avec une pieuie confiance,
l’hymne du Saint Efprit ; le vent emporte leurs
cris, le canon éclaircit leurs rangs, & bien-tot la
noblefle y pénétrant l”épée à la main, fait un horrible
carnage : les payfans trompés, n’ont plus même la
reffourçe du défefpoir • l’effroi les faifit , ils fuyent
en défordre vers Franckufen ; les vainqueurs y entrent
avec eux y tout ce qui n’eft pas égorgé , eft pris ;
Muncer & un autre illuminé, nommé Pfeiffer , n’ayant
pu mourir dans le combat , font livrés aux bourreaux.
Telle fut l’iiTue de cette guerre, qui dura quatre ou
çinq mois ; on compte qu’elle coûta la vie g plus de
cent trente mille de ces payfans. Quelle playe pour
l’humanité ! quel fruit de la dlfpuîe î
M U N ÇK ER , ( Thomas ) ( Hijl. Lut. mod. )
favant allemand du dix - feptième fiècle ; on eftime
ion édition des Mythographi Latini t & fçs notes fur
Hygîn.
MUNICIPE, fi m, (Hijioire Romaine. ) en latin,
municipïum , lieu habité foit par des citoyens romains
, foit par des citoyens étrangers qui gardoient
leuisloix, leur jurifprudence., & qui pouvoient parvenir
avec le peuple romain à des offices honorables,
fans avoir aucune fujetion aux loix romaines, à
moins que çe qaeuple ne fe fut lui-m,ême fournis &
donné en propriété aux Romains.
Le lieu ou la communauté , qu’on appelloit municipïum
, differoit de la colonie en ce que la colonie
étant compofée de romains que l’on envoyoit pour
peupler une vide , ou pour récompenfer des troupes
qui avoient mérité par leurs fervice? un établiffe-
ment tranquille , ces romains portoient avec eux
les loix romaines, & étoient gouvernés félon ces loix j
par des maoiôrats que Rome leur envoyoit.
Le municipe , au contraire, étoit çompofé de citoyens
étrangers au peuple romain, & qui, en vue
de quelques forvices rendus , ou par quelque motif
de faveur , eonfer voient la liberté dé vivre félon
leurs coutumes & leurs propres loix, & de choifir
enx-mêmes entrieux leurs magiftrats. Malgré cette
différence , ils né laiffoient pas de jouir de la qualité
de citoyens romains y mais les prérogative? , att
M U N
chées à cette qualité , étoient plus reflerrées à ledf
égard qu’à l’égard des vrais citoyens romains.
Servius , cité par Feftus , dit qu* anciennement il
y avoit dos municipes, compofés de gens qui étoient,
citoyens romains , à condition de faire toujours
un état à part ; que tels étoient ceux de Cumes,
d’Acerra, d’Atella , qui étoient également citoyens
romains , & qui fervoient dans une légion , mais qui
ne poffédoient point les dignités.
Les Romains" appelloient municipalia facra , le
culte religieux que chaque lieu municipal avoit eu
avant que d’ avoir reçu le droit de bourgeoifie romaine
; il le confervoit encore comme auparavant.
A l’exemple des Romains , nous appelions en
Françe droit municipal , les coutumes particulières
dont les provinces jouiflent , dont Iq plupart
jouiffoient avant que d’être réunies à la couronne ,
comme les provinces de Normandie, de Bretagne,
d’Anjou, &c.
Paulus diftingue trois fortes de municipes ; i % les
hommes qui venoienf demeuret à Rome , & qui ,
fans être citoyens romains , pouvoient pourtant
exercer certains offices conjointement avec les citoyens
romains ; mais ils n’avoiçnt ni le droit de
donner leurs fuftrages , ni les qualités requifes pour
être revêtus des charges dé la magiftrature. Tels
étoient d’abord les peuples de Fondi , de Formiès '9
de Cumes, d’Acerra, de Lanuvium , de Tufculum.
qui, quelques années après, devinrent citoyens romains.
2.0. Ceux dont toute la nation avoit été unie au
peuple romain , compte les habitants d’Aricie , les
Cérites, ceux d’Agnani.
3°. Çeux qui étoient parvenus à la bourgeoifie
romaine , à condition qu’ils conferyeroient le droit
propre & particulier de leur ville , comme étoient
les Citoyens de Tïbur , de Préneftede Pife, d’Ars»
pinum, de Noie, de Bologne, de Plaifance/de Sutrium
& de Luques.
Quoique l’expofition de cet ancien auteur ne f,it
pas fort claire en quelques points , nous ne laifTons
pas d’y voir que les municipes ne fe faifoient pas partout
aux mêmes conditions , ni avec les mêmes circonstances.
De-là nous devons inférer que ce nom de
municipe a eu des fignifications d:fférentes félon les
tems & les lieux ; or , e’eff à ce fojet qu?Aulugelle
nous a çonfervé quelques remarques qui répandent
un grand jour fur cette matière. Infenfiblement tous
les municipes devinrent égaux pour le droit de fo£-
fragç. Enfin cet ufage même changea de nouveau.
Les municipes , amoureux de leur liberté , aimèrent
mieux fe gouverner par leurs propres loix que par
celles des Romains.
Il y avoit un grand nombre de lieux municipaux,
municipia , dans l’empire romain ; mais nous çon-
noiffons fùr-tout ceux d’Italie , parce que plufieurs
auteurs en ont dreffé des liftes. Chaque municipe
avoit fon nom propre & particlier. ( D. J, )
MUNIFICES, f. m. pi. {Hijl.' rom.} foldats qui
toient affujètis à tous les devoirs de la guerre *
M u P
Homme de fàit'e la garde , d’aller au bois , à’ l’eau , au
fourrage ; tandis que à autres en étoient exemptés.
{A . I l )
MUNICK, ( le comte de ) ( H iß de Rufe. )
favori de la czarine Anne, & général de fes armées*
remporta de grands avantages fur les Tartares de la
Crimée * battit les Turcs en 1739, près de Choczirn,
prit cette place & celle de Jaffi, capitale de la
Moldavie. ( voyeç toute fon hiftoire à l’article A n n e
Iwanowna tom. Ier.., pages 337 & fuivantes.)
MUNSTER, (Sébaftien) (Hifl. mod?) né à Ingelheim
en 1489 , fut d’abord cordelier ; puis , ayant adopté la
réforme de Luther , il quitta fon couvent & fe maria.
-Il enleig.ia les lettres & les fciences à. Heidelberg &
à Bâle ; il paffbit pour fi (avant dans l’hébreu & dans
la géographie , ; u’on le fiirnomma l’Efdras & le
Strabon de l’Allemagne. On a de lui un Di&ionnaire
& une Grammaire Hébraïques & une cofmographie,
•&c. Mort à li ale en 155.2..
Dans- le- même temps vivoit Nicolas de Munfler .
auteur d'une fe£f ; dont le titre au moins eft inté-
reffant ; c’eft la ' Famille ou maifon £ amour ; &. de
livr'es à - peu - près du même genre y l’Evangile du \
royaume y la Terre de paix. La feéfe de la Famille d amour
reparut en Angleterre en 1604, & préfenta au. roi
Jacques Ier. , fa eonfèffion de foi.
MUNTER, (G eorge) , {Hiß. de Dammarct)
étoit né en Wefiphalie Frédéric I l’avoit attiré en
Danémarck , & l’avoit élevé à la dignité de- maire
de Malmoé. Mais, fous le regne du fils , il oublia les
bienfaits-da père, & çonfpira contre le Danemarck
.avec la régence de Lubec. Il fit arrêter, 1 an 15 34 , le
gouverneur de' la citadelle de Malraoë , fouleva les
nabitans , emporta: le château , le fit rafer, jetta dans '
les fers r plufieurs gent Ihommcs attachés à Chrif-
fliern ; il combattit avec beaucoup de ccfUrage. à fa
Journée’ d’Elfingboùrg'en 15,3 7; mais il fut entraîné
dans la déroute de fes troupes, & fo fottà dans Copenhague
,. où il fit une révolution momentanée :
mais voyant Cnriftiern prêt à entrer dans la place-,
il alla fo jetter s fes pieds, & obtint pour les habi-
tans deMalmcë& pour lui-même, une amniftîe générale.
H paffa le refte de fa vie dans une heureufe &
fege tranquillité. ( M. d e S a c y . J
MUPHTÏou MUFTI, Çm. ( H iß mod.) c’èft le
chef ou le patriarche de la- religion- mahométane. Il
çéfide à Conftäntinople.
Le muphti eft. le fouveram- interprète de l’alco-
ran , & décide toutes les queftlons for la loi.
Il a rang, de bach%, & fon. autorité eft quelquefois
redoutable au grand - feigneur lui - meine :. c’eff
lui qui ceint l’épée au côté- du grand feigneur , cérémonie
qui répond au couronnement de nos rois. .
Le peuple appelle le muphti , le faïfeur de loix,
Voracle jugement , le prélat de ^orthodoxie. & croit
que mahomet s’exprime par fa bouche. Autrefois
les Sultans le confokoient fur toutes les affaires ec-
çléfiaftiques ou civiles, fur-tout lorfquïl s’agiffoit dé'
feire. la. guerre, ou la. paix; à- fon abord-il te. leveit
M ü K 611
par refpeél & avan«oit quelques pas vers lui ; ma»
le prince & fes miniftres agiflent aflez fouvent fans
fe participation , & lorfqu’il n’eft pas agréable à la
cour, on le dépofe & on l’exile. Le grand feigneur
en nomme un autre : on ne regardé pas même fe
perfonne comme tellement fecrée , qu’on ne le frietfe
quelquefois à mort. Ainfi en 1703 , Achmet IIL
nt étrangler le muphti, Omar-Albouki 6c fon fils , &
A murât IV fit broyer vif un autre muphti dans u'ft
mortier de marbre qu’on eonferve encore au château
des fept tours, en difânt que les têtes que leur dignité
exempte du tranchant de l’épée , dévoient être bri-;
fées par, le pilon.
Lorfque le grand fultan nomme un muphti ,- il
l’inftalle lui-même dans fe nouvelle ■ dignité , en le
revêtant d’une pelifïe de martre zibeline & lui donnant
mille écus d’o r , il lui affigne auffi une penfiort
pour fon entretien , que le muphti groffit par les fom-
mes qu’il tire de la vente de certains offices dans les-
mofquées royales. Au refte , il eft chef de tous les
•gens de lo i, comme kadileskers-, mollaks , imans ,
dervis , &c. Il rend- des décrets & des ordonnances
qu’on nomme fetfa, ôi qui font extrêmement ref-
peélés.^ s
Tous fes particuliers ont droit dfe confulter fe
muphti & de lui demander fon- fentimv.it dans tou^
tes les oceurrenees, fur-tout dans les matières criminelles.
Pour cet effeton fui remet un écrit dans lequel
le.cas eft expofé fous des noms empruntés 5
par exemple, fi l’on peut convaincre N. par bons témoins",
qu’il a. contrevenu aux commandemens di®for-
tau , ou- qu’il n’a pas obéi avec foumiffion à- fes ocadres
doit-il être puni ou «non B Apres avoir examiné
la queftion , l'e muphti écrit au- bas du papier o lu lv
c eft-à-dirê , il doit être pi n i , eu bien, olnea\ qui fignifie>
i l ne le fera pas. Que fi on la;ffe à fe üifpofitfen 1&
choix du fupp’Cice-, il écrit au bas de la eonfukatiorr 7
; qu’il reçoive la- bafiennade ou telle autre peine quiï
prononce^
Le muphti interprète’ quelquefois fui-même Falco-
ran au peuple , & prêche en préfence du grand for =
gneur à la fête du bairam :■ il n’eft point diftingué des-
autres turcs dans fon extérieur , fi ce n’eft par la grof-
four de fon turban. Guer, meeursr des Turcs > tcm. I r
& II. Ricam ,• de lempire oLiorn. ( A.- R.-)'
Muraille des Pictes , ( Hifl. anc j c’etoir r.np
ouvrage des Romains très-célèbre , commencé par
î'empereur. Adrien,, for fes. limites feptentrienales»
d’Angleterre, pour empêcher les inçurfions dés» Picotes
•-& des EeofTois.. Vo)re^_ Muraille^
Ce n’étoit d’abord qu’une muraille gazon née , fortifiée
dé paliffades y mais l’empereur Sevère étant
venu en Angleterre, la fit bâtir dé pierres folidesv
Elle s’ëtendoit huit milles en longueur r depuis la
mer d’Iflande jufqua-. la mer d’Allemagne- r ou depuis
Carlifle jufqu’à Newcaftîe , avec dès guérites &
dès corps-dè-garde à la. diftance d’un mifiè Lfou de
l’autre.-
Les Piéles la ruinèrent plufieurs foS y & les Ro-
majas la réparèrent y, enfin Aëtius v général, romaia.^