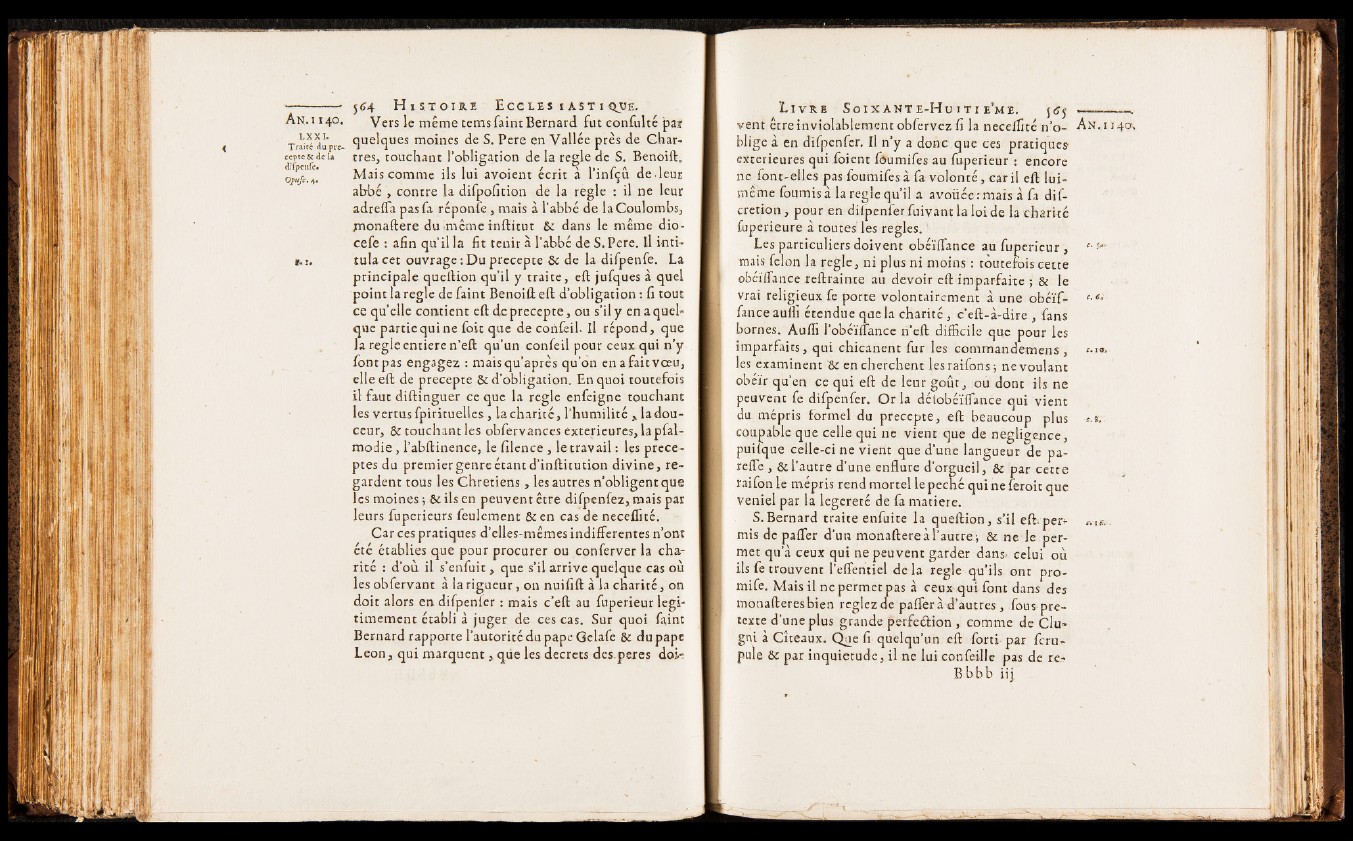
An. i 140.
LXXI.
T ra ité du précepte
& de la
diTpenfe*
Qpufc. 4«
5^4 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e ,
Vers le même rems faint Bernard fut confiilté pa?
quelques moines de S. Pere en Vallée près de Chartres,
touchant l’obligation de la réglé de S. Benoift.
Mais comme ils lui avoient écrit à l’infçù de . leur
abbé , contre la difpofition dé la réglé : il ne leur
adrefla pas fa réponfe, mais à l’abbé de la Coulombs,
jnonaftere du ¡même rnftitut 8c dans le même dio-
cefe : afin qu’il la fit tenir à l’abbé de S.Pere. il intitula
cet ouvrage : Du precepte 8c de la difpenfe. La
principale queftion qu’il y traite, eft jufques à quel
point la réglé de faint Benoift eft d’obligation : fi tout
ce qu’elle contient eft de precepte, ou s’il y en a quelque
partie qui ne foit que de confeil. Il répond, que
la réglé entiere n’eft qu’un confeil pour ceux qui n’y
font pas engagez : mais qu’après qu’on en a fait voeu,
elle eft de precepte 8c d’obligation. En quoi toutefois
il faut diftinguer ce que la réglé enfeigne touchant
les vertus fpirituelles, la charité, l’humilité ,1adouceur,
8c touchant les obfervances extérieures, la pfal-
modie, l’abftinence, le filence , le travail : les préceptes
du premier genre étant d’inftitution divine, regardent
tous les Chrétiens, les autres n’obligent que
les moines ; 8c ils en peuvent être difpenfez,.naais par
leurs fuperieurs feulement 8c en cas de neceifité.
Car ces pratiques d’elles-mêmes indifférentes n’ont
été établies que pour procurer ou conferver la charité
: d’où il s’enfuit , que s’il arrive quelque cas où
les obfervant à la rigueur, on nuifift à la charité, on
doit alors en difpenfer : mais c’eft au fuperieur légitimement
établi à juger de ces cas. Sur quoi faint
Bernard rapporte l’autorité du pape Gelafe 8c du pape
Léon, qui marquent , que les décrets des.peres doi-.
L i vre So i x a n t e - H u i ti e’me.
vent être inviolablement obfervez fi la neceifité n’oblige
à en difpenfer. Il n’y a donc , que ces pratiques-
extérieures qui foient fdumifes au fuperieur : encore
ne font-elles pas foumifesà fa volonté, car il eft lui-
meme fournis à la règle qu’il a avoüéermais à fa dif-
cretion, pour en diipenfer fuivàntlaloide la charité
fuperieure à toutes les réglés.
Les particuliers doivent obéïffance au fuperieur ,
mais félon la réglé, ni plus ni moins : toutefois cette
obéïffance reftrainte au devoir eft imparfaite ; & le
vrai religieux fe porte volontairement à une obéïffance
auifi étendue que la charité , c’eft-à-dire , fans
bornes. Auifi l’obéïffance n’eft difficile que pour les
imparfaits, qui chicanent fur les commandemens ,
les examinent '8c en cherchent lesraifons; ne voulant
obéir qu’en ce qui eft de leur goût, ou dont ils ne
peuvent fe difpenfer. Or la délobéïffance qui vient
du mépris formel du precepte, eft beaucoup plus
coupable que celle qui ne vient que de négligence,
puifque celle-ci ne vient que d’une langueur de pa-
reffe , 8cl’autre d'une enflure d’orgueil, 8c par cette
raifon le mépris rend mortel le péché quineferoit que
veniel par la legereté de fa matière.
S.Bernard traite enfuite la queftion, s’il effiper»-
mis de paffer d’un monaftere à l’autre ; & ne le permet
qu’à ceux qui ne peuvent garder dans.-celui où
ils fe trouvent l’effentiel delà réglé qu’ils ont pro-
mife. Mais il ne permet pas à ceux qui font dans des
monafteresbien reglez de paffer à d’autres, fous prétexte
d’une plus grande perfection , comme de Clu-
gni à Cîteaux. Que fi quelqu’un eft forti par feru-
pule 8c par inquiétude, il ne lui confeille pas de res
B b b b iij
c.
C• 19»