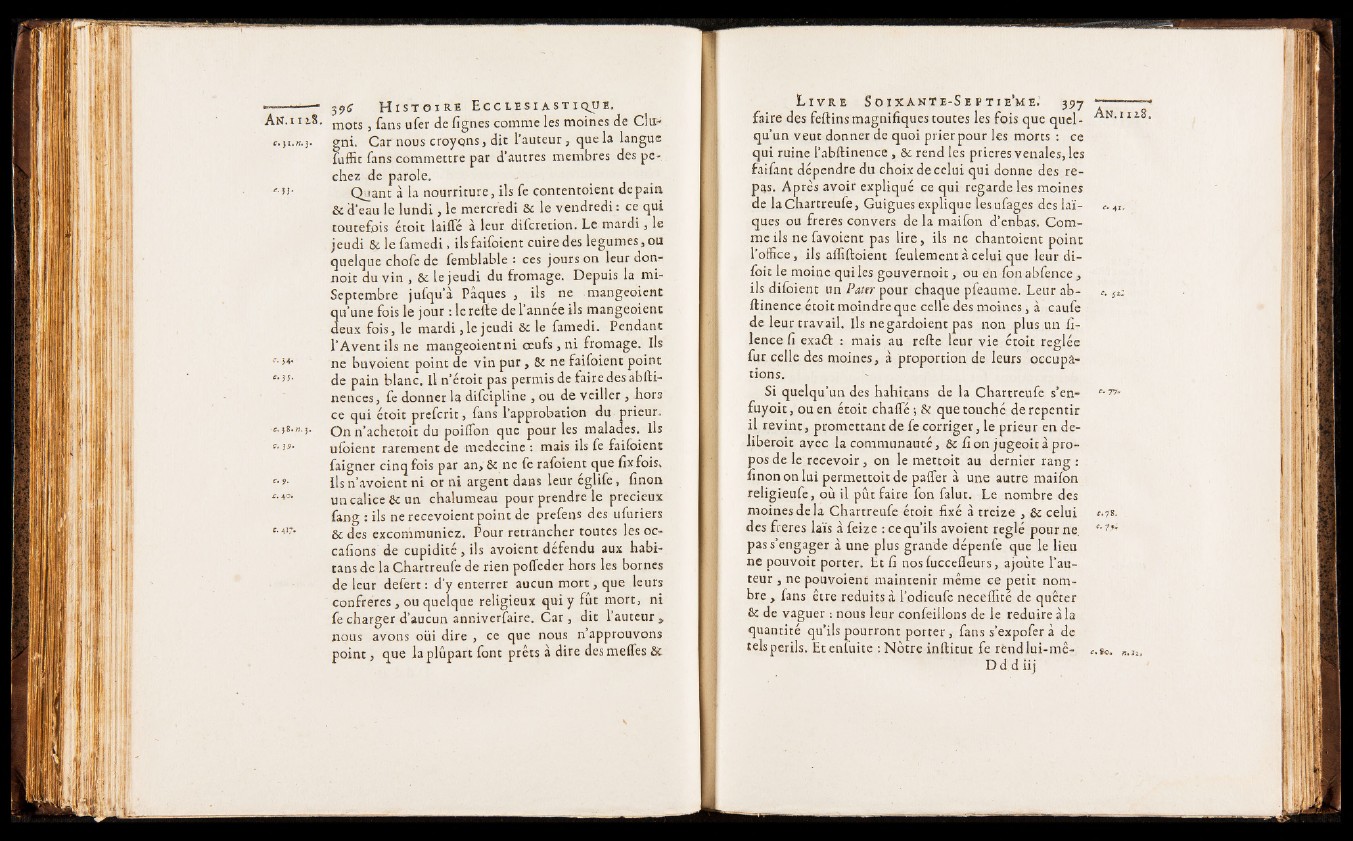
■ 39^ H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
A n . i i î.8. mots I fans ufcr Je fignes comme les moines de Clu-
î. ji.b.j. gni. Car nous croyons, dit l’auteur, que la langue
fuffit fans commettre par d’autres membres des pe-
chez de parole.
Quant à la nourriture, ils fe contentoient de pain
& d’eau le lu n d i, le mercredi 8c le vendredi : ce qui
toutefois étoit laide à leur difcretion. Le mardi, le
jeudi ô tle fam ed i, ils faifoient cuire des legumes,ou
quelque chofe de femblable : ces jours on leur don-
noit du vin , & le jeudi du fromage. Depuis la mi-
Septembre jufqu’à Pâques , ils ne mangeoient
qu’une fois le jour : le relie de 1 annee ils mangeoient
deux fois, le mardi , 1e jeudi ôc le famedi. Pendant
l’A v en tils ne mangeoientni oeufs, ni fromage. Ils
f-i4' ne buvoient point de vin pur , Si ne faifoient point
e‘ 5i- de pain blanc. Il n’étoit pas permis de faire des àbftinences,
fe donner la difcipline , ou de veiller , hors
ce qui étoit prcfcrit, fans l’approbation du prieur,
•c.58.».;. On n’achetoit du poilfon que pour les malades. Ils
Cê ,9' uloient rarement de médecine : mais ils fe faifoient
faigner cinq fois par an,'Si ne fe rafoient que fixfois»
Ilsn’avoient ni or ni argent dans leur églife, linon
£'4°’ un calice Sc un chalumeau pour prendre le precieux
fang : ils ne recevoient point de prefens des ufuriers
£'417* Si des excommuniez. Pour retrancher toutes les occalions
de cupidité, ils avoient défendu aux habi-
tansde laChartreufe de rien polfeder hors les bornes
de leur defert : d’y enterrer aucun m o r t, que leurs
confrères, ou quelque religieux qui y fut mort, ni
fe charger d’aucun anniverfaire. C a r , dit l’auteur •>
nous avons oüi dire , ce que nous n approuvons
p o in t, que la plupart font prêts à dire desmelfes &
--- _ ----------- - — J s J à
faire des feftins magnifiques toutes les fois que quel- ' 111
qu’un veut donner de quoi prier pour les morts : ce
qui ruine l’abilinence , Ôc rend les prières vénales, les
faifant dépendre du choix de celui qui donne des repas.
Après avoir expliqué ce qui regarde les moines
de la Chartreufe, Guigues explique les ufages des laï- c. 4r.
ques ou freres convers de la maifon d’enbas. Comme
ils ne favoient pas lire , ils ne chantoient point
l’office, ils affiftoient feulement à celui que leur di-
foit le moine qui les gouvernoit, ou en fon abfence,
ils difoient un Pater pour chaque pfeaume. Leur ab-
ftinence étoit moindre que celle des moines, à caufe
de leur travail. Ils negardoient pas non plus un fi-
lence fi exaét : mais au reile leur vie étoit réglée
fur celle des moines, à proportion de leurs occupations.
Si quelqu’un des hahitans de la Chartreufe s’en-
fu y o it, ou en étoit chaiTé ; & que touché de repentir
il revint, promettant de fe corriger, le prieur en de-
liberoit avec la communauté, & fi on jugeoit à propos
de le recevoir, on le mettoit au dernier ran g:
finononlui permettoit de pafler à une autre maifon
religieufe, où il pût faire fon falut. Le nombre des
moines de la Chartreufe étoit fixé à treize , & celui
des freres laïs à feize : ce qu’ils avoient réglé pour ne.
pas s’engager à une plus grande dépenfe que le lieu
ne pouvoir porter. Et fi nosfuccefleurs, ajoute l’auteur
, ne pouvoient maintenir même ce petit nombre
, fans être réduits à l’odieufe necefhté de quêter
&c de vaguer : nous leur confeillons de le réduire à la
quantité qu’ils pourront porter , fans s’expofer à de
tels périls. Etenfuite -.Nôtre inflitut fe rèndlui-mê-
D d d i i j
c. 78.
7 * .
C• $Qa fi* lia