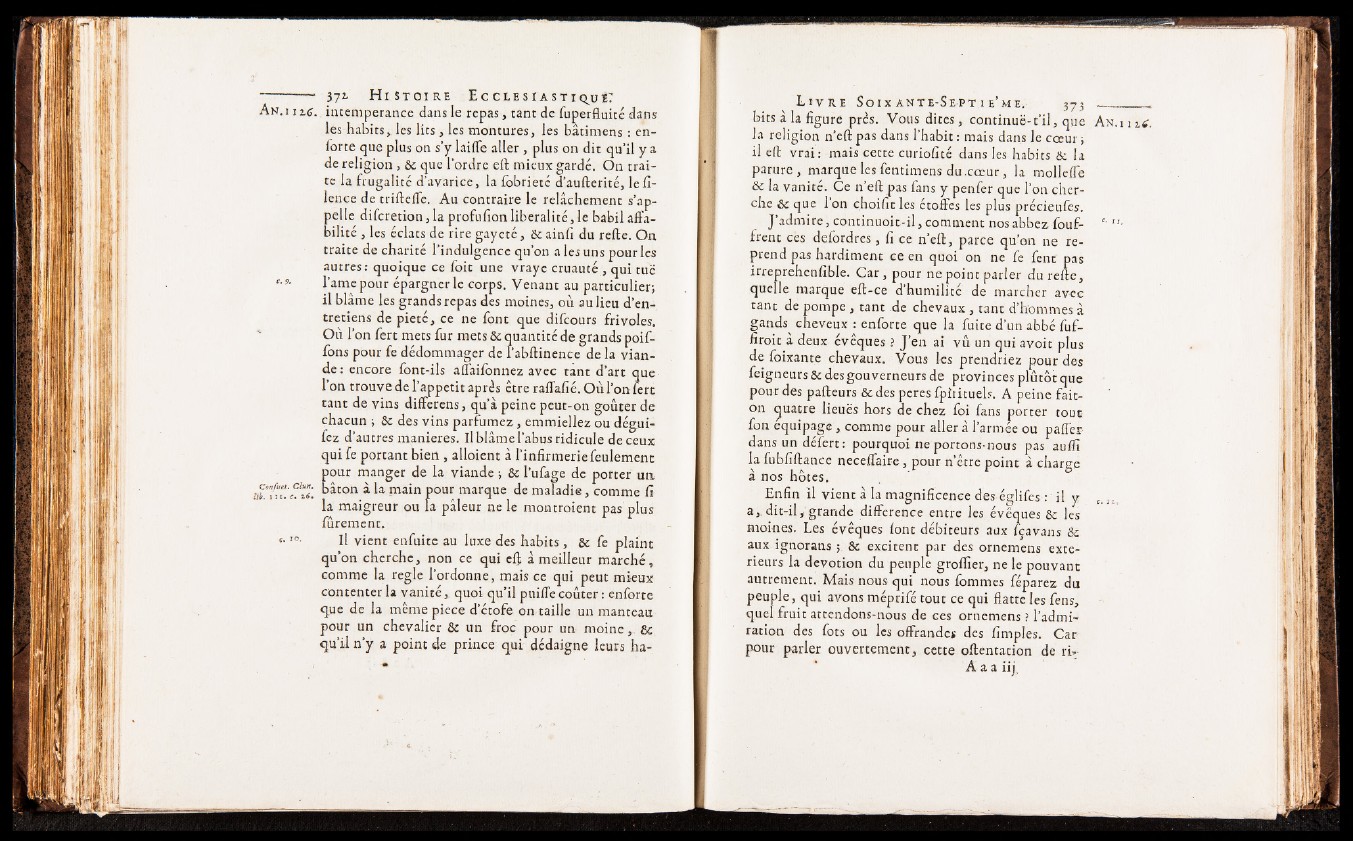
-------— 571 H i s t o i r e Ec c l e s i a s t i q u ê ?
An. j i z 6. intempérance dans le repas, tant de fuperfluité dans
les habits,, les lit s , les montures, les bâtimens : en-
forte que plus on s'y laifle a lle r , plus on dit qu’il y a
de rel igion , 8c que l’ordre eft mieux gardé. On traite
la frugalité d’avarice, la fobrieté d’aufterité, lefi-
lence de triftefle. Au contraire le relâchement s’appelle
difcretion, la profufion libéralité, le babil affabilité
, les éclats de rire g ay e té , 8c ainfi du refte. On
traite de charité l’indulgence qu’on a les uns pour les
autres: quoique ce foie une vraye cruauté , qui tuë
l ’ame pour épargner le corps. Venant au particulier;
il blâme les grands repas des moines, où au lieu d’entretiens
de pieté, ce ne font que difeours frivoles.
Où l’on fert mets fur mets 8c quantité de grands poif-
fons pour fe dédommager de l’abftinenee de la viande:
encore font-ils aflaiionnez avec tant d’art que
l’on trouve de l’appetit après être raflafié. Où l'on fert
tant de vins differens, qu’â peine peut-on goûter de
chacun ; 8c des vins parfumez , emmiellez ou dégui-
fez d’autres maniérés. Il blâme l’abus ridicule de ceux
qui fe portant bien , alloient à l’infirmerie feulement
pour manger de la viande ; 8c l’ufage de porter un
M È M bâton à la main pour marque de maladie, comme fi
la maigreur ou la pâleur ne le montraient pas plus
fûrement.
e-| Il vient enfuite au luxe des habits , & fe plaint
qu’on cherche, non ce qui eft à meilleur marché,
comme la réglé l’ordonne, mais ce qui peut mieux
contenter la v anité ,. quoi qu’il puiffe coûter : enforte
que de la même piece d’étofe on taille un manteau
pour un chevalier 8c un froc pour un moine,. 8c
qu’il n’y a point de prince qui dédaigne leurs ha-
L i v r e So i x a n t e -Se p t ie’ me.- 373 _
bits à la figure près. Vous dites, continuë-t’i l, que A n.i u î ,
la religion n’eftpas dans l’habit: mais dans le coeur;
il eft vrai: mais cette curiofité dans les habits & la
parure, marque les fentimens du.coeur, la mollefle
& la vanité. Ce n’eft pas fans y penfer que l’on cherche
&c que 1 on choifit les étoffes les plus précieufes.
J’admire, continuoit-il, comment nosabbez fouf- C l1-
frent ces deiordres, fi ce n’eft, parce qu’on ne reprend
pas hardiment ce en quoi on ne fe fent pas
irreprehenfible. Car , pour ne point parler du refte,
quelle marque eft-ce d’humilité de marcher avec
tant de pompe , tant de chevaux , tant d’hommes à
gands cheveux : enforte que la fuite d’un abbé fuf-
firoit à deux évêques ? J ’en ai vû un qui avoit plus
de foixante chevaux. Vous les prendriez pour des
feigneurs 8c des gouverneurs de provinces plûtôt que
pour des pafteurs 8c des peres fpirituels. A peine fait-
on quatre lieuës hors de chez foi fans porter tout
fon équipage , comme pour aller â l’armée ou pafler
dans un défert: pourquoi ne portons-nous pas auftî
la fubfiftance neceflfaire, pour n’être point â charge
à nos hôtes.
Enfin il vient à la magnificence des églifes : il y I jL
a,, dit-il/grande différence entre les évêques 8c les
moines. Les évêques iont débiteurs aux fçavans &
aux ignorans ; & excitent par des ornemens extérieurs
la dévotion du peuple grolfier, ne le pouvant
autrement. Mais nous qui nous fommes féparez du
peuple, qui avons méprifé tout ce qui flatte les fens,
quel fruit attendons-nous de ces ornemens ? l’admiration
des fots ou les offrande* des fimples. Car
pour parler ouvertement, cette oftentation de ri-
A a a iij.