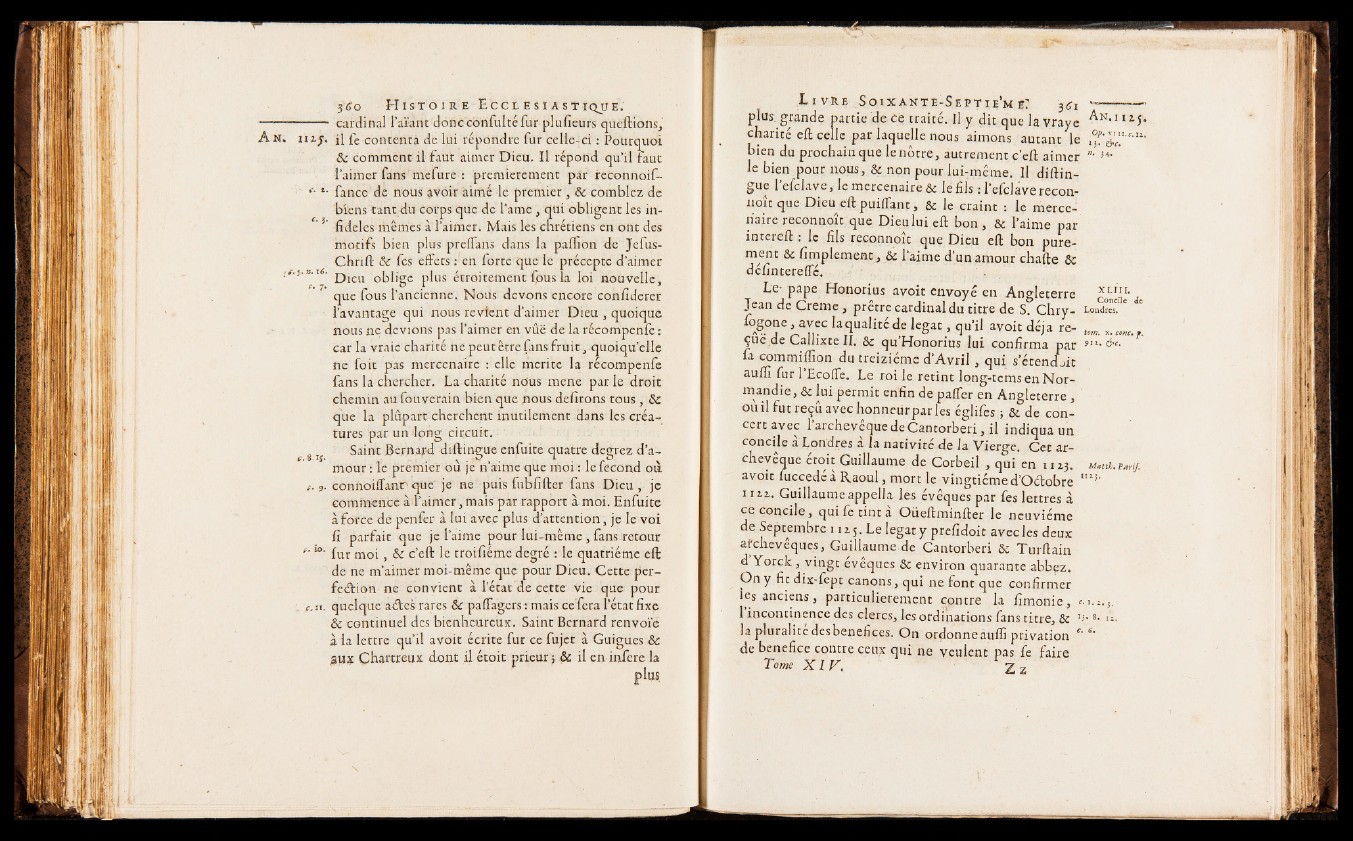
3<ro H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e ;
cardinal l’aïànt donc confulté fur plufieurs queftions,
A N. i i z j . ü fe contenta de lui répondre fur celle-ci : Pourquoi
& comment il faut aimer Dieu. Il répond qu’il faut
l’aimer fans'niefure : premièrement par reconnoif-
' fan.ce de nous avoir aimé le premier , & comblez de
biens tant du corps que de l’ame , qui obligent les in-
3 fideles mêmes à l’aimer. Mais les chrétiens en ont des
motifs bien plus preifans dans la paifion de Jefus-
Chrift & fes effets : en forte que le précepte d’aimer
f; 1 ‘ Dieu oblige plus étroitement fous la loi nouvelle,
que fous l’ancienne. Nous devons encore confiderer
l’avantage qui nous revient d’aimer Dieu , quoique
nous ne devions pas l’aimer en vûë de la récompeniè :
caria vraie charité ne peut être fans fru it, quoiqu’elle
ne foit pas mercenaire : elle mérité la récompenfe
fans la chercher. La charité nous mene par le droit
chemin aufouverain bien que nous defirons tous, &C
que la plupart cherchent inutilement dans les créatures
par un long circuit.
f i Saint Bernard dirtingue enfuite quatre degrez d’amour:
le premier où je n’aime que moi : le fécond où
fi 9. connoiffaniT' que je ne puis fubfifter fans Dieu , je
commence à l’aimer, mais par rapport à moi. Enfuite
à force dé penfer à lui avec plus d’attention, je le voi
fi parfait que je l’aime pour lui-même, fans retour
fj ” ■ fur m o i , 8c c’eft le troifiéme degré : le quatrième eft
de ne m’aimer moi-même que pour Dieu. Cette perfection
ne convient à 1 ecat de cette vie que pour
: e. 11. quelque aCtes rares &c paffagers : mais ce fera i’état fixe
& continuel des bienheureux. Saint Bernard renvoie
à la lettre qu’il avoit écrite fur ce fujcr à Guigues &
£ux Chartreux dont il étoir prieur} & il en infere la
pliis
L 1 v r e S o i x a n t e - S e e t i e ’m e; ■¡g!
plus, grande partie de ce traité. Il y dit que lav ra y e
charité eft celle par laquelle nous aimons autant le
bien du prochain que le nôtre, autrement c’eft aimer
le bien pour nous, & non pour lui:même. Il diftin-
gue l’efclave, le mercenaire 8c le fils : l’efclâve recon-
noît que Dieu eft puiffanc, 8c le craint : le mercenaire
reconnoît que Dieului eft b on , 8c l’aime par
intereft : le fils reconnoïc que Dieu eft bon purement
8c Amplement, 8c l’aime d’un amour chafte 8c
dcfîntereffc.
Le- pape Honorius avoit envoyé en Angleterre
Jean de Creme , prêtre cardinal du titre de S. Chry-
fogone , avec la qualité de lé g a t , qu’il avoit déjà re-
çuë de Callixte II. 8c qu’Honorius lui confirma par
fa commifîiQn du treizième d’A v r il , qui s’étendait
auffi fur 1 Ecoffe. Le roi le retint long-tems en N ormandie,
8c lui permit enfin de paifer en Angleterre ,
ou il fut reçu avec honneiirpar les egliies ; 8c de con-
cerc avec 1 archevequedeCantorberi, il indiqua un
concile à Londres à la nativité de la Vierge. Cet archevêque
étoit Guillaume de Corbeil , qui en 1113,
avoic fuccedea Raou l, mort le vingtième d’OCiobre 1
i i z z . Guillaume appella les évêques par fes lettres à
ce concile, qui fe tint à Oüeftminfter le neuvième
de Septembre 1115. Le légat y prefidoit avec les deux
areneveques, Guillaume de Cantorberi &z Turftain
d’Y o r c k , vingt évêques 8c environ quarante abbçz.
On y fie dix-fepe canons, qui ne font que confirmer
les anciens, particulièrement contre la fimonie, «
1 incontinence des clercs, les ordinations fans titre, 8c 1
la pluralité des bénéfices. On ordonneaulfi privation c
de benefice contre ceux qui ne veulent pas fe faire
Tome X I V . Z z
A n. h z j .
Op. vi u .c .i z .
1-3« & c .
n. 34.
X L I I I .
Concile de
Londres.
tom. x. conc. f .
9 i i . & c .
Matth. Tarif.
B i
3- s.
, 6.