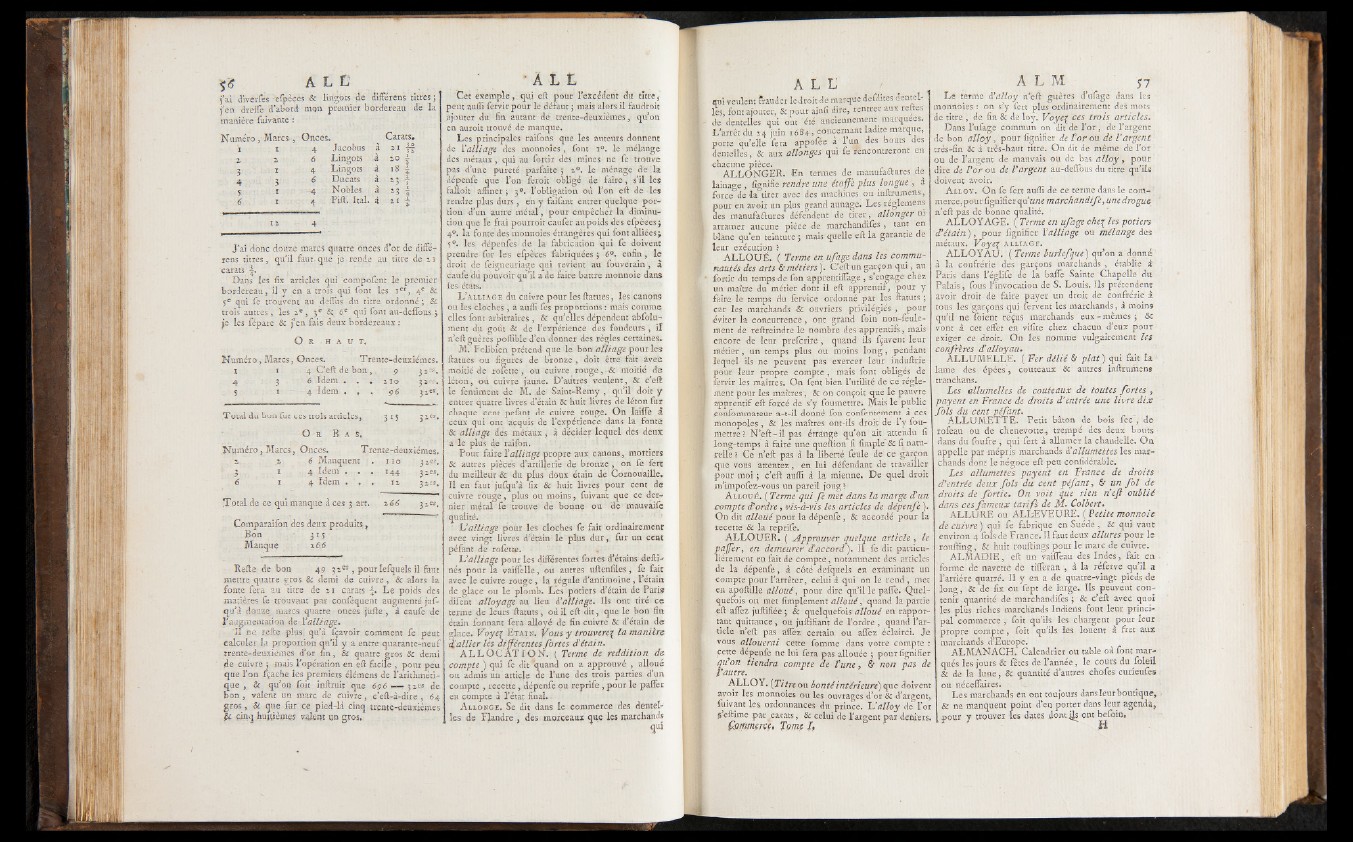
j’ai diverfes -efpèees & lingots de différens titres ;
j’en dreffe d’abord mon premier bordereau de la
manière fuivahte :
Numéro, Marcs-, Onces. Carats.
1 1 r 4 Jacobus à z i -f|
a : a 6 Lingots à zo i
w p j 1 4 Lingots à 18 4
6 Ducats à
5 ï 4 Nobles à z 3 4
6 3 i 4 Piftvltal. à . z i i
la - 4 ;
J’ai donc douze marcs quatre onces d’or de différens
titres, qu’il faut-que je rende au titre de zi
carats^.
Dans les fix articles qui compofent le premier
bordereau, il y en a trois qui font les Ier, 4® &
5e qui fe trouvent au deffus du titre ordonné 3 &
trois autres , les ze , 3 e & 6e qui font au-deffous-3
je les fepare & j’en.fais deux bordereaux :
O R. H A . U T.
Numéro, Marcs, Onces. Trente-deuxièmes.
1 1 . "4 C’eft de bon , v
4 3 6 Idem . . .
5 1 — - 4 Idem • , ,
9
a ïo
96
3 2 es.
3 z«.
.Total du bon fur ces trois articles, 3 1? 5 !« .
O r B a s.
Numéro, Marcs, Onces, Tren te-deuxiémes.
z a 6 Manquent 1 . IIO ■ 3 z es.
3 1 4 Idem , . . 1 4 4 3 zes.
6 1 4 idem . , , IZ 3 2 es.
Total de ce qui manque à ces 3 art. z 66 i
Comparaifon des deux produits,
Bon • 315
Manque z 66
Refte de bon 49 32 e5, pour lefquels il faut
mettre quatre gros & demi de cuivre, & alors la
fonte fera au titre de z 1 carats | . Le poids des
matières fe trouvant par conféquent augmenté juf-
qu’à douze marcs quatre onces jufte à caufe de
l ’augmentation de l'alliage.
Il ne, refte plus, qu’à fçavoir comment fe peut
calculer la proportion qu’il y a entre quarante-neuf
trente-deuxièmes d’or fin, & quatre gros & demi
de cuivre ; mais l’opération en eft facile , pour peu
que l’on fçaehe les premiers élémens de l’arithmétique
, & qu’on foit inftruit que 696 ■—■ 3 z es de
bon , valent un marc de cuivre , e’eft-à-dire , 64
g ro s, & que fur ce pied-là cinq trente-deuxièmes
çiqq huitièmes valent un gros»
Cet exemple,.qui eft pour l’excédent dit titre,
peut aufli fervir pour le défaut 3 mais alors il faudroit
ajouter du fin autant de trente-deuxièmes, qu’on
en auroit trouvé de manque.
Les principales raifons que les auteurs donnent
de Y alliage des monnoies , font i°. le mélange
des métaux, qui au fortir des mines ne fe trouve
pas d’une pureté parfaite 3 z°. le ménage de la
dépenfe que l’on ferait obligé de faire, s’il les
failoit affiner 5 30. l’obligation où l’on eft de les
rendre plus durs , en y faifant entrer quelque portion
d’un autre métal, pour empêcher la diminution
que le frai pourroit caufer au poids des efpèees 3
4°. la fonte des monnoies étrangères qui font alliées 3
5°. les dépenfes de la fabrication qui fe doivent
prendre fur le s efpèees fabriquées 3 6°. enfin, le
droit de feigneuriage qui revient au fouverain , à
caufe dû pouvoir qu’il a de faire battre monnoie dans
les- états.
L’alliage du cuivre pour les ftatues, les canons
ou les cloches , a aufli fes proportions : mais comme
elles font arbitraires , & qu’elles dépendent abfolu-
ment du goût & de l’expérience des fondeurs , iî
n’eft guères poflîble d’en donner des règles certaines.
M. Felibien prétend que le bon alliage pour les
ftatues ou figures de bronze, doit être fait avec
moitié de rolette , ou cuivre rouge, ■ & moitié de
léton, où cuivre jaune. D’autres veulent, & c’eft
le fentiment de M. :de Saint-Remy , qu’il doit y
| entrer quatre livres d’étain & huit livres de léton fur
chaque cent pefant de cuivre rouge. On laiffe a
ceux qui ont acquis de l’expérience dans la fonte
8c alliage dés- métaux 5 à décider lequel des deux
'a le plus de raifon.
Pour faire Y alliage propre aux canons, mortiers
1 & autres pièces d’artillerie de bronze , on fe fert
du meilleur & du plus doux étain de Cornouaille.
Il en faut jufqu’à fix & huit livres pour cent de
cuivre rouge', plus ou moins, fuivant que ce dernier
métal fe trouve de bonne ou de mauvaifc
qualité.
U alliage pour les cloches fe fait ordinairement
avec vingt livres d’étain le plus du r, fur un cent
péfant de rolette.
L3alliage pour les différentes fortes d’étains defti-
nés pour la vaifîëlle, ou autres uftenfiles, fe fait
avec le cuivre rouge, la régule d’antimoine , l’étain
1 de glace ou le plomb. Les potiers d’étain de Paris
! difeiit alloyage au lieu & alliage. Ils ont tiré ce
terme de leurs ftatuts , où il eft dit, que le bon fin
j étain fonnant fera alloyé de fin cuivré & d’étain de
glace. Voyez Etain. V ous y trouverez la manierez,
a, allier les différentes fortes d'étain.
A L L O C A T IO N . ( Terme de reddition de.
compte ) qui fe dit -quand on a approuvé , alloue
ou admis un article de l’une des trois parties d’un
compte , recette , idépenfe ou reprife, pour le pafler
en compte à l’état final. •
Allonge. Se dit dans le- commerce des dentelles
de Flandre , des morceaux que les marchands
<jui
m
gui veulent frauder le droit de marque defdites dentelles,
font ajouter, & pour ainfi dire, rentrer aux relies
de dentelles qui ont été anciennement marquées.
L’arrêt du Z4 juin 1684, concernant ladite marque,
porte quelle fera appofée à 1 un des bouts des
dentelles, & aux allonges qui fe rencontreront en
chacune pièce.
ALLONGER. En termes de manufactures .de
lainage , fignifîe rendre une étoffe plus longue , à
force de la tirer avec des machines ou inftrumens,
pour en avoir un plus grand aunage. Les réglemens
des manufactures défendent de tirer, allonger ni
arramer aucune pièce de marchandifes , tant en
blanc qu’en teinture j mais quelle eft la garantie de
leur exécution ?
ALLOUÉ. ( Terme en ufage dans Us communautés
des arts & métiers ). C’eft un garçon q u i, au
fortir du temps de fon apprentifîage , s’engage chez
un maître du métier dont il eft apprentif, pour y
faire le temps du fervice ordonné par les ftatuts 3
car les marchands & ouvriers privilégiés , pour
éviter la concurrence, ont grand foin non-feulement
de teftreindre le nombre des apprentifs, mais
encore de leur prefcrire , quand ils fçavent leur
métier, un temps plus ou moins lo n g , pendant
lequel ils ne peuvent pas exercer leur induftrie
pour leur propre compte, mais font obligés de
:fervir les maîtres. On fent bien l’utilité de ce réglement
pour les maîtres', & on conçoit que le pauvre
apprentif eft forcé de s’y fou mettre. Mais le public
.confommateur a-t-il donné fon confentement à ces
monopoles , & les niaîtres ont-ils droit de l’y fouine
ttre ? N’e ft-il pas étrange qu’on ait attendu fi
long-temps à faire une queftion fi fimple & fi naturelle
? Ce n’eft pas à la liberté feule de ce garçon
que vous attentez, en lui défendant de travailler
pour moi 5 c’eft aufli à la mienne. De quel droit
m’iinpofez-vous un pareil joug?
Alloué. ( Terme qui f e met dans la marge d'un
compte d’ordre, vis-à-vis les articles de dépenfe ).
On dit alloué pour la dépenfe, 8ç accordé pour la
recette & la reprife.
ALLOUER. ( Approuver quelque article , le
paffer, en demeurer d'accord ). Il fe dit particulièrement
en fait de compte, notamment des articles
de la dépenfe, à côté defquels en examinant un
compte pour l’arrêter, celui à qui on le rend , mec
en apoftille alloué, pour dire qu’il le paffe. Quelquefois
on met Amplement alloué, quand la partie
eft affez juftifîée3 & quelquefois alloué en rapportant
quittance , ou juftifîant de l’ordre , quand l’article
n’eft pas allez certain ou affez éclairci. Je
vous allouerai cette fomme dans votre compte :
cette dépenfe ne lui fera pas allouée 3 pour lignifier
qu’on tiendra compte de l'une , & non pas de
Vautre.
ALLO Y. (Titre ou bonté intérieure) que doivent
avoir les monnoies ou les ouvrages d’or 8c d’argent,
fuivant les ordonnances du prince. L'alloy de l’or
peftime par^carats, & celui de l’argent par deniers.
Ççffltnprcç» Tpmç I f
Le terme à’alloy n’èft guères d’ufage dans les
monnoies : on s’y fert plus ordinairement des mots
de titre , de fin & de loy. Voyez ces trois articles.
Dans l’ufage commun on dit de l’o r , de l’argent
de bon alloy, pour lignifier de l'or ou de l'argent
très-fin & à très-haut" titre. On dit de même de l’or ■
ou de l’argent de mauvais ou de bas alloy , pour
dire de l ’or ou de l’argent au-deffous du titre qu’ils
doivent avoir. ■
Alloy. On fe fert aufli de ce terme dans le commerce,
pour lignifier qu'une marchandife, une drogue
n’eft pas de bonne qualité.
ALLOYAGE. ( Terme en ufage che{ les potiers
d’étain) y pour lignifier Y alliage ou mélange des
métaux. Voyez alliage.
ALLOYAU. ( Terme burlefque) qu’on a donné
à la confrérie des garçons marchands , établie à
Paris dans Téglife de la baffe Sainte Chapelle du
Palais, fous l’invocation de S. Louis. Ils prétendent
avoir droit-de faire payer un droit de confrérie à
tous les garçons qui fervent les marchands, à moins
qu’il ne foient reçus marchands eux - mêmes 3 &
vont à cet effet en vifite chez chacun d’eux pour
exiger ce droit. On les nomme vulgairement les
confrères d'alloyau.
ALLUMELLE. ( Fer délié & plat ) qui fait la
lame des; épées , couteaux & autres inftrumens
tranchans.
Les allumelles de couteaux de toutes fortes ,
payent en France de droits d'entrée une livre dix
fols du cent péfant.
ALLUMETTE. Petit bâton de bois fec , de
rofeau ou de chenevotte., trempé des deux bouts
dans du foufre , qui fert à allumer la chandelle. On
appelle par -mépris marchands d'allumettes les marchands
dont le négoce eft peu confidérable.
Les allumettes payent en France de droits
d’entrée deux fols du cent péfant, & un fo l de
droits de fortie. On voit que rien n'eft oublié
dans ces fameux tarifs de M. Colbert.
ALLURE ou ALLEVEURE. ( Petite monnoie
de cuivre ) qui fe fabrique en Suède , & qui vaut
environ 4 fols de France, Il faut deux allures pour le
roufting, & huit rouftings pour le marc de cuivre.
ALMADIE, eft un vaiffeau des Indes, fait en
forme de navette de tilïeran , à la réferve qu’il a
l’arrière quarré. Il y en a de quatre-vingt pieds de
long, & de fix ou fept de large. Ils peuvent contenir
quantité de marchandifes ; & c’eft avec quoi
les plus riches marchands Indiens font leur principal
commerce , foit qu’ils les chargent pour leur
propre compte, foit qu’ils les louent à fret aux
marchands d?Europe.
ALMANACH. Calendrier ou table où font marqués
les jours & fêtes de l’année, le cours du foleîl
& de la lune, 8c quantité d’autres ehofes curieufes
ou nécefîaires. ■ v_
Les marchands en ont toujours dans leur boutique,
& ne manquent point d*en porter dans leur agenda,
pour y trouver les dates dont jjs ont befoin»