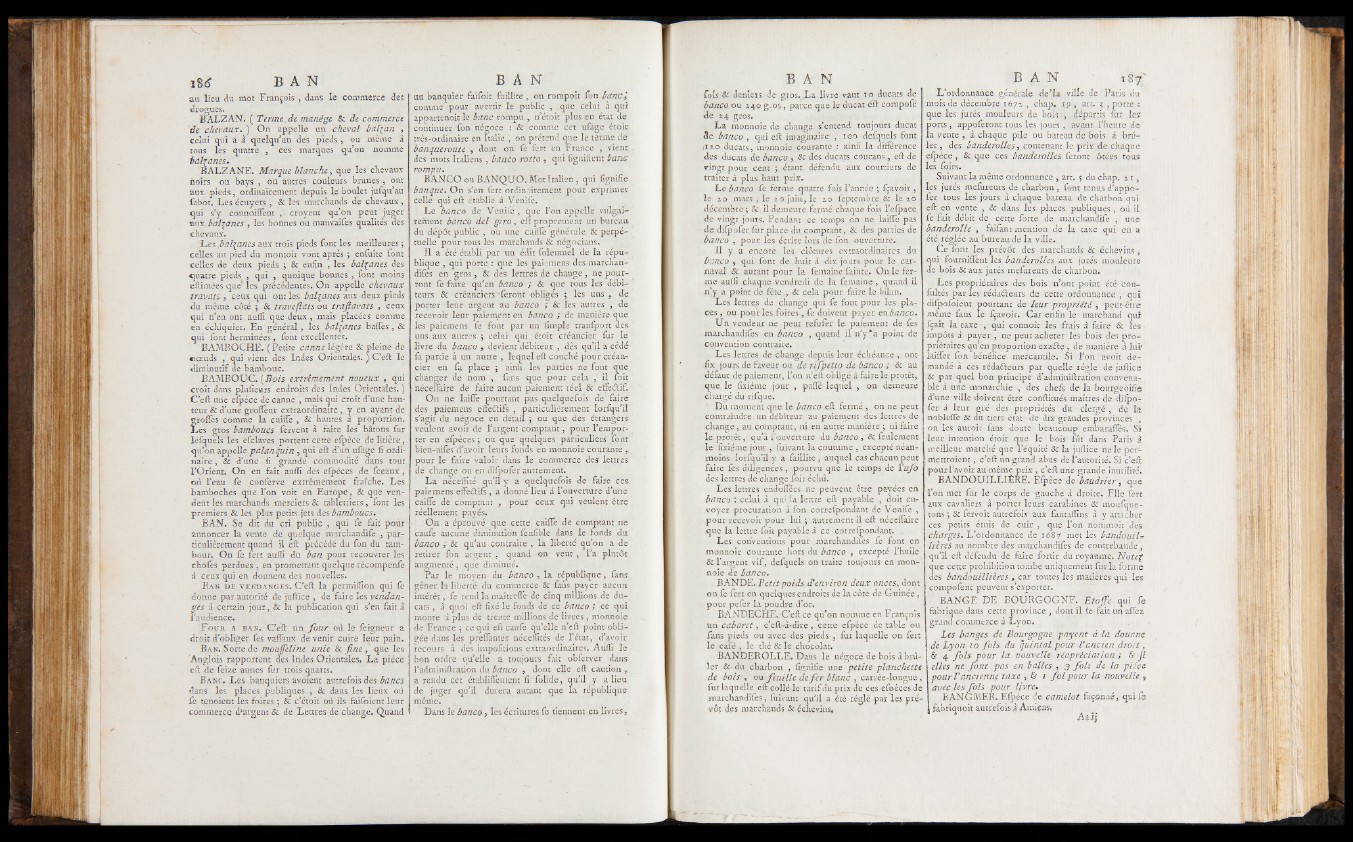
au lieu du mot François -, dans le commerce des
drogues.
BALZAN. ( Terme. de manège 8c de commerce
de chevaux. ) On appelle un cheval balzan ,
celui qui a à quelqu’un des pieds , ou même à
tous les quatre , ces marques quon nomme
balzanes*
BALZANE. Marque blanche, que les chevaux
noirs ou bays , ou autres couleurs brunes , ont
aux pieds, ordinairement depuis le boulet jufqu’au
fabot. Les écuyers , & les marchands de chevaux,
qui s’y connoiflent , croyent qu’on peut juger
auxtbut^aneÈ, les bonnes ou mauvaifes qualités des
chevaux.
Les faisanes aux trois pieds font les meilleures ;
celles au pied du montoir vont après ; enfuite font
celles de deux pieds ; & enfin , les balzanes des
•quatre pieds , qui , quoique bonnes , font moins
eftimées que* les précédentes. On appelle chevaux
travats , ceux qui ont les balzanes aux deux pieds
du même côté ; & travefiats ou trafiavats , ceux
qui n’en ont auflî que deux, mais placées comme
en échiquier. En général, les balzanes baffes, &
qui font herminées , font excellentes.
BAMBOCHE. (Petite canne légère & pleine de
«iceuds , qui vient des Indes Orientales. ) C’eft le
diminutif de bambouc.
BAMBOUC. (Bois extrêmement noueux , qui
croît dans plufîeurs endroits des Indes Orientales. )
C’eft une efpèce de canne , mais qui croît d’une hauteur
& d’une grofïeur extraordinaire, y. en ayant de
greffes comme la cuiffe , & hautes a proportion.
Les gros bamboucs fervent à faire les bâtons fur
léfquels les efclaves portent cette efpèce de litière,
qu’on appelle palanquin, qui eft d’un ufage fi ordinaire
, & d’une fi grande commodité dans tout
l’Orienti On en fait auffi des efpèces de fceaux,
où l’eau fe conferve extrêmement fraîche. Les
bamboches que l’on voit en Europe, & que vendent
les marchands merciers & tablettiers, font les
premiers & les plus petits jets des bamboucs.
BAN. Se dit du cri public , qui fe fait pour
annoncer la vente de quelque marchandife , particulièrement
quand il eft précédé du fon du tambour.
On fe fert auffi du ban pour recouvrer les
chofes perdues , en promettant quelque récompenfe
à ceux qui en donnent des nouvelles.
B a n d e v e n d a n g e s . C’eft la permiffion qui fe
donne par autorité de juftîce , de faire les vendanges
à certain jour, & la publication qui s’en fait à
l ’audience.
F o u r a b a n . C’eft un fo u r où le feigneur a
droit d’obliger fes vaflaux de venir cuire leur pain.
B a n . Sorte de moufjeline unie 8c f in e , que les
Anglais rapportent des Indes Orientales. La pièce
eft de feize aunes fur trois quarts.
B a n c . Les banquiers avoient autrefois des bancs
dans les places publiques , & dans les lieux où
fe tenoient les foires 5 & c’étoit où ils faifoient leur
commerce d’argent & de Lettres de change. Quand
un banquier faifoit faillite, on rompoit fon batte ^
comme pour avertir le public , que celui à qui
appartenoit le banc rompu , n’étoit plus en état de
continuer fon négoce : & comme cet ufage étoic
très-ordinaire en Italie , on prétend que le terme de
banqueroute , dont on fe fert en France , vient
des mots Italiens , banco rotto , qui lignifient banc
rompu.
BANCO ou BANQUO. Mot Italien, qui lignifie
banque. On s’en fert ordinairement pour exprimer
celle qui eft établie à Venife.
Le banco de Venife, que l’on appelle vulgairement
banco del giro, eft proprement un bureau
du dépôt public , ou une caille générale & perpétuelle
pour tous les marchands & négocians.
Il a été établi par -un édit folemnel de la république
, qui porte : que les paiemens des marchandifes
en gros, & des lettres de change, ne pourront
fe faire qu’en banco ; 8c que tous les débiteurs
& créanciers ""feront obliges ; les uns de
porter leur argent au banco > & les autres , de
recevoir leur paiement en banco } de manière que
les paiemens fe font par un fimple tranlport des
uns aux autres ÿ celui qui étoit créancier fur le
livre du banco , devient débiteur , dès qu’il a cédé
fa partie à un autre , lequel eft couché pour créancier
cier en fa place place 5 ainfi les parties ne font que
que
changer de nom , fans que pour cela , il foie
néceîlaire de faire aucun paiement réel & effectif..
On ne laiffe pourtant pas quelquefois de faire
des paiemens effeéUfs , particulièrement lorfqu’il
s’agit du négoce eh détail ; ou que des étrangers
veulent avoir de l’argent comptant, pour l’emporter
en efpèces ; ou que quelques particuliers font
bien-aifes d’avoir leurs fonds en monnoie courante ,
pour le faire valoir dans le commerce des' lettres
de change ou en difpofer autrement.
La neceffité qu’il y a quelquefois de faire ces
paiemens effectifs, a donné lieu à l’ouverture d’une
caifle de comptant , pour ceux qui veulent être?
réellement payés.
Ori a éprouvé que cette caiffe de comptant ne
caufe aucune diminution fenfible dans le fonds du
banco ; & qu’au,contraire , la liberté qu’on a de
retirer fon argent , quand on veut , 1 a plutôt
augmenté, que diminue.
Par le moyen du banco , la république, fans
gêner la liberté du commerce & fans payer aucun
intérêt, fe rend la maîtrefl'e de cinq millions de ducats
, à quoi eft fixé le fonds de ce banco ÿ ce qui
monte à plus de trente millions de livres, monnoie
de France $ ce qui eft caufe qu’elle n’eft point obligée
dans les preffàntes néeeffîtés de l’état, d’avoir
recours à des impofîtions extraordinaires. Auffi le
bon ordre qu’elle a toujours fait obferver dans
l’adminiftration du banco , dont elle eft caution ,
a rendu cet établiffement fi folide, qu’il y a lieu
de juger qu’il durera autant que la république
même.
Dans le banco > les écritures fe tiennent en livres,
fols 8c deniers de gros.,La livre vaut 10 ducats de
banco ou 240 g,os, parce que le ducat-eft compofé
de 24 gros.
La monnoie de change s’entend toujours ducat
5 e banco , qui eft imaginaire , 100 defquels font
il20 ducats, monnoie courante : ainfi la différence
des ducats de banco , 8c des ducats courans, eft de
vingt pour cent ; étant défendu aux courtiers de
traiter a plus haut prix.
Le banco fe ferme quatre fois l’année ; fçavoir ,
le 20 mars , le 20 juin, le 20 feptembre & le 20
décembre $ & il demeure fermé chaque fois l’efpace
de vingt jours. Pendant ce temps ôn ne laiffe pas
de difpofer fur place du comptant, & des parties de
banco , pour les écrire lors de fon ouverture.
Il y a encore les clôtures extraordinaires du
banco y qui font de huit â dix jours pour le carnaval
& autant pour la femaine fainte. On le ferme
auffi chaque vendredi de la femaine , quand il
n ’y a point de fête , & cela pour faire le bilan.
Les lettres de change qui fe font pour les places
, ou pour les foires , fe doivent payer en banco. Un vendeur ne peut refufer le paiement de fes
marchandifes en banco , quand il n’y*a point de
convention contraire.
Les lettres de change depuis leur échéance , ont
fix jours de faveur ou de rifpetto de banco ; 8c au
défaut de paiement, l’on n’eft obligé à faire le protêt,
que le fixiéme jour , pafîe lequel , on demeure
chargé du rifque.
Du moment que le banco eft fermé , on ne peut
contraindre un débiteur au paiement des lettres de
■change, au comptant, ni en autre manière ; ni faire
le protêt, qu’à l’ouverture du banco , 8c feulement
le fixiéme jour , fuivant la coutume , excepté néanmoins
lorfqu’il y a faillite, auquel cas chacun peut
faire fes diligences, pourvu que le temps de Yufo
des lettres de change foit échu.
Les lettres endofïees ne peuvent être payées en
banco : celui à qui la lettre eft payable , doit envoyer
procuration à fon correfpondant de Venife ,
pour recevoir pour lui ; autrement il eft néceflaire
que la lettre foit payable à ce correfpondant. .
Les conventions pour marchandifes fe font en
monnoie. courante hors du banco , excepté l’huile
& l’argent vif, defquels on traite toujours en monnoie
de banco.
BANDE. Vêtit poids à! environ deux onces, dont
on fe fert en quelques endroits de la côte de Guinée,
pour pefer la poudre d’or.
BANDECHE. C’eftce qù*on nomme en François
un cabaret, c’eft-à-dire , cette efpèce de'table ou
fans pieds ou avec des pieds , fur laquelle on fert
le café , le thé & le chocolat.
B ANDEROLLE. Dans le négoce de bois à brûler
&• du charbon , lignifie une petite planchette
de bois , ou feuille de f e r blanc , carrée-longue,
fur laquelle eft collé le tarif du prix de ces efpèces de
marchandifes, fuivant qu’il a été réglé par les pré-
vôp des marchands'& échevins.
L ’ordonnance générale de>la ville de Paris du
mois de décembre 1672 , chap. ip , art. $ , porte :
que les jurés mouleurs de bois départis fur les
ports, appoferont tous les jours , avant l’heure de
la vente , à chaque pile ou bateau de bois à brûle
r, des banderolles, contenant le prix de chaque
efpèce, & que ces banderolles feront ôtées tous
les loirs.
Suivant la même ordonnance, art. 5 du çhap. 2 1,
les jurés mefureurs de charbon, font tenus d’appo-
fer tous les jours à chaque bateau de charbon qui
eft en vente , & dans les places, publiques, où il
fe fait débit de cette forte de marchandife , une
banderolle , faifant mention de la taxe qui en a
été réglée au bureau de la ville.
Ce font les prévôt des marchands & échevins,
qui fourniflent les banderolles aux jurés mouleurs
de bois & aux jurés mefureurs de charbon.
Les propriétaires des bois n’ont point été con-
fultés par les rédacteurs de cette ordonnance , qu»
difpofoient pourtant de leur propriété, peut-être
même fans le fçavoir. Car enfin le marchand qui
fçait la taxe , qui connoît les frais à faire & les
impôts à payer , ne peut acheter les bois des propriétaires
qu’en proportion exaCte , de manière à lui*
laiffer fon bénéfice mercantile. Si l’on avoit demandé
à ces rédacteurs par quelle régie de juftice
& par quel bon principe d’aaminiftration convenable
à une monarchie , des chefs de la bourgeoifie
d’une ville doivent être conftitués maîtres de difpofer
à leur gré des propriétés du clergé , de la
noblefîe & du tiers état de dix grandes provinces .,
on les auroic fans doute beaucoup embarafles. Si
leur intention étoit que le bois fut dans Paris à
meilleur marché que l’équité & la juftice ne le per-
mettroient, c’eft un grand abus de l’autorité. Si c’eft
pour l’avoir au même p rix , c’eft une grande inutilité.
BANDOUILLIÈRE. Efpèce de baudrier f que
l’on met fur le corps de gauche à droite. Elle fert
aux cavaliers à porter leurs carabines & moufque-
tons ; & fervoit autrefois aux fantaffins à y attacher
ces petits étuis de cuir , que l’on nonimoit des
charges. L’ordonnance de 1687 met les bandouil^
Hères au nombre des marchandifes de contrebande,
qu’il eft défendu de faire fortir du royaume. NoteÇ
que cette prohibition tombe uniquement fur la forme
des bandouillières , car toutes les matières qui les
compofent peuvent s exporter.
BANGE DE BOURGOGNE. Etoffe qui fe
fabrique dans cette province , dont il fe fait un affez
grand commerce à Lyon. .
Les banges de Bourgogne payent à la douane
de Lyon 10 fo ls du quintal pour Vancien dro it,
& 4 fo ls pour la nouvelle réapréciation ; 8> f i
elles ne fo n t pas en balles , .9 fo ls de la piéçe
pour Vancienne taxe , & 1 f o l pour la nouvelle ,
avec les fo ls pour livre•
BANGMER. Efpèce de camelot façonné, qui fe
fabriquoit autrefois à Amiçns.
' ’ As. I j