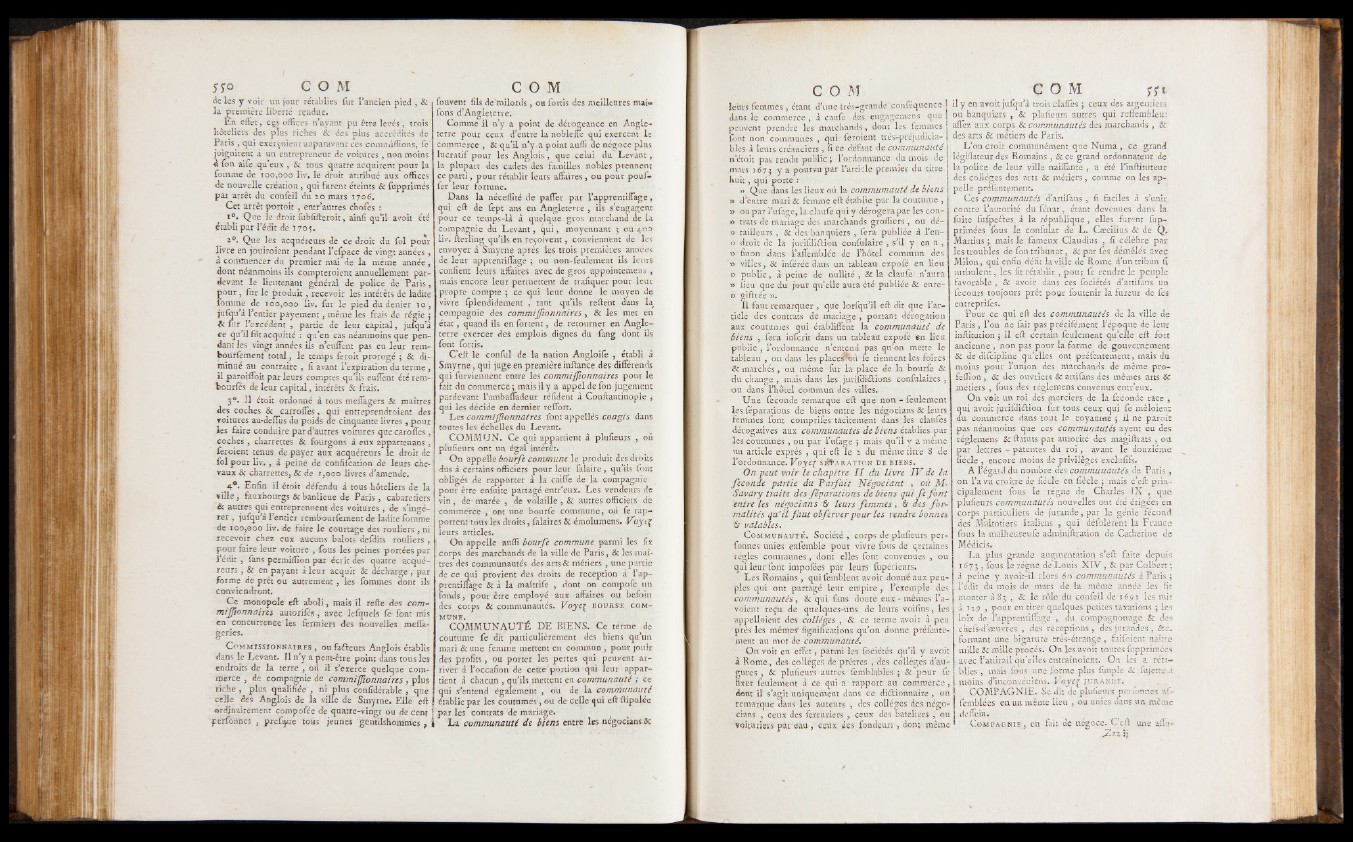
de les y voir un jour rétablies fur l'ancien pied , &
la première liberté rendue.
En effet, cgs offices n’ayant pu être levés, trois'
hôteliers des plus riches & des plus accrédités de
Paris , qui exerçoient auparavant ces commiffions, le'
joignirent à un entrepreneur de voitures , non moins
■ à fon aile qu’eux , & tous quatre acquirent pour la
fomme de 100,000 liv, le droit attribué aux offices
de nouvelle création, qui furent éteints & fupprimés
par arrêt du confeil du 10 mars 1706.
Cet arrêt portoit , entr’aùtres choies :
i°. Que le droit fubfifteroit, ainfi qu’il avoit été
établi par l’édit de 1705.
20. Que les acquéreurs de ce droit du fol pour
livre en jouiroienc pendant l’elpace de vingt années ,
a commencer du premier mai de la même année,
dont néanmoins ils compteroient annuellement par-
devant le lieutenant général de police de Paris,
p o u r, fur le produit, recevoir les intérêts de ladite
fomme de 100,000 liv. fur le pied du denier 10 ,
jufqu’à l’entier payement, même les frais de régie j
& lur l’excédent , partie de leur capital, juiqu’à
ce qu’il fut acquitté : qu’en cas néanmoins que pendant
les vingt années ils n’eulîent pas eu leur rem-
hourfement total, le temps feroit prorogé ; & diminué
au contraire , fi avant l’expiration du terme ,
il paroifloit par leurs comptes qu’ils euffent été rem-
hourfés de leur capital, intérêts & frais.
30. Il étoit ordonné à tous mefiagers & maîtres
des coches & carroffès, qui entreprendroient des
voitures au-defius du poids de cinquante livres 9 pour
les faire conduire par d’autres voitures quecaroffes ,i
coches , charrettes & fourgons a eux appartenanS ,
feroient tenus de payer aux acquéreurs le droit de
fol pour liv ., à peine de confifcation de leurs chevaux
& charrettes, & de 1,000 livres d’amende.
4°. Enfin il étoit défendu à tous hôteliers de la
ville, fauxbourgs & banlieue de Paris , cabaretiers
& autres qui entreprennent des voitures , de s’ingérer
, jufqu’à l’entier rembourfoment de ladite fomme
de 100,000 liv. de faire le courtage des rouliers, ni
recevoir chez eux aucuns balots defdits rouliers ,
pour faire leur voiture , fous les peines portées par
1 édit , fans permiffion par écrit des quatre acquéreurs
, & en payant à leur acquit & décharge , par
forme de prêt ou autrement , les fommes dont ils
conviendront.
Ce monopole eft aboli, mais il relie dés com-
tnijjionnaires autorifë«, avec lefquels le font mis
en concurrence les fermiers des nouvelles melïà-
gerîes.
Commissionnaires , oufaéteurs Anglois établis
dans le Levant. Il n’y a peut-être point dans tous les
endroits de la terre , ou il s’exerce quelque commerce
, de compagnie de commiffionnairts , plus
riche, plus qualifiée , ni plus coiifidérable , que
celle des Anglois de la ville de Smyrne. Elle eft
ordinairement compolee de quatre-vingt ou de ceiij
perfôn‘ûe3 , prefque tous jeunes gentilshommes ,
fouvent fils de'milords, ou fortis des meilleures mai-
fons d’Angleterre.
Comme il n’y a point de dérogeance en Angleterre
pour ceux d’entre la nobiefte qui exercent le
commerce , & qu’il n’y/a point aufti de négoce plus
lucratif pour les Anglois , que celui du Levant,
■la plupart des cadets des familles nobles prennent
ce parti, pour rétablir leurs affaires, ou pour pouffer
leur fortune.
Dans la néceflïté de pafter par l’apprentifiage,
qui eft de fept ans en Angleterre , ils s’engagent
pour ce temps-là à quelque gros marchand de la
compagnie du Levant, qui -, moyennant 3 ou 400
liv. fterling qu’ils en reçoivent, conviennent de les
envoyer à Smyrne après les trois premières années
de leur apprenriftage ; ou non-feulement ils leurs
confient leurs affaires avec de gros appointemens ,
mais encore leur permettent de trafiquer pour leur
propre compte j ce qui leur donne le moyen de
vivre fplendidement , tant qu’ils relient dans L
compagnie des commi(Jionnaires, & les met en
é ta t, quand ils en fortenc, de retourner en Angleterre
exercer des emplois dignes du fang dont ils
font fortis.
C eft le conful de la nation Angloife , établi à
Smyrne, qui juge en première inftance des différends
qui furviennent entre les commifjionnairts pour le
fait du commerce; mais il y a appel de fon jugement
pardevant l’ambafladeur réfident à Conftantinople ;
qui les décide en dernier refïbrt.
Les commi (jionnaires font appellés coagis dans
toutes les échelles du Levant.
COMMUN. Ce qui appartient à plufieurs , où
plufieurs ont un égal intérêt.
On appelle bourft commuât le produit des droits
-dus à certains officiers pour leur falaire ,. qu’ils font
obligés de rapporter à la caifie de la compagnie
pour être enfuite partagé entr’eux. Les vendeurs de
vin, de' marée , de volaille , & autres officiers de
commerce , ont une bouffe commune, où fe rap-
portent-touslés droits, falàires & émolumens. Voycj
leurs articles.
i On appelle auffi bourft commuât parmi les fix
1 corps des marchands de la ville de Paris, & les maîtres
des communautés des arts & métiers , une partie
de ce qui provient des droits de réception à l’ap-
prentiffage & à la maîtrife , dont on compofe un
fonds, pour être employé aux affaires ou befoin
des corps & communautés. Voyeç bourse com-
M Ü N E . COMMUNAUTÉ DE BIENS. Ce terme de
coutume fe dit particulièrement des biens qu’un
mari & une femme mettent eu commun, pour jouir
des profits, ou porter les pertes qui peuvent arriver
à l’occafîon de cette portion qui leur appartient
à chacun , qu’ils mettent en communauté ; ce
qui s’entend également , du de la comnïunauté
établie par les coutumes1, ou de celle qui eft ftipulée
.par les contrats de mariage.
La communauté de biens entre les négocians &
leurs Femmes , étant d’une très-grande confequence l
dans le commerce , à caufe des engagemens que j
peuvent prendre les marchands, dont les femmes .
font non communes , qui féroient très-préjudicia- j
blés à leurs créanciers , fi ce défaut de c o m m u n a u té j
n’étojt pas rendu public ; l’ordonnance du mois de j
.mars 1673 y a pourvu par l’article premier du titre
h u it, qui porte :
», Que dans les lieux où la commumautê dt bitns j
» d’entre mari & femme eft établie par la coutume , f
v ou par l’ufage, la claufe qui y dérogera par les con-
» trats de mariage des marchands groffiers , ou de-
» tailleurs , & des banquiers , fera publiée à l’en-
» droit de la jurifdiélion confulaire , s’il y en a ,
» (mon !dans Faffemblée de l’hôtel commun des
» villes, & inférée dans un tableau expofé en lieu
» public1, à peine de nullité, & la claufe, n’aura
» lieu que du jour qufolle aura été publiée & enfe-
» giftrée ».
Il faut remarquer , que lorfqu’il eft dit que l’ar-
tjiel-e des contrats dé mariage ,. portant dérogation
aux coutumes qui établiftent la communauté dt
bitns , fera inferit dans un tableau expofé en lieu
public , l’ordonnance, n’entend pas qu’on mette le
tableau ou dans les places%ù fe tiennent les foires
& marchés, oit même fur la place de la bourfe &
d.u change , mais dans les jurifdiûions confulaires ,
ou dans l’hôtel commun des villes.
Une fécondé remarque eft que non - feulement
les fép a ratio 11s de biens entre les négocians & leurs
femmes font comprifes- tacitement dans les claufes
dérogatives aux communautés d t b itnsétablies par
les coutumes , ou par l’ufage ; mais qu’il y a même
un article exprès , qui eft le 2 du même titre- 8 dé
l ’ordonnancé. Voyeç séparation de biens.
On peut voir le chapitre I I du livre I V de la
fécondé partie: du Parfait Négociant , où M.
Savary traite des féparations de bitns qui f e fo n t
entre les négocians & leurs fem m e s, & des fo r malités
q u'il fa u t obferver pour les rendre bonnes
& valables.
Communauté. Société , corps de plufieurs per-
fonnes unies enfemble pour vivre fous de qertaine:
régies communes, dont elles font convenues , ou
qui leur font impofées par leurs fupérieurs.
Les Romains , qui femblent avoir donné aux peuples
qui ont partagé leur empire , l’exemple des
communautés, & qui fans doute eux - mêmes l’a-
voient reçu de quelques-uns de leurs voifins, les
appelloient des collèges , & ce terme avoit à peu
près les mêmes'’ lignifications qu’on donne préfente-
ment.au mot de communauté’.
Ou voit en effet, parmi les foeiétés qu’il y avoit
à Rome, des collèges de prêtres , des colleges d’augures
, & plufieurs autres fembhfoles ; & pour fe
fixer feulement à ce qui a rapport au commerce,
dont il s’agit uniquement dans ce dictionnaire, on
remarque daris les auteurs , des collèges des négocians
, ceux des ferruriers , ceux des bateliers , ou
voituriers par eau , ceux des fondeurs, dont même
il y en avoit julqu’à trois clafles ; ceux des argentiers
ou banquiers , & plufieurs autres qui reflembleu:
allez aux corps & communautés des marchands , &
des arts & métiers de Paris.
L’on croit communément que Numa , ce grand
légiflateur des Romains , & ce grand ordonnateur de
la police de leur ville nailïànte , a été l’inllitiiteur
des collèges des arts & métiers, comme on les appelle
prefentçment.
Ces communautés d’artifans , fi faciles à s’unir
contre l’autorité du fénat, étant devenues dans la
fuite fulpeCtes. à la république, elles furent fup-
primées fous le confulat de L. Cæcilius & de Q.
Martius 5 mais le fameux Claudius , fi célèbre par
les troubles de fon tribunat, & par les démêlés avec
Milon, qui enfin défit la ville de Rome d’un tribun li
turbulent, les fît rétablir , pour fe rendre le peuple
favorable, & avoir dans. ces foeiétés d’artifans un
feçours toujours prêt pour foutenir la fureur de fes
entreprifes.
Pour.ce qui eft des communautés de la ville de
Paris, l’on ne fait pas préeifément l’époque de leur
inftitution ; il eft certain feulement qu’elle eft fout
ancienne , non pas pour la forme de gouvernement
& de difeipline qu’elles ont préfenteinent, mais du
moins pour l’union des marchands de même pro-
feffion, & des ouvriers & artifans des mêmes arts &
métiers , fous des réglemens convenus entr’eux.
On veit un roi des merciers de la fécondé race ,
qui avoit jurifdiââon fur tous ceux qui fe mêloient
au commerce dans tout le royaume ; il ne parole
pas néanmoins que ces communautés ayent eu des
réglemens & ftatuts par autorité des magiftrats , ou
par lettres - patentes du ro i, avant le douzième
fiècle , encore moins de privilèges exclufifs.
A l’égard du nombre des communautés de Paris ,
on l’a vu croître de fîècle en fiècle ; mais c’eft principalement
fous le régne de Charles IX , que
plufieurs communautés nouvelles ont été érigées en
corps particuliers de jurande, par le génie fécond
des Maltotiers Italiens , qui défolèfent la France
fous la malheureufe admmiftration de Catherine de
Médicis.
La plus grande augmentation s’eft faite depuis
1673 , fous le régne de Louis X IV , & par Colbert ;
I à peine y avoit-il alors 60 communautés à Paris ;
| l’édit du mois de mars de la même année les fît
monter à 83 , & le rôle du confeil de 1691 les mit
à 12«? , pour en tirer quelques petites taxations ; les
loix de l’apprentifîage , du compagnonage & des
chefs-d’oeuvres , des réceptions , des jurandes, &c.
formant une bigarure très-étrange, faifoient naître
mille & mille procès. On les avoit toutes fupprimées
avec l’attirail qu’elles entraînoient. Ou les a rétablies
, mais fous une forme plus fîmple & fujette à
moins d’inconvéniens. Voyeç jurande.
COMPAGNIE. Se dit de plufieurs perionnes af-
femblées en un même lieu , ou unies dans un même
deffein.
Compagnie, en fait de négoce. C’eft une affomBÈ
if