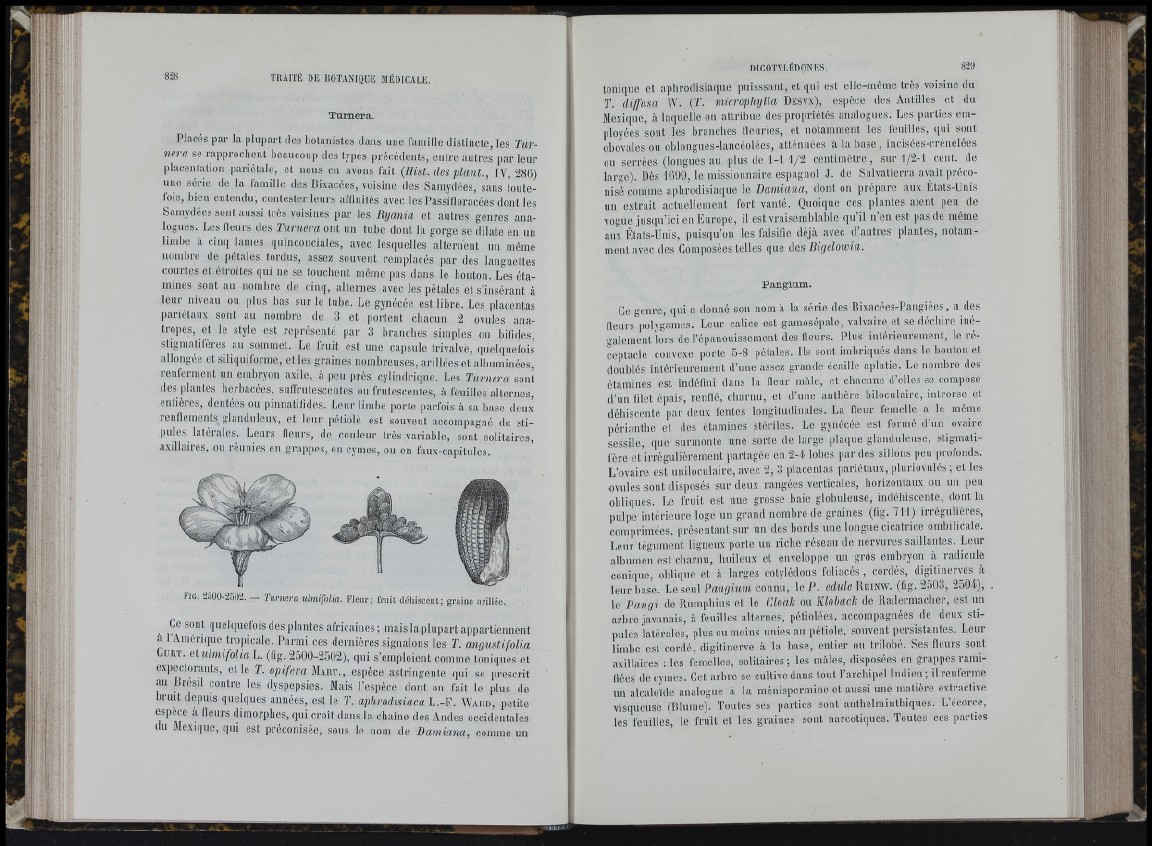
Turnera.
r iac cs par la plupart des botanistes dans une famille distincte, les T u r nera
se rapprocbent beaucoup des types précédents, entre autres par leur
placentation pariétale, et nous en avons fait (Hist. des p la n t . , lY , 280)
une série de la lamille des Bixacées, voisine des Samydées, sans tonte-
fois, bien entendu, contester leurs affinités avec les Passifloracces dont les
Samydées sont aussi très voisines pa r les Ryania et autres genres analogues.
Les llenrs des Turnera ont un tube dont la gorge se dilate en un
limbe à cinq lames qiiinconciales, avec lesquelles alternent un même
nombre de pétales tordus, assez souvent remplacés par des langncttes
courtes et étroites qui ne se toncbent même pas dans le bouton. Les étamines
sont au nombre de cinq, alternes avec les pétales et s’insérant à
leur niveau ou plus bas sur le tnbc. Le gynécée est libre. Les placentas
pariétaux sont au nombre de 3 et portent cbacun 2 ovules ana-
tiopes, et le style est représenté par 3 b ran d ie s simples ou bifides,
stigmalifères au sommet. Le fruit est une capsule trivalve, quelquefois
allongée et siliquiforme, et les graines nombreuses, arillées et albuminées,
renferment un embryon axile, à peu près' cylindrique. Les Turne ra sont
des plantes berbacées, siiiiriitescentes ou frutescentes, à feuilles alternes,
entières, dentées ou pinnatifides. Leur limbe porte parfois à sa base deux
reiitlemcnts glanduleux, et leur pétiole est souvent accompagné de stipules
latérales. Leurs fleurs, de couleur très variable, sont solitaires,
axillaires, ou réunies en grappes, en cymes, ou en faux-capitnles.
1 IG. -,500-2i)02. lu rn era , ubnifolict. Fleur; fruil déhiscent; graine arillée.
Ce sont quelquefois des plantes africaines ; mais la plupart appartiennent
a l ’Amerique tropicale. Parmi ces dernières signalons les T. angus t i fol ia
CuRT. d ulmi fol ia L . (fig. 2500-2502), qui s ’emploient comme toniques et
expectorants, et le T. opifera Ma r t . , espèce astringenle qui se prescrit
au Brésil contre les dyspepsies. Mais l ’espèce dont on fait le plus de
bruB depuis quelques années, est le T. aphrodisiaca L.-F . W a r d , petite
espèce à fleurs dimorpbes, qui croît dans la chaîne des Andes occidentales
du Mexique, qui est préconisée, sous le nom de ü am i a n a , comme un
tonique et aphrodisiaque puisssant, et qui est elle-même très voisine du
T. diffusa W . {T. microphylla D e s v x ) , espèce des Anlilles et du
Mexique, cà laquelle on attribue des propriétés cTmalogues. Les parties employées
sont les branches fleuries, et notamment les feuilles, (pii sont
obovales ou oblongues-lancéolées, alténuées à la b ase, incisées-crénelées
ou serrées (longues au plus de 1-4 1 /2 c entimè tre, sur 1/2-1 cent, de
large). Dès 1099, le missionnaire espagnol J. de Salvatierra avait préconisé
comme aphrodisiaque le Damiana, dont on prépare aux États-Unis
un extrait actuellement fort vanté. Quoique ces plantes aient peu de
vogue jusqu’ici en Europe, il est vraisemblable qu il n en est pas de même
aux États-Unis, puisqu’on les falsifie déjà avec d’autres plantes, notamment
avec des Composées telles que des Bigclowia.
P a n g i u m .
Ce genre, qui a donné son nom à la série des BixcTcées-Pangiées, a des
fleurs polygames. Leur calice est gamosépale, VcalvcTire et se déchire iné-
gcTlement lors de l’épanouissement des fleurs. Plus intérieurement, le r é ceptacle
convexe porte 5-8 pétales. Ils sont imbriqués dcuns le bouton et
doublés intérieurement d’une assez grande écaille aplatie. Le nombre des
étamines est indéfini dans la fleur mâle, et chacune d’elles se compose
d’nn filet épais, renflé, chcTrnu, et d’une anthère biloculaire, introrse et
déhiscente par deux fentes longitudinales. La fleur femelle a le môme
périanthe et des étamines stériles. Le gynécée est formé d’iin ovaire
sessile, que surmonte une sorte de large plaque glanduleuse, siigmati-
fère et irrégulièrement partagée en 2-4 lobes par des sillons peu profonds.
L’ovaire est uniloculaire, avec 2, 3 placentas pariétaux, pluriovulés; et les
ovules sont disposés sur deux rangées verticales, horizontaux ou un peu
obliques. Le fruit est une grosse baie globuleuse, indéhiscente, dont la
pulpe intérieure loge un grand nombre de graines (fig. 711) irrégulières,
comprimées, présentant sur un des bords une longue cicatrice ombilicale.
Leur tégument ligneux porte un ricbe réseau de nervures saillantes. Leur
albumen est cbarnu, huileux et enveloppe un grés embryon a radicale
conique, oblique et à larges cotylédons foliacés , cordés, digitinerves â
leur base. Le sm \ Pa n g ium connu, le P . edule R e in w . (fig. 2503, 2504),
le Pa n g i de Rumpliius et le Cloak ou Kloback de Radermacber, est un
arbre javanais, à feuilles alternes, pétiolées, accompagnées de deux stipules
latérales, plus ou moins unies au pétiole, souvent persistantes. Leur
limbe est cordé, digitinerve â la base, entier ou trilobé. Ses fleurs sont
axillaires ; les femelles, solitaires; les mâles, disposées en grappes ramifiées
de cymes. Cet arbre se cultive dans tout l’archipel In d ien ; il renferme
un alcalo'ide analogue â la ménispermine et aussi une matière extractive
visqueuse (Blnme). Toutes ses parties sont anthelmintliiques. L’écorce,
les feuilles, le fruit et les graines sont narcotiques. Toutes ces parties
i