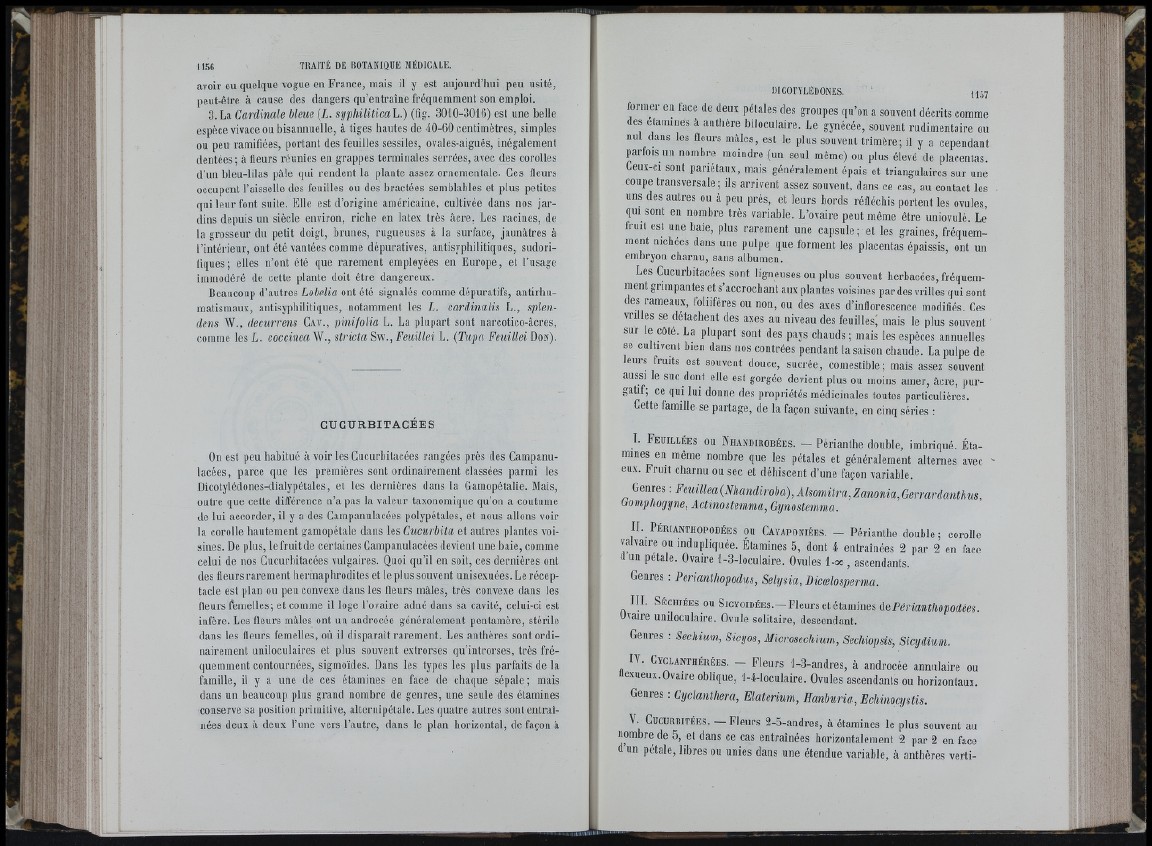
'liÀ
'
1156 TRAITÉ DE BOTANIQUE MÉDICALE.
avoir eu quelque vogue en France, mais il y est aujourd’hui peu usité,
peut-être à cause des dangers qu’entraîne fréquemment son emploi.
3. La Cardinale bleue {L. syphi l i l ica L.) (iîg. 3010-3010) est une belle
espèce vivace ou bisannuelle, à tiges hautes de 40-60 centimètres, simples
ou peu ramifiées, portant des feuilles sessiles, ovales-aiguës, inégalement
dentées; à fleurs réunies en grappes terminales serrées, avec des corolles
d’un bleu-lilas pâle qui rendent la plante assez ornementale. Ces fleurs
occupent l ’aisselle des feuilles ou des bractées semblables et plus petites
qui leur font suite. Elle est d’origine américaine, cultivée dans nos ja r dins
depuis un siècle environ, riche en latex très âcre. Les racines, de
la grosseur du petit doigt, brunes, rugueuses à la surface, jaunâtres à
l’intérieur, ont été vantées comme dépuratives, antisyphilitiques, sudori-
(iques ; elles n’ont été que rarement employées en Eu ro p e , et l’usage
immodéré de cette plante doit être dangereux.
Beaucoup d’autres Lobelia ont été signalés comme dépuratifs, antirhii-
matismaux, antisyphilitiques, notamment les L. cardinal is L., splen-
dens W. , decarrens C a v . , pini fol ia L . La plupart sont narcotico-âcres,
comme les L. coccinea W. , str ic ta Sw., Feuillei L. (Tupa Feuillei D o n ) .
GUGU R B IT AGE E S
On est peu habitué à voir les Cucurbitacées rangées près des Campanulacées,
parce que les premières sont ordinairement classées parmi les
Dicotylédones-dialypétales, et les derniè res dans la Gamopétalie. Mais,
outre que cette différence n’a pas la valeur taxonomiqiie qu’on a coutume
de lui accorder, il y a des Campanulacées polypétales, et nous allons voir
la corolle hautement gamopétale dans les Cucurbi ta et autre s plantes voisines.
De plus, le fruit de certaines Campanulacées devient une baie, comme
celui de nos Cucurbitacées vulgaires. Quoi qu’il en soit, ces dernières ont
des fleurs rarement bermaphrodites et le plus souvent unisexuées. Le réceptacle
est plan ou peu convexe dans les fleurs mâles, très convexe dans les
fleurs femelles; et comme il loge l ’ovaire adné dans sa cavité, celui-ci est
infère. Les fleurs mâles ont un androcée généralement pentamère, stérile
dans les fleurs femelles, où il disparaît rarement . Les anthères sont ordinairement
unilocnlaires et plus souvent extrorses qu’introrses, très fréquemment
contournées, sigmoïdes. Dans les types les plus parfaits de la
famille, il y a une de ces étamines en face de cbaque sépale ; mais
dans un beaucoup plus grand nombre de genres, une seule des étamines
conserve sa position primitive, alternipétale. Les quatre autres sont ent raînées
deux à deux l ’une vers l ’autre , dans le plan horizontal, de façon à
DICOTYLÉDONES. ' ’ 1 1 5 7
former en face de deux pétales des groupes qu’on a souvent décrits comme
des etammes à anthère biloculaire. Le gynécée, souvent rudimentai re ou
nul dans les fleurs mâles, est le plus souvent t r imère; il y a cependant
parfois un nombre moindre (un seul même) ou plus élevé de placentas.
Ceux-ci sont par iétaux, mais généralement épais et triangulaires sur une
coupe transversale; ils arr ivent assez souvent, dans ce cas, au contact les
uns des autres ou à peu près, et leurs bords réfléchis portent les ovules,
qui sont en nombre très variable. L ’ovaire peut même être uniovnlé. Le
fruit est une baie, plus rarement une capsule ; et les graines, fréquemment
nichées dans une pulpe que forment les placentas épaissis, ont un
embryon charnu, sans albumen.
Les Cucurbitacées sont ligneuses ou plus souvent herbacées, f réquemment
grimpantes et s’accrochant aux plantes voisines par des vrilles qui sont
des rameaux, Ibliifères ou non, ou des axes d’inflorescence modifiés. Ces
vrilles se détachent des axes au niveau des feuilles) mais le plus souvent
sur le côté. La plupart sont des pays chauds ; mais les espèces annuelles
se cultivent bien dans nos contrées pendant la saison chaude. La pulpe de
leurs fruits est souvent douce, sucrée, comestible; mais assez souvent
aussi le suc dont elle est gorgée devient plus ou moins amer , âcre, pur gatif;
ce qui lui donne des propriétés médicinales toutes particulières.
Cette iamille se partage, de la façon suivante, en cinq séries :
T. F e u i l l é e s ou N h a n d i r o b é e s . — Périanthe double, imbriqué. Étamines
en même nombre que les pétales et généralement alternes avec
eux. Frui t charnu ou sec et déhiscent d’une façon variable.
Genres : Feu i l lca{Nhandi roba) , A l somi t ra ,Z a n o n ia ,Ce r ra r d a n th u s ,
Comphogyne, A c t inos temma, Cynos temma.
II. P é r i a n t h o p o d é e s ou Ca y a p o n i é e s . — Périanthe double; corolle
valvaire ou indupliquée. Étamines 5, dont 4 entraînées 2 par 2 en face
un pétale. Ovaire 1-3-loculaire. Ovules l-oo, ascendants.
Genres : Pcrianthopodus, Selysia, Dicoelosperma.
I I I . S é c h i é e s ou S i c y o id é e s .— Fleurs et étamines d&Périanthopodées.
Uvaire uniloculaire. Ovule solitaire, descendant.
Genres : Sechium, Sicyos, Microsechium, Sechiopsis, Sic ydium.
IV. Gy c l a n t h é r é e s . - Fleurs 1-3-andres, à androcée annulaire ou
lexueux. Ovaire oblique, 1-4-loculaire. Ovules ascendants ou horizontaux.
Genres : Cyclanthera, Flate r ium, Hanbur ia, Fchinocyst is.
V. Gu c ü r b i t é e s . Fleurs 2-5-andres, à étamines le plus souvent au
nombre de 5, et dans ce cas entraînées horizontalement 2 par 2 en face
d’un pétale, libres ou unies dans une étendue variable, à anthères verti-
I
È L-' .Di .' ''■