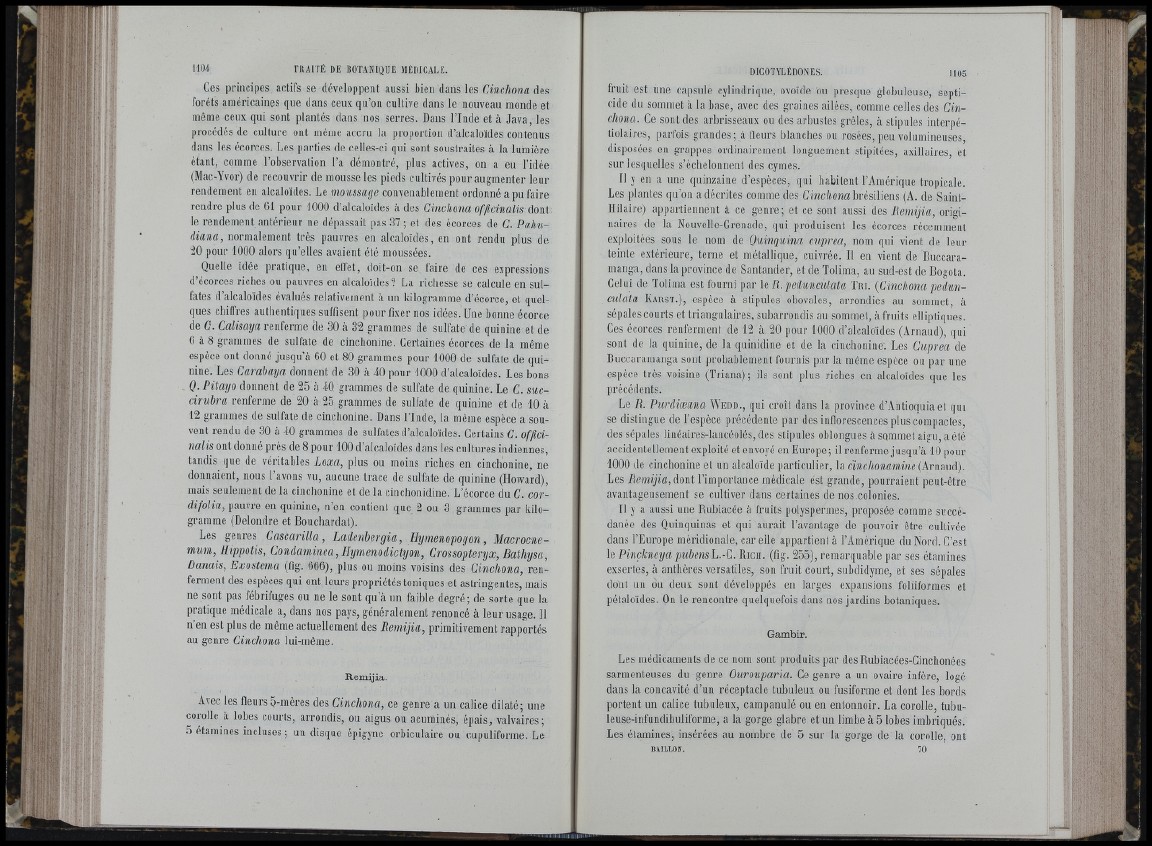
Ces principes actifs se développent aussi bien dans les Cinchona des
forêts américaines que dans ceux qu’on cultive dans le nouveau monde et
même ceux qui sont plantés dans nos serres. Dans l ’Inde et à Java, les
procédés de culture ont même accru la proportion d’alcaloïdes contenus
dans les écorces. Les parties de celles-ci qui sont soustraites à la lumière
étant, comme l’observation l’a démontré, plus actives, on a eu l ’idée
(Mac-Yvor) de recouvrir de mousse les pieds cultivés pour augmente r leur
rendement en alcaloïdes. Le moussage convenablement ordonné a pu faire
rendre plus de G1 pour 1000 d’alcaloïdes à des Cinchona officinalis dont
le rendement antérieur ne dépassait pas 37 ; et des écorces de C. P a h u diana,
normalement très pauvres en alcaloïdes, en ont rendu plus de
20 pour 1000 alors qu’elles avaient été moussées.
Quelle idée pratique, en effet, doit-on se faire de ces expressions
d’écorces ricbes ou pauvres en alcaloïdes? La richesse se calcule en sulfates
d’alcaloïdes évalués relativement à un kilogramme d’écorce, et quelques
chiffres authentiques suffisent pour fi.xer nos idées. Lue bonne écorce
de 0 . Calisaya renferme de 30 cà 32 grammes de sulfate de quinine et de
6 à 8 grammes de sulfate de cinchonine. Certaines écorces de la même
espèce ont donné jusqu’à GO et 80 grammes pour 1000 de sulfate de quinine.
Les Carabaya donnent de 30 à 40 pour 1000 d’îilcaloïdes. Les bons
Q. Pi tayó donnent de 25 à 40 grammes de sulfate de quinine. Le C. succi
rubra renferme de 20 à 25 grammes de sulfate de quinine et de 10 à
12 grammes de sulfate de cinchonine. Dans l ’Inde, la même espèce a souvent
rendu de 30 à 40 grammes de sulfates d’îilcaloïdes. Certains C. officinal
is ont donné près de 8 pour 100 d’alcaloïdes dans les cultures indiennes,
tandis que de véritables L o xa , plus ou moins ricbes en cinchonine, ne
donnaient, nous l ’cavons vu, aucune trace de sulfate de quinine (Howard),
mais seulement de la cinchonine et de la cinchonidine. L’écorce du C. cor difolia,
pauvre en quinine, n’en contient que 2 ou 3 grammes par kilogramme
(Delondre et Boucbardat).
Les genres Cas car i l la, Ladenbc rgia, Hymenopogon, Mac rocne -
mum, Hippoti s, Co n d amin e a , Hymenodictyon, Crossopteryx, Bathysa,
Danais, Exos tema (fîg. G66), plus ou moins voisins des Cinchona, renferment
des espèces qui ont leurs propriétés toniques et astringentes, mais
ne sont pas fébrifuges ou ne le sont qu’à un faible degré; de sorte que la
pratique médicale a, dans nos pays, généralement renoncé à leur usage. Il
n’en est plus de même actuellement des Remi j ia, primit ivement rappor tés
au genre Cinchona lui-même.
Remijia.
Avec les fleurs 5-mères des Cinchona, ce genre a un calice dilaté; une
corolle à lobes courts, arrondis , ou aigus ou acuminés, épais, valvaires;
5 étamines inclu ses; un disque épigyne orbiculaire ou cupuliforme. Le
fruit est une capsule cylindrique, ovoïde ou presque globuleuse, septicide
du sommet à la base, avec des graines ailées, comme celles des Cinchona.
Ce sont des arbrisseaux ou des arbustes grêles, à stipules interpétiolaires,
parfois grandes; à fleurs blancbes ou rosées, peu volumineuses,
disposées en grappes ordinairement longuement stipitées, axillaires, et
sur lesquelles s’échelonnent des cymes.
Il y en a une quinzaine d’espèces, qui babilent l’Amérique tropicale.
Les plantes qu’on a décrites comme des Cwc/mwa brésiliens (A. de Saint-
Hilaire) appar tiennent à ce genre ; et ce sont aussi des Remi j ia, originaires
de la Nouvelle-Grenade, qui produisent les écorces récemment
exploitées sous le nom de Quinquina cuprea, nom qui vient de leur
teinte e.xtérieure, terne et métallique, cuivrée. Il en vient de Buccara-
manga, dans la province de Santander, et de Tolima, an sud-est de Bogota.
Celui de Tolima est fourni par \e R. pedunculata T r i . (Cinchona p ed u n culata
Ka r s t . ) , espèce à stipules obovales, arrondies au sommet, à
sépales courts et triangulaires, subarrondis au sommet, à fruits elliptiques.
Ces écorces renferment de 12 à 20 pour 1000 d’alcaloïdes (Arnaud), qui
sont de la quinine, de la quinidine et de la cincbonine. Les Cuprea de
Buccaramanga sont probablement fournis par la même espèce ou par une
espèce très voisine (Triana); ils sont plus riches en alcaloïdes que les
précédents.
Le R. Pu rd ioea n a W e d d . , qui croîl dans la province d’Antioquia et q m
se distingue de l’espèce précédente par des inflorescences plus compactes,
des sépales linéaires-lancéolés, des stipules oblongues à sqmmet aigu, a été
accidentellement exploité et envoyé en Europe; il renferme jusqu’à 10 pour
1000 de cincbonine et un alcaloïde particulier, la cinchonamine (Arnaud).
Les Remi j ia, dont l ’importance médicale est grande, pourraient peut-être
avantageusement se cultiver dans certaines de nos,colonies.
11 y a aussi une Rubiacée à fruits polyspermes, proposée comme succédanée
des Quinquinas et qui aurait l’avantage de pouvoir être cultivée
dans l’Europe méridionale, car elle appartient à l’Amérique du Nord. C’est
le Pinç kn e ya pubensL.-C. Ricii. (fig. 255), remarquable par ses étamines
e.xsertes, à antbères versatiles, son fruit court, subdidyme, et ses sépales
dont un ou deux sont développés en larges expansions foliiformes et
pétaloïdes. On le rencontre quelquefois dans nos jardins botaniques.
Gambir.
Les médicaments de ce nom sont produits par des Rubiacées-Ginchonées
sarmenteuses du genre Ouroupar ia. Ge genre a un ovaire infère, logé
dans la concavité d’un réceptacle tubuleux ou fusiforme et dont les bords
portent un calice tubuleux, campanulé ou en entonnoir. La corolle, tubu-
leuse-infandibuliforrne, a la gorge glabre et un limbe à 5 lobes imbriqués.
Les étamines, insérées au nombre de 5 sur la gorge de la corolle, ont
BAILLON. 70
‘M'
U.
a
L '
k il
SI ■
i: i :
SI ■Jt. I
i ,
i ■ f '
r i
I*