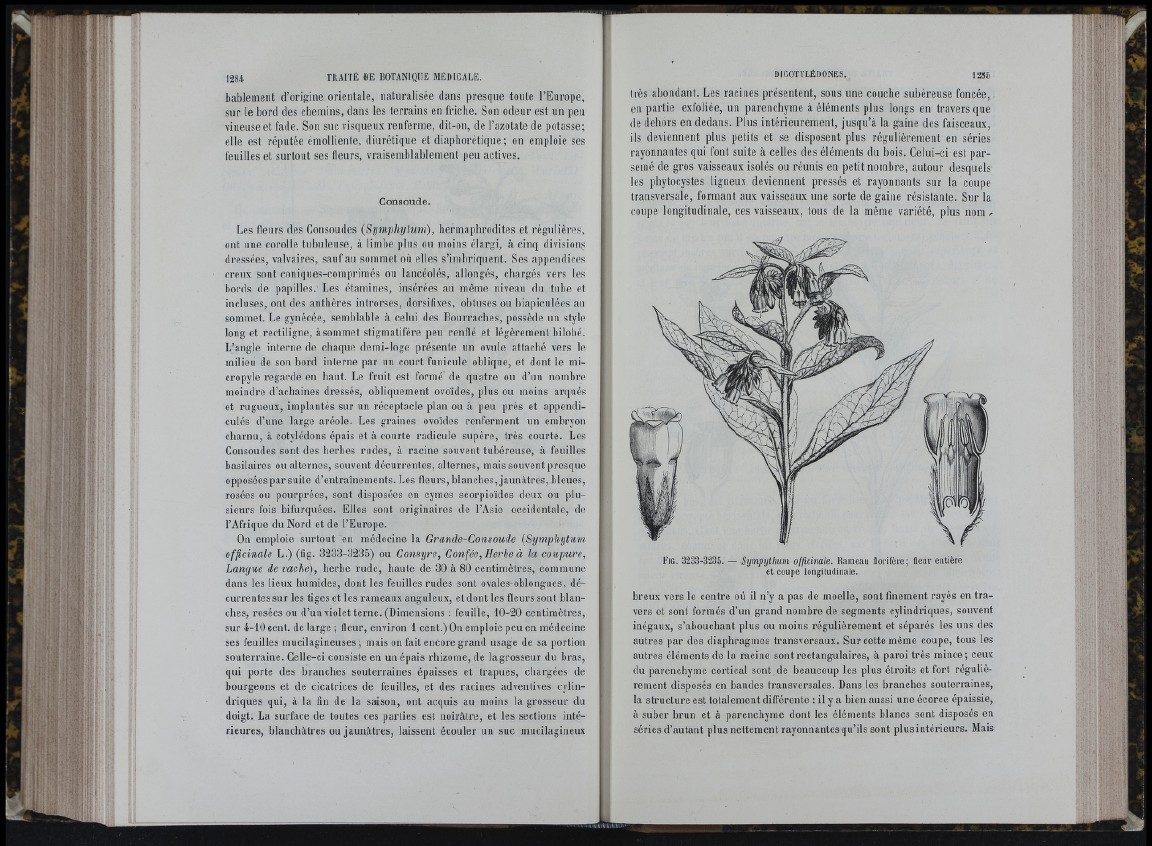
bablement d’origine orientale, naturalisée dans presque toute l ’Europe,
sur le bord des cbemins, dans les terrains en fricbe. Son odeur est un peu
vineuse et fade. Son suc visqueux renferme, dit-on, de l ’azotate de potasse;
elle est réputée émolliente, diurétique et diapborétique; on emploie ses
feuilles et surtout ses fleurs, vraisemblablement peu actives.
Gonsoude.
Les fleurs des Gonsoudes (S ymp h y tum) , bermapbrodites et régulières,
ont une corolle tubuleuse, à limbe plus ou moins élargi, à cinq division?
dressées, valvaires, sauf au sommet où elles s’imbriquent. Ses appendices
creux sont coniques-comprimés ou lancéolés, allongés, cbargés vers les
bords de papilles. Les étamines, insérées au même niveau du tube et
incluses, ont des antbères introrses, dorsifixes, obtuses ou biapiculées au
sommet. Le gynécée, semblable à celui des Bourraches, possède un style
long et rectiligne, àsommet stigmatifère peu renflé et légèrement bilobé.
L’angle interne de chaque demi-loge présente un ovule attaché vers le
milieu de son bord interne par un court funicule oblique, et dont le micropyle
regarde en haut. Le fruit est formé de quatre ou d’un nombre
moindre d’achaines dressés, obliquement ovoïdes, plus ou moins arqués
et rugueux, implantés sur un réceptacle plan ou à peu près et appendiculés
d ’une large aréole. Les graines ovoïdes renferment un embryon
charnu, à cotylédons épais et à courte radicule supère, très courte. Les
Gonsoudes sont des herbes rudes, à racine souvent tubéreuse, à feuilles
basilaires ou alternes, souvent décurrentes, alternes, mais souvent presque
opposées par suite d ’entraînements. Les fleurs, blanches, jaunâtres , bleues,
rosées ou pourprées, sont disposées en cymes scorpioïdes deux ou plusieurs
fois bifurquées. Elles sont originaires de l ’Asie occidentale, de
l ’Afrique du Nord et de l ’Europe.
On emploie surtout en médecine la Grande-Consoude (S ymp h y tum
officinale L.) (fig. 3233-3235) ou Consyre, Confiée, Herbe à la coupure.
Langue de vache), herbe rude, haute de 30 à 80 centimètres, commune
dans les lieux bumides, dont les feuilles rudes sont ovales-oblongues, décurrentes
su r les tiges et les rameaux anguleux, el dont les fleurs sont blanches,
rosées ou d ’un violet terne. (Dimensions : feuille, 10-20 centimètres,
sur 4-10 eent. de large ; fleur, environ 1 cent.) On emploie peu en médecine
ses feuilles mucilagineuses ; mais on fait encore grand usage de sa portion
souterraine. Gelle-ci consiste en un épais rhizome, de la grosseur du bras,
qui porte des branches souterraines épaisses et trapues, cbargées de
bourgeons et de cicatrices de feuilles, et des racines adventives cylindriques
qui, à la fin de la saison, ont acquis au moins la grosseur du
doigt. La surface de toutes ces parties est noirâtre, et les sections intérieure
s, blanchâtres ou jau n â tre s , laissent écouler un suc rnucilagineux
très abondant. Les racines présentent, sous une couche subéreuse foncée,
en partie exfoliée, un parencbyme à éléments plus longs en travers que
de dehors en dedans. Plus intérieurement, ju sq u ’à la gaine des faisceaux,
ils deviennent plus petits et se disposent plus régulièrement en séries
rayonnantes qui font suite à celles des éléments du bois. Gelui-ci est pa r semé
de gros vaisseaux isolés ou réunis en petit nombre, autour desquels
les phytocystes ligneux deviennent pressés et rayonnants sur la coupe
transversale, formant aux vaisseaux une sorte de gaine résistante. Sur la
coupe longitudinale, ces vaisseaux, tons de la même variété, plus nom ^
Eig. 3233-3235. — S ym p y tliu m o fficin a le. Rameau florifère; fleur entière
et coupe longitudinale.
breux vers le centre où il n ’y a pas de moelle, sont finement rayés en tra vers
et sont formés d ’un grand nombre de segments cylindriques, souvent
inégaux, s ’abouchant plus ou moins régulièrement et séparés les uns des
autres par des diaphragmes transversaux. Su r cette même coupe, tous les
autres éléments de la racine sont rectangulaires, à paroi très mince ; ceux
du parenchyme cortical sont de beaucoup les plus étroits et fort régulièrement
disposés en bandes transversales. Dans les branches souterraines,
la s tructure est totalement différente : il y a bien aussi une écorce épaissie,
à suber bru n et à parenchyme dont les éléments blancs sont disposés en
séries d’autant plus nettement rayonnantesqu’ils sont plus intérieurs . Mais