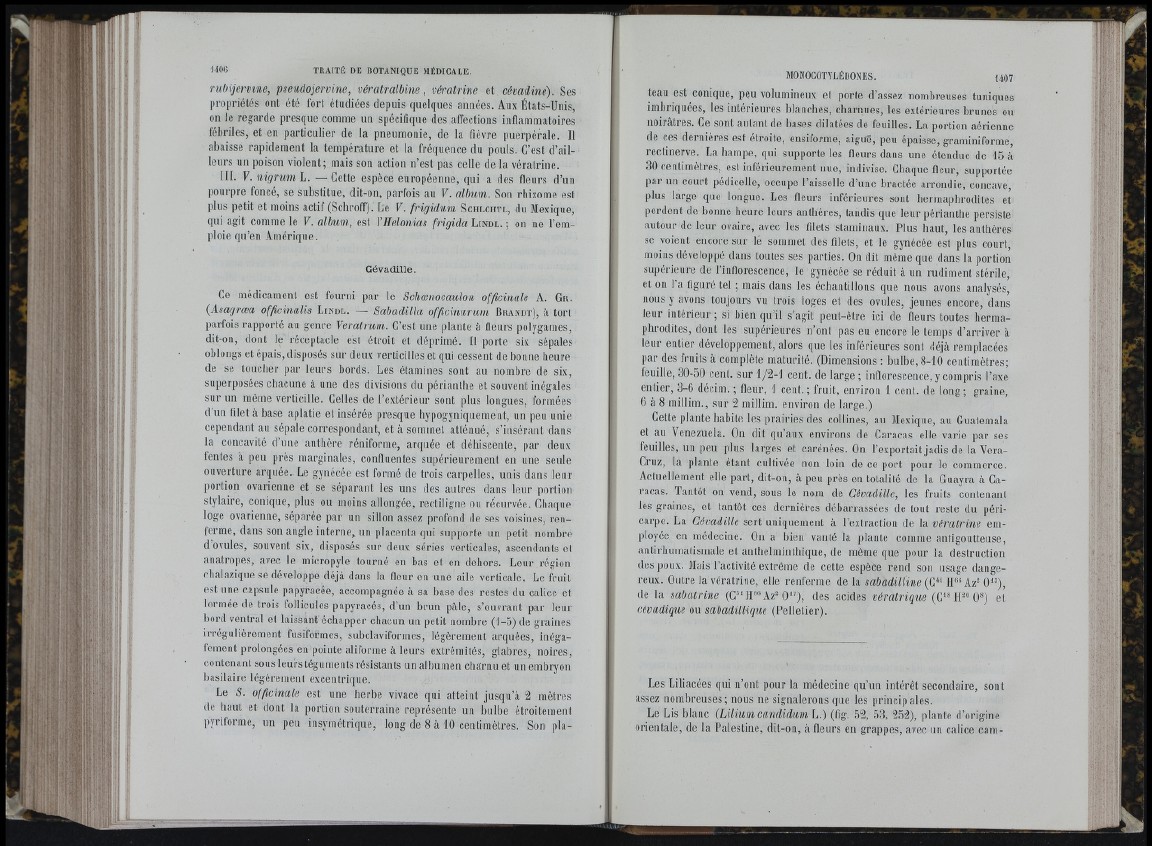
„1"® ij
l®i !!
' , )
! iis
! k
I
; , : ij
1 "
I I .( ' h
I • L ,1
I i:
t '
i ' 't (■
i ? ? ■ i. ' ; '
j l , . 1. . /I l
frOO TRAITÉ DE BOTANIQUE MÉDICALE.
rubi jervine, pseudojervine, v é ra t ra lb in e , vèratr ine et cévadine). Ses
propriétés ont été fort étudiées depuis quelques années. Aux États-Unis,
on le regarde presque comme un spécifique des affections inflammatoires
tébriles, et en particulier de la pneumonie, de la fièvre puerpérale. Il
abaisse rapidement la température et la fréquence du pouls. C’est d’ailleurs
nn poison violent; mais son action n’est pas celle d e l à vèratrine.
III. V. n ig r um L. — Cette espèce européenne, qui a des fleurs d’un
pourpre foncé, se substitue, dit-on, parfois au V. album. Son rbizome est
plus petit et moins actif (SclirofT). Le V. f r ig id um S c h l c h t l , du Mexique,
qni agit comme le V. album, est VHelonias frigida L i n d l . ; on ne l’emploie
qu’en Amérique.
Gévadille.
Ce médicament est fourni par le Schoenocaulon, officinale A. Gr.
(Asagroea officinalis L i n d l . — Sabadi l la of f icinarum B r a n d t ) , à tort
parfois rapporté an genre Veratrum. C’est une plante cà fleurs polygames,
dit-on, dont le réceptacle est étroit et déprimé. Il porte six sépales
oblongs et épais, disposés sur denx verticilles et qui cessent de bonne benre
de se toucher par leurs bords. Les étamines sont au nombre de six,
superposées cbacune à une des divisions du périanthe et souvent inégales
sur nn môme verticille. Celles de l ’extérieur sont plus longues, formées
d’un filet à bcTse aplatie et insérée presque liypogyniquemeiit, un peu unie
cependant an sépale correspondant, et à sommet atténué, s’iiisèraiit dans
la concavité d’une antbère réniforme, arquée et débiscente, par deux
fentes à peu près marginales, confluentes supér ieurement en une seule
ouverture arquée. Le gynccèo est formé de trois carpelles, unis dans leur
portion ovarienne et se séparant les uns des autres dans leur portion
stylaire, conique, plus ou moins allongée, recliligne ou récnrvée. Cbaque
loge ovarienne, séparée par un sillon assez profond de ses voisines, renferme,
dans son angle interne, un placenta qui supporte un petit nombre
d ovules, souvent six, disposés sur deux séries verticales, ascendants el
anatropes, avec le micropyle tourné en bas et en dehors. Leur région
rbalazique se développe déjà dans la fleur en une aile verticale. Le fruit
est une capsule papyracée, accompagnée à sa base des restes dn calice et
lormée de trois follicules papyracés, d ’un brun pâle, s’ouvrant par leur
bord ventral et laissant échapper cbacun un petit nombre (1-5) de graines
irrégul ièrement fusiformes, snbclaviformes, légèrement arquées, inégalement
prolongées en pointe aliforme à leurs extrémités, glabres, noires,
contenant sous leurs téguments résistants un albumen charnu et un embryon
basilaire légèrement excentrique.
Le S. officinale est une herbe vivace qui atteint jusqu’à 2 mètres
de haut et dont la portion souterraine représente un bulbe étroitement
pyriforme, un peu insymétrique, long de 8 à 10 centimètres. Son pla-
MONOGOTYLÉDONES. 1407
teau est conique, peu volumineux et porte d’assez nombreuses tuniques
imbriquées, les intérieures blanches, charnues, les extérieures brunes on
noiiâtres. Ce sont autant de bases dilatées de feuilles. La portion aérienne
de ces dernières est étroite, ensiforme, aiguë, peu épaisse, graminiforme,
rectinerve. La hampe, qui supporte les fleurs dans une étendue de 15 à
30 centimètres, est inférieurement nue, indivise. Cbaque fleur, supportée
par un court pédicelle, occupe l ’aisselle d’une bractée arrondie, concave,
plus large que longue. Les fleurs inférieures sont hermaphrodites et
perdent de bonne heure leurs anthères, tandis que leur périanthe persiste
autour de leur ovaire, avec les filets staminaux. Plus baut, les anthères
se voient encore sur le sommet des filets, et le gynécée est plus court,
moins développé dans toutes ses parties. On dit même que dans la portion
supérieure de l ’inflorescence, le gynécée se réduit à un rudiment stérile,
et on l’a figure tel ; mais dans les échantillons que nous avons analysés,
nous y avons toujours vu trois loges et des ovules, jeunes encore, dans
leur intérieur ; si bien qu’il s’agit peut-ê tre ici de fleurs toutes hermaphrodites,
dont les supérieures n ’ont pas eu encore le temps d’arriver à
leur entier développement, alors que les inférieures sont déjà remplacées
par des fruits à complète maturi té. (Dimensions : b u lb e , 8-10 centimètres;
feuille, 30-50 cent, sur 1/2-1 cent, de large ; inflorescence, y compris l’axe
entier, 3-ü décim. ; fleur, 1 cent.; fruit, environ 1 cent, de long; graine,
f) à 8 millim., sur 2 millim. environ de large.)
Cette plante habile les prairies des collines, au Mexique, au Guatemala
et au Venezuela. On dit qu’aux environs de Caracas elle varie par ses
feuilles, un peu plus larges et carénées. On l’exportait jadis de la Vera-
Cruz, la plante étant cultivée non foin de ce port pour le commerce.
Actuellement elle part, dit-on, à peu près en totalité de la Guayra à Caracas.
Tantôt on vend, sous le nom de Cèvadille, les fruits contenant
les graines, et tantôt ces dernières débar rassées de tout reste du pér icarpe.
La Cèvadille sert uniquement à l ’extraction de la vèrat r ine employée
en médecine. On a bien vanté la plante comme antigouttense,
antirbumal ismal e et anthelminth ique, de même que pour la destruction
des poux. Mais l’activité extrême de cette espèce rend son usage dangereux.
Outre la vèratrine, elle renferme de la sabadill ine (C“ IF’'''Az^ 0 ‘Q,
de la sabatr ine (C“‘ ÎF''Az^ 0 ‘Q, des acides v érat r ique (C^® IL^o 0 ^ et
cévadique ou sabadilUque (Pelletier).
Les Liliacées qui n ’ont pour la médecine qu’un intérêt secondaire, sont
assez nombreuses; nous ne signalerons que les principales.
Le Lis blanc (Li l ium candidam L.) (fig. 52, 53, 252), plante d’origine
orientale, de la Palestine, dit-on, à fleurs en grappes, avec un calice cam