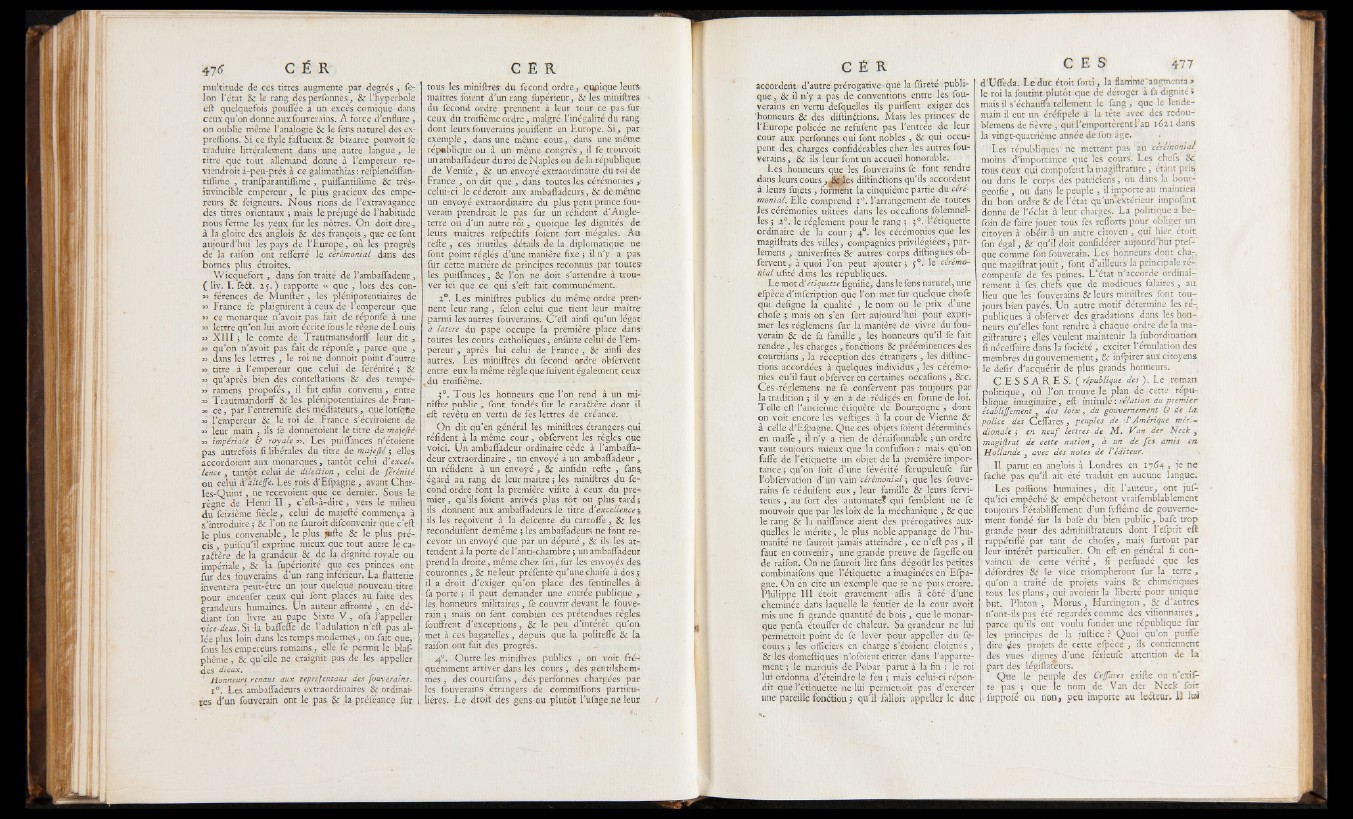
multitude de ces titres augmente par degrés , félon
Tétât & le rang des perfonnes, & l'hyperbole
eft quelquefois pouflee a un excès comique dans
ceux qu’on donne aux fouverains. A force d’ enflure ,
on oublie même l’analogie 8c le fens naturel des ex-
preflions. Si ce ftyle faftueux 8c bizarre pouvoit fe
traduire littéralement dans une autre langue , le
titre que' tout allemand donne à l’empereur reviendrait
à-peu-près à ce galimathias : refplendiflan-
tiflime 3 tranfparanrifiime 3 puiflfantiflime 8c très-
invincible empereur 3 le plus gracieux des empereurs
8c feigneurs. Nous rions de l’extravagance
des titres orientaux > mais le préjugé de l’habitude
nous ferme les yeux fur les nôtres. On doit dire-,
à la gloire des anglois. 8c des françois, que ce font
aujourd’hui les pays de l’Europe, où les progrès
de la raifon ont refferré le cérémonial dans des
bornes plus étroites.
Wicquefort , dans fon traité de l’ambaffadeur,
( liv. I. fe&. 25.) rapporte « que , lors des conas
férences de Munlter , les plénipotentiaires de
» France fe plaignirent à ceux de l’empereur que
» ce monarque n’ avoit pas fait de réponfe à une
3» lettre qu’on lui. avoit écrite fousle règne de Louis
»5 X I I I .} le comte de Trautmansdorff leur dit .,
.»s qu’on n’avoit pas fait de réponfe , parce que ,
55 dans les lettres , le roi ne donnoit point d’autre
55 titre à l’empereur que celui de lerénité j 8c
35 qu’après bien des conteftations 8c des tempé-
»3 ramens propofés, il fut enfin convenu, entre
» Trautmapdorff & les plénipotentiaires de Fran-
» c e , par l’entremife des médiateursque torique
50 l’empereur & le roi de ,France s'écriraient de
33 leur main , ils fe donneraient le titre de majefté
33 impériale b royale ?■ >.> Les puiffances h’ étoient
pas autrefois fi libérales du titre de majefté ; elles
accordoient aux monarques, tantôt celui d’ excellence
, tantôt celui de dileÛion , celui de férénité
ou celui iïaltejfe. Les rois d’Efpagne, avant Char-
les-Quint, ne recevoient que ce dernier. Sous le
jègne de Henri II , c’eft-à-dire, vers le milieu
<lu feizième fiècle, celui de majefté commença à
s’introduire 3 & Ton ne fauroit disconvenir que c’eft
le plus convenable, le plus jtofte 8c le plus précis
, puifqu’ il exprime mieux que tout autre le caractère
d elà grandeur 8ç de :la; dignité royale ou
impériale, & la. fupériorité que ces princes ont
fur des fouverains d’un rang inférieur. La flatterie
inventera peut-être un jour quelque ^nouveau titre ,
pour encenfer ceux qui font placés, au faîte des
grandeurs humaines. Un auteur effronté , en dé-'
diant fon livre au pape Sixte V , ofa l’appeller.
vice-deus. Si la baffeffe de l’adulation n’eft pas allée
plus loin dans les-temps modernes, on fait que,
fous les empereurs romains , elle fe permit le blaft
phême, 8c quelle ne craigfiit pas d e ,les appeller
des dieux.
Honneurs renaus aux reprèjentans des fouverains.
1°. Les ambaffadeurs extraordinaires 8c ordinaires
T un fouyerain ont le pas & la préféance fur ,
tous les miniftres du fécond ordre, quoique leurs
maîtres foient d’un rang fupérieur, & les miniftres
du fécond ordre prennent à leur tour ce pas fur
ceux du troifième ordre, malgré l’inégalité du rang
dont leurs fouverains jouiffent en Europe., S i, par
exemple, dans une même cour , dans une même
république ou à un même- congrès, il fe trouvoit.
un ambaffadeur durai de Naples ou delà république
de Venife, & un envoyé extraordinaire durai de
France , on dit que , dans toutes les cérémonies >
celui-ci le céderait aux ambaffadeurs, 8c de même'
un envoyé extraordinaire du plus petit prince fou-'
verain prendroit le pas- fur un réfident d’Angleterre
ou d’un autre ro i, quoique les’ dignités de.
leurs ■ •maîtres refpeÇtifs foient fort inégales. Au
rèfte , cés inutiles détails de la . diplomatique ne>
font point réglés d’une manière fixe 5 il n’y a pas
fur cette matière de principes reconnus par toute»
les puiffances, 8c l’on ne doit s’ attendre à trouver
ici que ce qui s’eft fait communément..
2°. Les miniftres publics du même ordre prennent
leur rang, félon celui que tient leur maître’
parmi les autres fouverains. C ’ eft ainfi qu’un légat-
a latere du pape occupe la première place dans1
toutes les cours catholiques , enfuite celui de l’empereur
, après lui celui de France, 8c ainfi des
autres. Les miniftres du fécond ordre obfervent
entre eux la même règle que fuivent également, ceux
4du troifième.
30. Tous les honneurs que l’on rend à un mi-
niftre public, font, fondés fur le caractère dont il
eft revêtu en vertu de fes lettres dé créance.
On dit qu’en général les miniftres étrangers qui
réfident à la même cour , obfervent les règles que
■ voici. Un ambaffadeur ordinaire cède à l’ambaffa-
deur extraordinaire, un envoyé à un ambaffadeur ,
un réfident a un envoyé, & ainfidu refte , fan%
égard au rang de leur maître j les miniftres du fécond
ordre font la première vifite à ceux du pre->
mier, qu’ ils foient arrivés plus tôt ou plus tard ;
ils donnent aux ambaffadeurs le titre Üexcellence j
ils les reçoivent à . la defçente du carroffe , 8c les
reconduisent de même 5 les ambaffadeurs ne font recevoir
ün envoyé que par un député, 8c ils les attendent
à la porte de l’ anti-chambre ; un ambaffadeur
. prend la droite, même chez foi, fur les envoyés des
j couronnes, 8c ne leur préfente’ qu’une chaife à dos 5,
il a droit d’exiger qu’on place des fèntinelles a
fg porte j- il peut demander une entrée publique ,
les honneurs militaires, fe couvrir devant le fouve-
rain 3 mais on fent combien ces prétendues règles
fouffrent d’ exceptions, 8c le peu d’intérêt qu’on
met à ces bagatelles, depuis que la politeffe 8c la
raifon ont fait des progrès.
4°i. Outre-les miniftres publics , on voit fré-*
quemment arriver dans les cours, des gentilshommes
, des courtifans, de‘s perfonnes chargées par
les fouverains étrangers de commiffions particulières.
Le droit des gens ou plutôt l’ ufage ne leur
accordent d’autre prérogative-qué la fureté publi- |
que, & il n’y a pas de conventions entre les fouverains
en vertu defquelles ils puiffent exiger des
‘honneurs 8c des diftinétions. Mais les princes* de
l’Europe policée ne refufent pas l’entree de leur
cour aux perfonnes qui font nobles , & qui occupent
des. charges confidérables chez les autres fouverains
, & ils leur font un accueil honorable.
Lés^honneurs que les fouverains fe_ font rendre
dans leurs cours ,j$$$les diftinétions qu’ils accordent
à leurs fujets, foraieht la cinquième partie-du céré-
monial. Elle comprend i° . l’ arrangement de toutes
les cérémonies ulitées dans les occafions folemnel-
les || 20.,le réglement pour le rang ; 30. l’étiquette
ordinaire de la cour j 40. les cérémonies que les
magiftrats des villes compagnies privilégiées j par-
lemens , univerfités 8c autres corps diftingués obfervent
y à quoi l’on peut • ajouter j 50; \t cérémonial
ufité dans les républiques.
Le mot d’ étiquette fignifie, dans le fens naturel, urte
efpèce d’infcription que l’on met fur quelque chofe
qui defigne la qualité , le nom ôü le prix d’une
chofe 5 mais on s’en fert aujourd’hui pour exprimer
les réglemens fur la manière de vivre du foü-
verain 8c de fa famille, les honneurs quil fe fait
rendre, les charges , fondions 8c prééminences des
courtifans , la réception des étrangers , les diftinc-
tions accordées àr*quelques individus, les cérémonies
qu’il faut obferver en certaines occafions, 8cc.
Ces-réglemens ne fe confervent pas toujours par
la tradition j il y en à de rédigés en- forme de loi,
Telle eft l’ ancienne étiquèté de Bourgogne , dont
on voit encore les veftiges và la cour de Vienne &
à- celle d’Efpagne. Que ces objets foient déterminés
en maffe , il n’y a rien de déraifonnable j-un ordre
vaut toujours mieux que la confufion : mais qu’on
faffe de l’étiquette un objet de la première importance}
qü’on foit d’üne févérité fcrupüleufe fur
l’obfervation d’un vain 'cérémonial 5 que les - fquve-
rains fe réduifent eux, leur famille & leurs fervi-
teurs, au fort des automate? qui femblënt ne fe
mouvoir que par lesloix de la méchanique, & que
le rang & la naifianCe aient des prérogatives auxquelles
le mérite,, le plus noble appanage de l’humanité
ne fauroit jamais atteindre , ce n’ eft pas , il
faut en convenir, une grande preuve de fagefle ou
de raifon. On ne fauroit lire fans dégoût les petites
combinaifons que l’ étiquette a imaginées en Elpa-
gne. On en cite un exemple que je né puis croire.
Philippe III étoit gravement aflis à côté d’une
cheminée dans laquelle le feutier de la cour avoit
mis une fi grande quantité de bois , que le monarque
penfa étouffer de chaleur. Sa grandeur ne lui
permettoit point de fe levër pour appeller du fe-
cours V les officiers en charge s’étoient éloignés ,
& lés domeftiques n’iofoiènt entrer dans l’appartement
5 le marquis de Pobar parut à là fin : le roi
lui ordonna d’éteindre le feu ; mais celui-ci répondit
que l’étiquette ne lui permettoit pas d’exercer
une pareille fondions qu’il falloit appeller le duc
d’Uffeda. Le duc étoit forti , la flamme"augmenta.9
le roi la foutint^plutôt que de déroger à fa dignité»
mais il s’échauffa.tellement le fang, que le lendemain
il eut un éréfipele à la tête avec des redou-
blemens de fièvre, qui l’emportèrent l’an 1621 dans
la vingt-quatrième année de fon âgé.
Lés républiques0 né mettent pas au cérémonial
moins d’importance qué les cours. Les chefs 8c
tous ceux qui compofent la magifttature, étant pris
ou dans le corps des patriciens ‘3 du dans la bour-
geoifie, ou dans le peuple , il importe au maintien
du bon ordre 8t de l’état qu’un-extérieur impofant
donne de l’éclat à leur charges. La politique a be-
foin de faire jouer tous fes reflorts pour obliger un
citoyen à obéir à un autre citoyen , qui hier etoit
fon égal, & qu’ il .doit confîdéirer aujourd’hui pref-
que comme fort foüverain. Les honneurs dont chaque
magiftrat jouit, font d’ ailleurs la principale re-
compenfe de fes peines. L ’état n’accorde ordinairement
à fes chefs que de modiques falaires , au.
lieu que les fouverains 8c leurs miniftres font toujours
bien payés. Un autre motif détermine les. républiques1
a obferver des gradations dans les honneurs
qu’ elles font rendre à chaque ordre de la ma-
giftraturé ; elles veulent maintenir la fubordination
fî néceffaire dans la fociété, exciter l’émulation des
membres du gouvernement, 8c infpirer aux citoyens
le de'fîr* d’acquérir de plus grands honneurs.
C E S S A R E S; ( république des ). Le roman
politique , où l’ on trouve le plan de cette république
imaginaire, eft intitule: relation du premier
étahlijfement 3 des lo ix , du gouvernement & de la
■. policé des CefTares , peuples de \VAmérique méridionale
; en neuf lettres de M. V^an der Neck y
magiftrat de cette nation} a un de fes amis en
, Hollande s avec des notes de l’éditeur.
Il parut en anglois à Londres en 17 6 4 , je ne
fâche pas qu’il ait été traduit en aucune langue.
Les paflions humaines, dit l’auteur, ont juf-
qu’ici empêché 8c empêcheront vraifemblablement
toujours l’établifTement d’un fyftême de gouvernement
fondé fur la bafe du bien public, bafe trop
grande pour des adminiftrateurs dont l’efprit eft
rappétifle par tant de chofes, mais furtout par
leur intérêt particulier. On eft en général fi con-
1 vaincu de cette vérité, fi perfuadé que les
défordres. 8c le vice triompheront fur la terre ,
qu’on a traité de projets vains 8c chimériques
tous les plans, qui avoierit la liberté pour unique
but. Platon , Morus , Harrington , 8c d’autres
n’ont-ils pas été regardés comme des vifionnaires ,
parce qu’ ils* ont voulu fonder une république fur
les principes de la juftice ? Quoi qu’on puifte
dire des projets de cette efpèce , ils contiennent
des vues dignes d’une férieufe attention de la
part des légillàteurs.
Que le peuple des Cefares exifte ou n’existe
pas } que- le nom de Van der Neck fbit
• fuppofé ou non* peu importe au leéteur. I l lu*