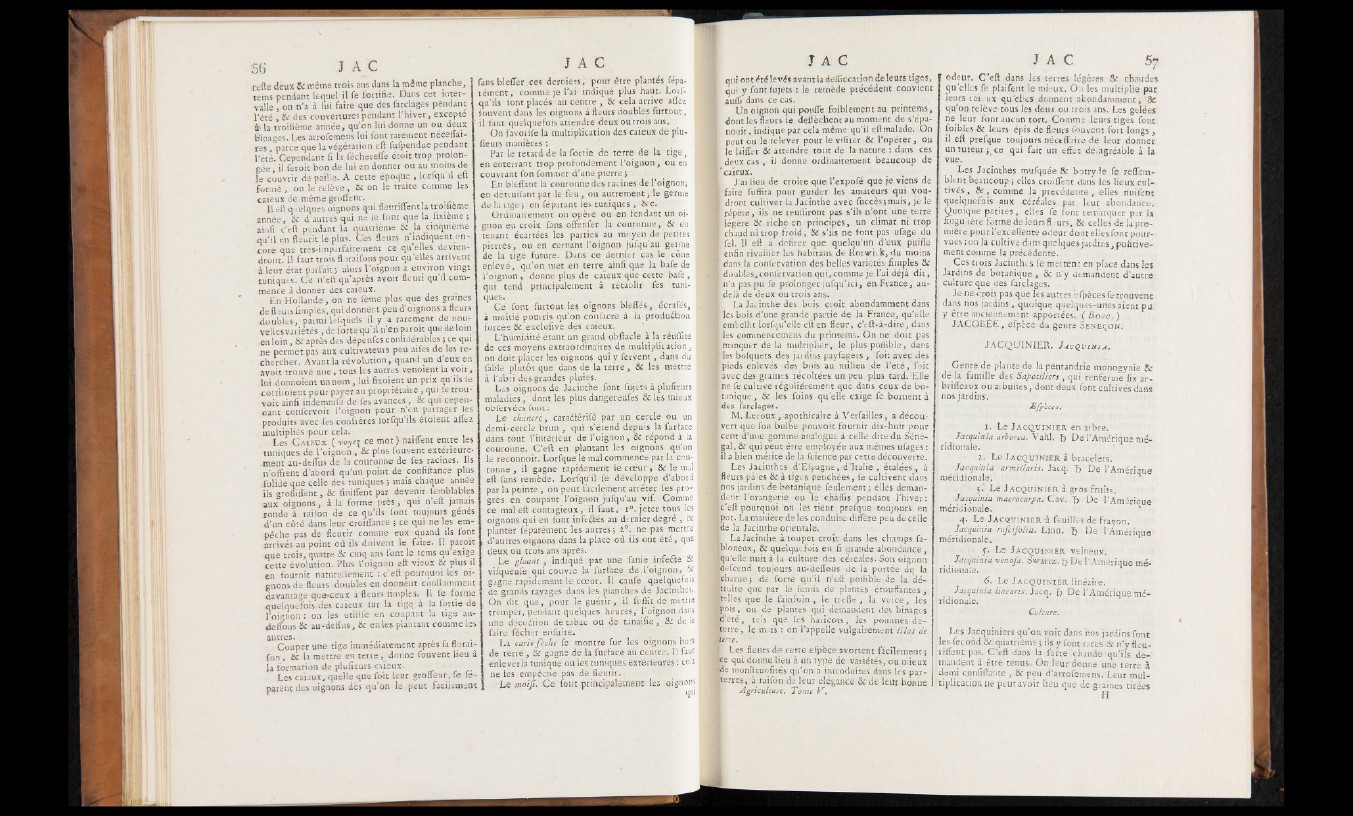
refte deux 8e même trois ans dans la même planche.,
tems pendant lequel il fe fortifie. Dans cet intervalle
, on n’a à lui faire que des farclages pendant
l’é t é , 8c des couvertures pendant l'hiver, excepte
# la troifième année , qu’on lui donne un ou deux
binages. Les arrofemens lui font rarement néceffai-
re s , parce que la végétation eft fufpendue pendant
l'été. Cependant fi la féchereffe étoit trop prolongée
, il feroit bon de lui en donner ou au moins de
le couvrir de paille. A cette époque , lorfqu'il eft
formé, on le relève, 8c on le traite comme les
caïeux de-même groflenr. . „ .
11 eft quelques oignons qui fleuriffentla t r o d i e m e
année, & d'autres qui ne le font que la fixième 5
ainfi c’eft pendant la quatrième 8c la cinquième
qu’ il en fleurit le plus. Ces fleurs n indiquent encore
que très-imparfaitement ce qu’elles d e v i e n d
r o n t . I l faut trois fbraifons pour qu'elles arrivent
à leur état parfait; alors l ’oignon a environ vingt
tuniques. Ce n'eft qu’après avoir fleuri qu’il commence
à donner des caïeux.
En Hollande, on ne fème plus que des graines
de fleurs fimple.s, qui donnent peu d oignons à fleurs
doubles, parmi lefquels il y a rarement de nouvelles
variétés , de forte qu’il n’en paroît que de loin.
en loin, & après des dépenfes confidérables 5 ce qui
ne permet pas aux cultivateurs peu aifés de^ les rechercher.
Avant la révolution, quand un d eux en
avoit trouvé une, tous les autres venoient la voir,
lui donnoient un nom, lui fixoient un prix qu ils fe
cottiloient pour payer au propriétaire, qui fe trou-
voie ainfi indemnife de les avances, 8c qui cependant
confervoit l’oignon pour n en partager les
produits avec fes confrères lorfqu ils étoient allez
multipliés pour cela.
Les C a ï e u x ( voye^ ce mot) naiflent entre les
tuniques de l'oignon, 8c plus fouvent extérieüre-
-tnent au-deffus de la couronne de fes racines. Ils
n’offrent d'abord qu’ un point de confiftance plus
.folide que celle des tuniques ; mais chaque année
ils grofliffenc, &c fini lient par devenir femblables
aux oignons, à la forme près, qui n eft jamais
ronde à raifon de ce qu’ ils font toujours gênés
d’un côté dans leur croillance 5 ce qui ne les empêche
pas de fleurir comme eux quand ils font
arrivés au point où ils doivent le faire. Il paroît
que trois, quatre 8c cinq ans font le tems qu’exige
cette évolution. Plus l’oignon eft vieux 8c plus il
en fournit naturellement : c’ eft pourquoi les oignons
de fleurs doubles en donnent conftamment
davantage que-ceux à fleurs Amples. ^11 fe forme
quelquefois des caïeux lur la tige^à la fortie de
Poignon : on les utilife en coupant la tige au-
4eflous 8c au-deffus, 8c en les plantant comme les
autres. . . ! c a I
Couper une tige immédiatement apres la tlorai-
fon, & la mettre en terre, donne fouvent lieu à
la formation de plufieurs caïeux.
Les caïeux, quelle que foit leur grofleur, fe réparent
des oignons dès qu’on le peut facilement
fans bleffer.ces derniers, pour être plantés fépa- |
rément, comme je l’ai indiqué plus haut. Lorf- I
qu’ils font placés au centre, 8c cela arrive affez I
louvent dans les oignons à fleurs doubles furtout, I
il faut quelquefois attendre deux ou trois ans.
On favorife la multiplication des caïeux de plu- I
fleurs manières :
Par le retard de la fortie de terre de la tige, I
en enterrant trop profondément l'oignon, ou en I
couvrant fon fommer d’ une pierre ;
En bleffant la couronne des racines de l’oignon; I
en détruifant par le feu , ou autrement, le germe I
de la tige ; en féparant les tuniques , &'c.
Ordinairement on opère ou en fendant un oi- I
gnon en croix fans offenfer la couronne, & en I
tenant écartées les parties au moyen de petites I
pierres, ou en cernant l’oignon jufqu’au germe I
de la tige future. Dans ce dernier cas le cône I
enlevé, - qu’on, met en terre ainfi que la bafe de I
l’oignon , donne plus de caïeux que cette bafe , I
qui tend principalement à rétablir fes tuni- I
ques. •
Ce font furtout les oignons bleffés, écrafés, I
à moitié pourris qu’ on confacre à la produélion I
forcée & exclufîve des caïeux.
L’humidité étant un grand obftacle à la réuffite
de ces moyens extraordinaires de multiplication,
on doit placer les oignons qui y fervent, dans du
fable plutôt que dans de la terre, 8c les mettre [
à l’abri des grandes pluies..
LwS oignons de Jacinthe font fu-jets à plufieurs
maladies, dont les plus dangereufes 8c les mieux
obfervées font :
Le chancre, caraélérifé par un cercle ou un
demi-cercle brun , qui s’étend depuis la furface
dans tout l’ intérieur de l’ oignon, ■8c répond à la
couronne. C ’eft en plantant les oignons qu^on
le reconnoît. Lorfque le mal commence par la couronne
, il gagne rapidement le coeur, 8c le mal
eft fans remède. Lorfqu'il fe développe d’abord
par la pointe, on peut facilement arrêter fes progrès
en coupant l’oignon jufqu’au vif. Comme
ce mal eft contagieux, il faut; i° . jeter tous les
oignons qui en font infeétés au dernier degré , &
planter féparément les autres; 20. ne pas mettre
d’autres oignons dans la place où ils ont é té , que
deux ou trois ans après.
Le gluant , indiqué par une fanie infeéte &
vifqueufe qui couvre la furface d e ,l’oignon, &
gagne rapidement le coeur. Il caufe quelquefois
de grands ravages dans les planches de Jacinthes.
On dit que, pour le guérir, il fuffit de mettre
tremper, pendant quelques heures,1 l’oignon .dans
une décoôtion de tabac ou de. tanaifîe , 8c de le
faire fécher enfuite.
La carie fèche fe montre fur les oignons hors
de terre, 8c gagne de la furface au centre'. Il faut
enlever la tunique ou les tuniques extérieures : cela
ne les empêche pas de fleurir.
Le moi fi. C e font principalement les oignons
q u i
I J A C
qui ont été levés avant la deflïccation de leurs tiges,
qui y font fujets : le remède précédent convient
aufli dans ce cas.
Un oignon qui pouffe foiblement au printems,
dont les fleurs le deffèchent au moment de s'épanouir
. indique par cela même qu’il eft malade. On
peut ou le relever pour le vifiter & l’opérer, ou
( le laiflcr & attendre tout de la nature : dans ces
[ deux cas | il donne ordinairement beaucoup de
caïeux.
J'ai lieu de croire que l’ expofé que je viens de
ffaire fuffira pour guider les amateurs qui you-
I dront cultiver la Jacinthe avec fuceès; mais, jè le
répète, ils ne réu fi iront pas s’ils n’ont une terre
légère 8c riche en principes, un climat ni trop
chaud ni trop froid, & s’ils ne font pas ufage du
fel. Il eft • à defirer que quelqu’un d'eux puiffe
enfin rivalilèr les habitans de Rorwkk, du moins
dans la confervation des belles variétés fimples &
doubles,confervation qui,comme je l’ai déjà dit,
n’a pas pu fe prolonger jufqu’ ic i, en France,.au-
delà de deux ou trois ans.
La Jacinthe des bois croît abondamment dans
I les bois d’une grande partie de la France, qu’elle j
embellit lorfqu’elle eft en fleur, c’eft-à-dire, dans i
B les commencemens du printems. On ne doit pas
B manquer de la multiplier, le plus pofiibie, dans
B les bofquets des jatdins payfage:;s , fort avec des
« pieds enlevés des bois au milieu de l'é té , foie I avec des. graines récoltées un peu plus tard. Elle
ne fe cultive régulièrement que dans ceux de bo-
w ranique, & les foins qu'elle exige fe bornent à
.■ des farclages.
I M. Leroux, apothicaire à Verfailles, a découvert
que fon bulbe pouvoir fournir dix-huit pour
B cent d’ une gomme analogue à celle dite du Séné-
I gai, & qui peut être employée aux mêmes ufages :
Il a bien mérité de la fcience par cette découverte.
I Les Jacinthes d'Efpagne, d'Italie , étalées, à
v fleurs pâles & à tiges penchées, fe cultivent dans
nos jardins de botanique feulement ; eilës deman-
. dent l'orangerie ou le châflis pendant l’hiver:
a c’eft pourquoi on les tient prefque toujours en
Ip ot. La manière de les conduire diffère peu de celle
■ de la Jacinthe orientale. -1 . . -
B La Jacinthe à toupet croît dans les champs fa-
'IbloneuXj 8c quelquefois en fi grande abondance,
•qu'elle nuit à la culture des céréales» Son oignon
; fdefeend toujours au-deffous de la portée de la
Bcharue 5 de. forte qu'il n'eft poflible.de la. dé-
-ftruire que par le femis de plantes étouffantes ,
telles que .le fainfoin , le trè fle ,, la v efce, les
«pois, ou de plantes qui demandent des binages
d’é té , tels que les haricots, les pommes-de-
f|terre-, le maïs : on l’appelle vulgairement lilas de
■ 'ijEerre. " c
■ Les fleurs de cette efpèce avortent facilement ;
'p e qui donne.lieu à un type de variétés, ou mieux
«de monfttuofités qu’on a introduites dans les par-
Jterres , à raifon de leur élégance 8c de leur bonne
Agriculture. Tome V.
odeur. C ’eft dans les terres légères 8c chaudes
quelles fe pîaifent le mieux. On les multiplie par
leurs caïeux quelles donnent abondamment, &
qu’on relève tous les deux ou trois ans. Les gelées
ne leur font aucun tort. Comme leurs tiges font
foibles & leurs épis de fleurs fouvent fort longs y
il eft prefque toujours néceflaire de leur donner
un tuteur ce qui fait un effet désagréable à la
vue.
Les Jacinthes mufquée 8c botryde fe reffem-
blent beaucoup; elles croiffent dans les lieux cultivés
, & , comme la précédente, elles nuifent
, quelquefois aux céréales par leur abondance.
Quoique petites, elles fe font remarquer par la
finguhère forme de leurs fl -urs, & celles de la pre-
; mière pour l’excellente odeur dont elles font pourvues
: on la cultive dans quelques jardins, positivement
comme la précédente.
Ces trois Jacinthes fe mettent en place dans les
Jardins de botanique, & n’y demandent d’autre
culture que des farclages. j
■ Je ne crois pas que les autres èfpècesfe trouvent
dans nos jardins, quoique quelques-unes aient pu y être anciennement apportées., ( Bosc. )
JACOBÉE, efpèce du genre Seneçon.
JACQUINIER. J a c q u in ia .
Genre de plante de la pentandrie monogynie 8c
. de la famille des Sapotiliers , qui renferme fix ar-
: brifleaux ou atbulïes, dont deux font cultivés dans
nos jardins.
Efpeces.
1. Le Ja c q u in ie r en arbre.
Jacquinia arborea. Vahl. De l'Amérique mé-
; ridionale.
1. Le Jacquinier à bracelets.
Jacquinia armiClaris. Jacq. J) De l’Amérique
méridionale,
3- Le Jacquinier à gros fruits.
Jacquinia macrocarpa. Cav. f) De l ’Amérique
méridionale.
4* Le Jacquiniervà feuilles de fragon.
Jacquinia rufcifolia. Linn. 1) De l'Amérique-
méridionale. 1
5. Le Jacquinier veineux.
Jacquinia venofa. Swmp.f) De l’Amérique méridionale.
6. Le Jacquinier linéaire.
Jacquima linearis. Jacq. q De l’Amérique méridionale.
Culture. .
Les Jacquiniers qu’on voit dans nos jardins font
les fécond & quatrième; ils y font rares & n’y fleu-
riffent pas. C'eft dans la ferre chaude qu’ils demandent
demi confifianté, 8c peu d’arrofemens. Leur multiplication
à être tenus» On leur donne une terre à
ne peut avoir lieu que de graines tirées
H