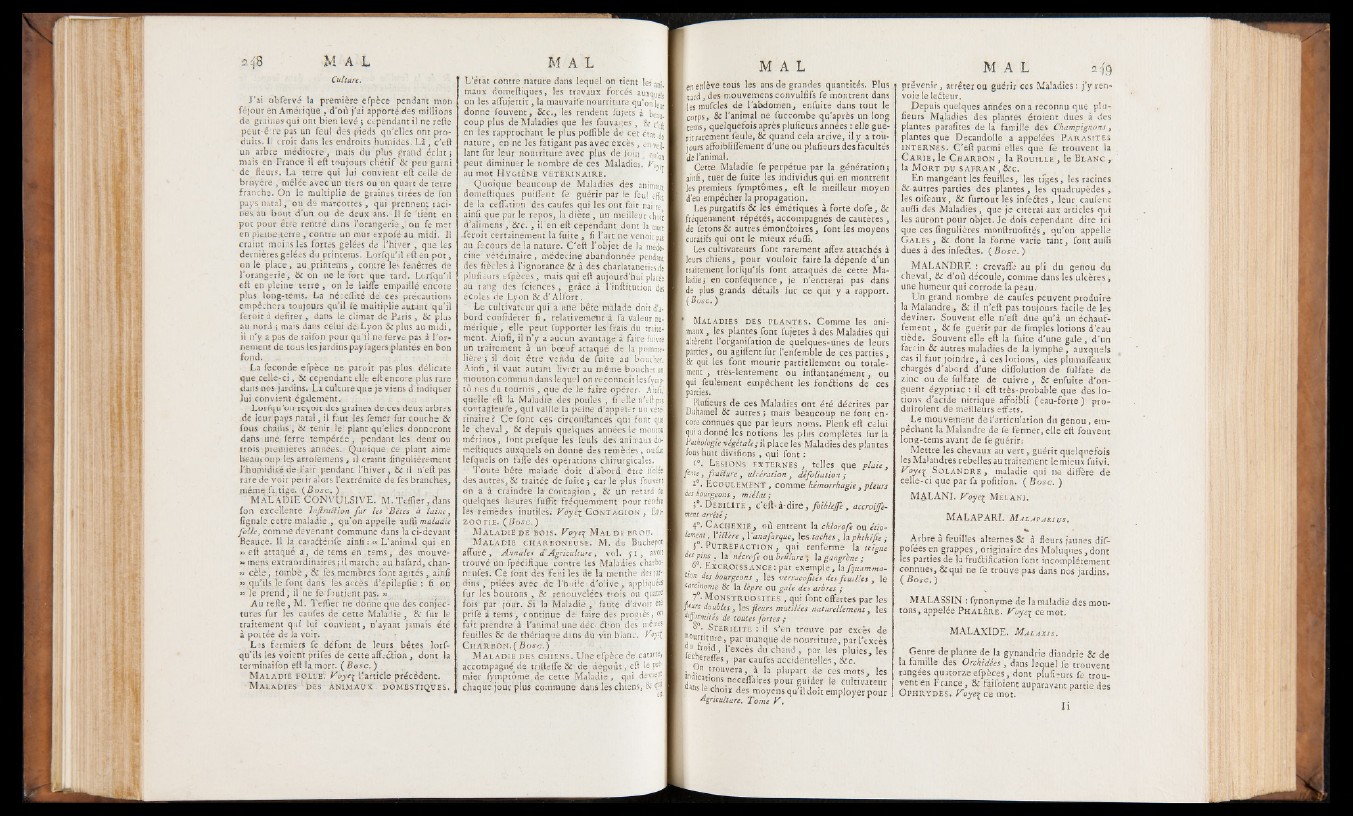
C u ltu r e .
J‘ai obferve la première efpèce pendant mon
réjour en Amérique * d’où j’ai apporté des millions
de graines qui ont bien levé; cependant il ne rèfte
peut-ê:re pas un feul des pieds qu’elles ont produits.
Il croît dans les endroits humides. L à, c’eft
un arbre médiocre, mais du plus grand éclat ;
mais en France il eft toujours chétif & peu garni
de fleurs. La terre qui lui convient eft celle de
bruyère , mêlée avec un tiers ou un quart de terre
franche. On le multiplie de graines tirées de fon
pays natal / o u de marcottés , qui prennent racines,
au bout d’un ou de deux ans. Il fe 'tient en
pot pour être rentré dans l’orangerie , ou fe met
en plçiue.cerre, contre un mur expofé au midi. Il
craint moins les fortes gelées de l’hiver , que les
dernières gelées du prinçems. Lorfqû’il eft en pot,
on le place, au ^printems , contre les fenêtres de
l’orangerie, & on ne le fort que tard. Lorfqu’il
eft en pleine terre, on le biffe empaillé encore
plus long-tem$. La néceflité de ces précautions
empêchera toujours qu’il fe multiplie amant qu’il
l’eroit à defirer, dans le climat de Paris, & plus
au nord ; mais dans celui deLyon & plus au midi,
il n’y a pas de raifon pour qu il ne ferve pas à l’ornement
de tous les jardins payfagers plantés en bon
fond.
La fécondé efpèce ne paroît pas plus délicate
que celle-ci, & cependant elle eft encoreplus rare
.dans nos jardins. La culture que je viens d'indiquer
lui convient également.
Lorfqu*on reçoit des graines de;ces deux arbres
dé leurpays natal, il faut les femer fur couche &
fous châftts, & tenir le plant qu’elles donneront
dans une. ferre tempérée, pendant. les deux ou
trois premières années. Quoique ce plant aime
beaucoup le£ arrofemens , il craint linguliérement
l’humidité de J’air pendant l’hiver, & il n’eftpas
rare de voir périr alors l’extrémité de fes branches,
même .fa. tige. • ( B o s e . ) .
MALADIE CONVULSIVE. M. Tejïier ,.dans
fon excellente ln f t r u f t io n f u r le s 'B ê t e s à la in e ,
figpale cetre maladie,, qu’on appelle aulïi m a la d ie
f o l l e , comme devenant commune dans la ci-devant
Beauce. Il la caraélérife ainfi ; ,<* L’animal qui en
» eft attaqué a, de tems en .tems, des mouve-
» mens extraordinaires ; il marche au hafard, chan-
>3 cèle, tombé, & fes, membres font agités, ainlî
» qu’ils le font dans les accès d’i pile plie : fi on
33 le prend; il ne le-'fou tientpas. >3 .
Au relie, M. Teftîér né dôrîne que des conjectures
fur les caufes de cette Maladie, & fur le
traitement qui lui convient, n’ayant jamais été
à portée de la voir.
Les fermiers fe défont de leurs bêtes lorsqu'ils
les voient prifes de cette affeélion , dont la
terminaifon eft la.mort. (Bose. )
Maladie foldeI V o y t [ l’article précèdent.
Maladies '■ des an im aux, domestiques.
L’état contre nature dans lequel on tient les ani.
maux domeftiques, les travaux forcés auxquels
on les affujettit, la mauvaife nourriture qu’on leur
donne fouvent, &c., les rendent fujets à beau,
coup plus de Maladies que les fauvages, & ^
en les rapprochant le plus poflible de cet état de
nature, en ne les fatigant pas avec excès, en veillant
fur leur nourriture avec plus de foin, qu’on
peut diminuer le nombre de ces Maladies. Voy*
au mot Hygiène vétérinaire.
Quoique beaucoup de Maladies des animaux
domeftiques puiffent fe guérir par le feu! effet
de la ceffution des caufes qui les ont,fait naî:re
ainfi que par le repos, la diète , un meilleur choix
d’ali mens, t i c . , il en eft cependant dont la mort
-feroit certainement la fuite , fi l’art ne v en oit pas
au fecours de la nature. C’eft l’objet de la médecine
vétéiinaire, médecine abandonnée pendant
des fiècles à l’ignorance & à des charlataneriesde
plufiems efpècés, mais qui eft aujourd’hui placés
au rang des fciences , grâce à Tinftitution des
écoles de Lyon &. d’Alfort.
Le cultivateur qui a une bête malade doit d’abord
confidérer fi , relativement a fa valeur numérique
, elle peut fupporter m ent. les frais du traiteAinfi,
il n’y a aucun avantagé à faire fuivre
un traitement à un boeuf attaqué dé la pomme-
lière ; il doit être veridu de fuite au boucher.
Ainfi, il vaut autant livrer au même boucher un i
mouton commun dans lequel oh reconooït les fymp-
tomes du tournis , que de le- faire opérer. Ainfi, |
qtielle eft la Maladie des poules , fi elle n’eftpas
contagieufe, qui vaille la peine d’appeler un vétérinaire?
Ce font ces cirçonftancés qui font que
le cheval, & depuis quelques années le mouton
mérinos , font prefque les feuls des animaux domeftiques
auxquels on donne des rem èd es, ou fur
lefquels on faffe des opérations chirurgicales.
Toute bête malade doit d’abord être ifelée
des autres, & traitép de-fuite; car le plus fouvent
on a à Craindre la contagion, & un retard de
quelques heuresffuffit fréquemment pour rendre
les’ remèdes in utiles.-:Voyer_ Contagion , Epizootie.
(Bosc.)
Maladie d é b o i s . Voye^ Mal de b r o u .
Maladie charbonèuse. M , de Buchepot
affure , A n n a l e s d ’A g r ic u ltu r e , vol. y i , avoir
trouvé un fpécifique contre les Maladies charbo-
neufes. Cè font des feui les de la menthe des jardins'
, pilées avec de l’huile - d'olive,. appliquées
fur les boutons, & renouvelées trois ou quatre
fois par jour. Si la Maladie , ‘ faute d’avoir été
prifé à tems, contiriue de faire des progiès, on
fait prendre à l’animal une déc< étion des mê.nes
feuilles & de thériaque dans dû vin blanc. Voyl,
C harbon. ( B o$ç.) . M a l a d ie d e s c h ie n s . Une efpèce de .catarre,
accompagné de trifteffe & deydégout, eft le FfÊ‘
mier fy mptôtne.de cetie Maladie, qui devierM
chaque jour plus commune dans les chiens, & qll‘
Maladies des plantes. Comme les ani-
.maux, les plantes font fujètes à des Maladies qui
[altèrent l’organifation de quelques-unes de leurs
parties, ou agiffent fur l’enfemble de ces parties,
& qui les font mourir partiellement ou totalement
, très-lentement ou inftantanément, ou
qui feulement empêchent les fondions de ces
[■ parties.
!" Plufîeurs de ces Maladies ont été décrites par
Duhamel t e autres ; mais beaucoup ne font en-
’core connues que par leurs noms. Plenk eft celui
qui a donné les notions les plus complètes fur la
Pathologie végétale; il place les Maladies des plantes
fous huit divifions , qui font :
i I0- Lésions externes , telles que plaie,
Uente y fra.5iu.re , u lc é ra t io n , d é fo l ia t io n y
r i°. Ecoulement , comme h ém o r r h a g ie , p le u r s
[des bourgeons, m ié la t ;
5°. Débilité , c’eft-à-dire, foiblejfe, accroife-
ment arrêté :
4°* C achexie, où entrent la chlorofe ou étio-
yement, YiBere , l ‘anafarque, les taches} la phthifie ;
j°. Putréfaction , qui renferme la teigne
Pins . la nécrefe ou Brûlure * la gangrène ;
| 6 • Excroissance : par exemple, la fquamma-
Won des bourgeons } les verrucofités des feuilles , le
Icarcinome tl la lèpre ou gale des arbres y
1 7 - Monstruosités , qui font offertes par les
fpirc doubles, les fleurs mutilées naturellement, les
|»,d if0f.o0r mict_és ■ de toutes Cortès J • i , ° - stérilité : il sen trouve par exces de
i nourrit u r è , par manque de nourriture, par l’excès
[J,u troid, l’excès du chaud , par. les pluies, les
! g r e ffe s , par caufes accidentelles, &c.
J- ,?n p ro u vera, à la p lu p a rt d e ces m o t s , les
n ications néceffaires p o u r g u id er le c u ltiv a te u r
I ansI® c h o ix des m o y e n s q u ’ il d o it em p lo y e r p o u r
Agriculture* Tome ,
prévenir, arrêter ou guérir ces Maladies : j’y renvoie
le ledeur.
Depuis quelques années on a reconnu que plu-
fieurs Maladies des plantes étoient dues à des
plantes parafites de la famille des C h am p ig n o n s ,
plantes que Decandolle a appelées Parasites
internes. C’eft parmi elles que fe trouvent la
C ar ie , le C harbon , la Rouille , le Blanc ,-
la Mort du safran , &c.
En mangeant les feuilles, les tiges, les racines
&• autres parties des plantes, les quadrupèdes,
les oifeaux, & furtout les infedes , leur caufenc
aufli des Maladies, que je citerai aux articles qui
les auront pour objet. Je dois cependant dire ici
que ces fingulières monftruofités > qu’on appelle
Gales, & dont la forme varie tant, font auffi
dues à des infedes. ( B o s c . )
MALANDRE : crevaffe au pli du genou du
cheval, t e d’où découle, comme dans les ulcères,
une humeur qui corrode la peau.
Un grand nombre de caufes peuvent produire
la Malandre, & il n’eft pas toujours facile de les
deviner. Souvent elle n’eft due qu’à un échauf-
fement, & fe guérit par de fimples lotions d’eau
tiède. Souvent elle eft la fuite d’une gale, d’un
far ein & autres maladies de la lymphe , auxquels
cas il faut joindre, à ces lotions, des plumafleaux
chargés d'abord d’une diffolution de fulfate de
zinc ou de fulfate de cujvre, & enfuite d’onguent
égyptiac : il eft très-probable que des lotions
d’acide nitrique affoibli (eau-forte) pro-
duiroient de meilleurs effets.
Le mouvement désarticulation du genou, empêchant
la Malandre de fe fermer, elle eft fouvent
long-tems avant de fe guérir:
Mettre les chevaux au v ert, guérit quelquefois
les Malandres rebelles autrairement iemieux fuivi.
Solandre , maladie qui ne diffère de
celle-ci que par fa pofnion. ( B o s c . )
MALANI. V o y e ^ Mf.lani.
MALAPARI. M j l a c a r i o s .
Arbre à feuilles aiternes-& à fleurs jaunes dif-
pofées en grappes, originaire des Moluques, dont
les parties de la fruéfification font incomplètement
connues, &qui ne fe trouve pas dans nos jardins,
( B o s c . )
MALASSIN : fynonyme de la maladie des moutons,
appelée Pi-ialère. V o y s ç ce mot.
MALAXIDE. M a l a x i s .
Genre de plante de la gynandrie diandrie & de
la famille des O r c h id é e s , dans lequel fe trouvent
rangées quatorzeefpèces, dont plulîeurs fe trouvent
en France, & faifoient auparavant partie des
Ophrydès. V o y e^ ce mot.
Ii