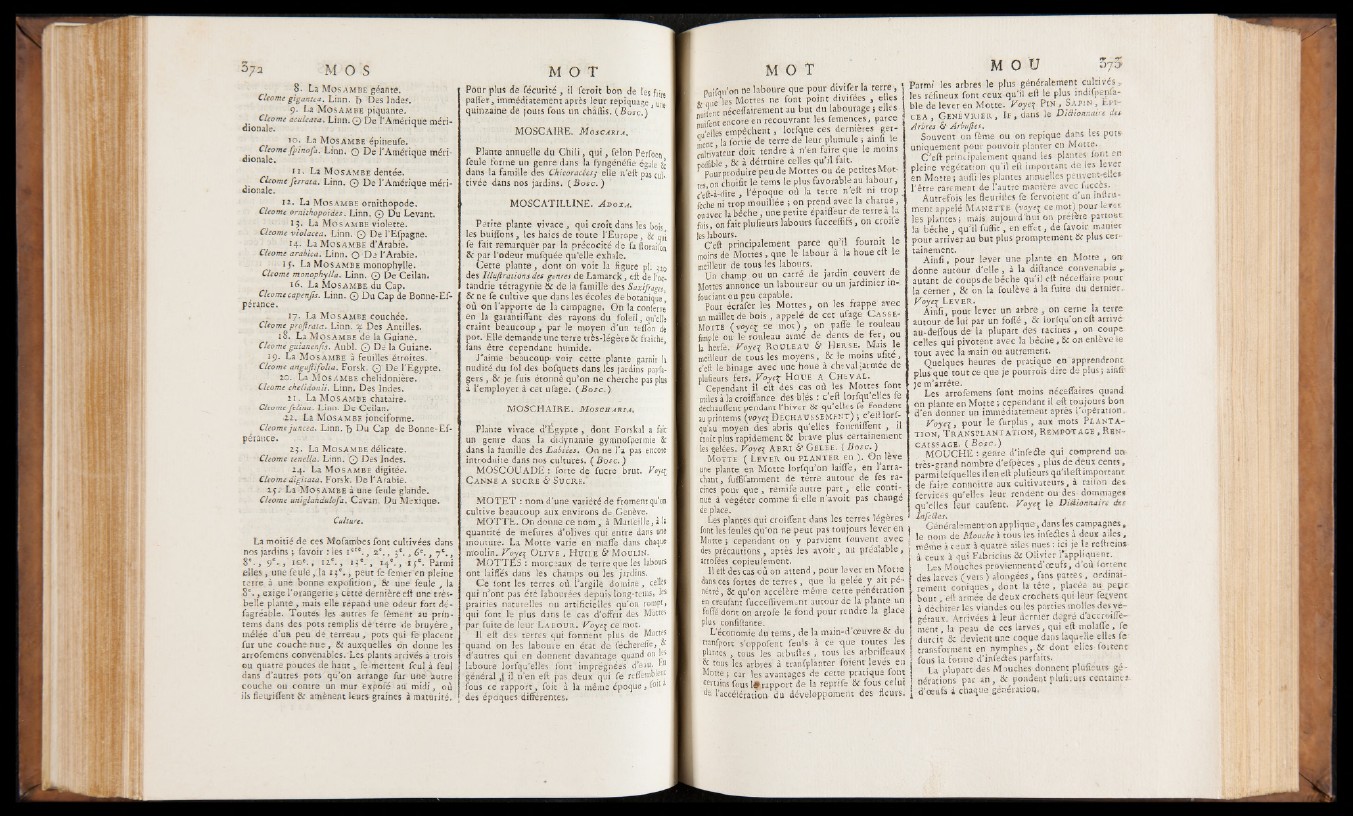
8. L a Mosambe g é a n t e .
C U om t g ig a n i c a . Linn. T> Des Indes. 9* La Mosambe piquante.
C le om e a c u le a ta , Linn. © De l'Amérique méridionale.
0
ïo. La Mosambe épiiieufe.
C le om e f p in o fa . Linn. O De l'Amérique méridionale.
11. La Mosambe dentée.
C U om t [ e r r a ta . Linn. © De l'Amérique méridionale.
12. La Mosambe ornithopode.
C U om t o r n ith o p o id .e s . Linn. © Du Levant.
13. La Mosambe violette.
C le om e v io la c e a . Linn. © De l’Efpagne.
14. La Mosambe d’Arabie.
C le om e a ra b ic a . Linn. O De l'Arabie.
i j . La Mosambe monophylle.
C le om e m o n o p h y lla . Linn. © De Ceilan.
16. La Mosambe du Cap.
C le om e c a p e n p s . Linn. © Du Cap de Bonne-Ef-
pérance.
17. La Mosambe couchée.
C le om e p r o ft ra ta . Linn. 7f Des Antilles. 18. La Mosambe de la Guiane. C le om è g id a n e n f is . Aubl. © De la Guiane.
19. La Mosambe à feuilles étroites.
C le om e a n g u f t i fo lia . Forsk. © De l’Égypte.
20. La Mosambe chelidonière.
C le om e c k e lid o n i i . Linn. Des Indes.
21. La Mosambe chataire.
C le om e f e l in a . Linn. De Ceilan.
•22. La Mosambe jonciforme.
C le om e ju n c e a . Linn. Du Cap de Bonne-Ef-
pérànce.
23. La Mosambe délicate.
C le om e te n e lla . Linn. © Des Indes.
24. La Mosambe digitée.
C le om e d ig i ta ta . Forsk. De l'Arabie.
25: La Mosambe à une feule glande.
C le om e u n ig la h d u lo fa , Cavan. Du Mexique.
C u ltu r e .
La moitié de ces Mofambes font cultivées dans
nos jardins \ favoir : les i cre. , a e. , 3e. 6e. , 7 e. ,
8e. , 9V , i©e. , 12e. , 13e. , 14e. , 15e. Parmi
elles, une feule,.la 13e. , peut fe femeren pleine
terre à une bonne expolition , & .une feule , la
8e. , exige l'orangerie j cètie dernière eft une très-
belle plante, mais elle répand une odeur fort dé-
fagréable. Toutes les autres fe fèment au prin-
tems dans des pots remplis de'terre de bruyère,
mêlée d'un peu de terreau, pots qui fe placent
fur une couche nue , & auxquelles on donne les
arrofemens convenables. Les plants arrivés à trois
ou quatre pouces de haut, fe mettent feul à feul
dans d’autres pots qu'on arrange fur uné 'autre
couche ou contre un mur èxpofé au midi, ou
ils fleuxiffent & amènent leurs graines à maturité.
Pour plus de fécurité , il feroit bon de les fafre
paffer, immédiatement après leur repiquage, uIle
quinzaine de jours fous un châflîs. (Æojc.) *
MOSCAIRE. M oscaria.
Plante annuelle du Chili, qui, félon Perfoon
feule forme un genre dans la fyngénéfie égale &
dans la famille des C h ico ra c ê e s ,* elle n’eft pas cul-
tivée dans nos jardins. { B o s ç . )
MOSCATILLINE. A doxa.
Petite plante vivace, qui croît dans les bois
les buiffons, les haies de toute l'Europe, & nyj
fe fait remarquer par la précocité de fa floraifon
& par l'odeur mufquée qu’elle exhale.
Cette plante, ü o m on voit la figure pi. 320
des I l lu f t r a t io n s d e s genr es de Lamarck, eft de l'oc*
tandrie tétragynie 6c de la famille des Saxifrages,
& ne fe cultive que dans les écoles de botanique ,
où on l ’apporte de la campagnë. On la conferve
en la garanciffant des rayons du foleil, quelle
craint beaucoup, par le moyen d’un telfon de
pot. Elle demande une terre très-légère & fraîche,
fans être cependant humide.
J'aime beaucoup- voir cette plante garnir la
nudité du fol des bofquets dans les jardins payfa*
gers, & je fuis étonné qu'on ne cherche pas plus,
à l'employer à cet ufage. ( B o s c .).
MOSCHAIRE. M o s c u A R r A ,
Plante vivace d?Égypte, dont Forskal a fait
un genre dans la didynamie gymnofpermie &
dans la famille des L a b ié e s . Ôn ne l'a pas encore
introduite dans nos cultures. ( B o s c . )
MOSCOUADË : forte de fucre brut. Voycg
C anne a sucre & Sucre.*
MOTET : nom d'une variété de froment qu’on
cultive beaucoup aux environs de Genève.
MOTTE. On donne ce nom, à Marfeille, à 1«
quantité de fnefures d'olives qui entre dans une
mouture. La Motte varie en maffe dans chaque
moulin.. V o y e i Olive , Huile & Moulin.
MOTTES : morceaux de terre que les labours
ont laiffés dans les champs ou les. jardins.
Ce font les terres où. l'argile domine, celles
qui n'ont pas été labourées depuis Ion g-tems, les-
prairies naturelles ou artificielles qu'on rompt,■
qui font le plus dans le cas d’offrir des Mottes
par fuite de leur Labour. V o y e 1 ce mot.
Il eft des terres qui forment plus de Mottes
quand on les laboure en état de fécherefte, &
d’autres qui en donnent davantage quand on k*
laboure lorfqu’elles font imprégnées d'eau, l-11
général,{ il n'en eft pas deux qui fé. reffemblent
fous ce rapport, foit à la même époque, f°u3
des époques différentes.
! pmfqu’on ne laboure que pour divrfer la terre,
«, Qlie les Mottes ne font point divifees , elles
I ,A nt néceffairement au but du labourage; elles
Tifent encore en recouvrant les femences, parce j
T ’elles empêchent, lorfque ces dernieres germent
la fortie de terre de leur plumule ; ainfi le
cultivateur doit tendre à n’en faire que le moins
ooflible, & à détruire celles qu'il fait. [ |
! v pour produire-peu de Mottes ou de petites Mot-
! tes on choilît le tems le plus favorable au labour,
c’eft-à-dire , l'époque où la terre n'eft ni trop
fèche ni trop mouillée ; on prend avec la charue,
: ©u avec la bêche, une petite épaiffeur de terre a la
fois, on fait plufieurs labours îucceffifs, on crorle
les labours. . .
C'eft principalement parce qu j1 fournit le
| moins de Mottes, que le labour à la houe eft le
meilleur de tous lés labours.
I Un champ ou un carré de jardin couvert de
! Mottes annonce un laboureur ou un Jardinier in-,
fouciant ou peu capable.
Pour écrafer les Mottes, on les frappe avec
tin maillet de bois, appelé de cet ufage C asse-
I Motte (voyq; ce mot), on paffe le rouleau
fimple ou le rouleau armé de dents de fer, ou
| la herfe. V o y e \ Rouleau & Herse. Mais le
meilleur de tous les moyens, & le moins ufité,.
1 c’eft le binage avec une houe à cheval jarmée de
plufieurs fers. V o y e \ Houe a C heval.
Cependant il eft des cas où les Mottes font
utiles à la croiffance des blés : c eft lorfqu elles fe
déchauffent pendant l'hiver & qu elles fe fondent
au printems (voyeçDéchaussement) ^c eft lorf-
I qu’au moyen des abris qu'elles fourniffent , il
croît plus rapidement & brave plus certainement
; les gelées. Voye^ Abri & Gelée. ( Bosc. )
Motte { Lever ou p lant er en ). On lève
I une plante en Motte lorsqu’on laiffe, en 1 arra-
I chant , fuffifamment de terre autour de fes ra-
I cines pour que, remife autre parc, elle conti-
| nue à végéter comme lï elle n’avoit pas changé
[ déplacé,.
Les plantes qui croiffent dans les terres légères
font les feules qu’on ne peut pas toujours lever en
Motte ; cependant on y parvient louvent avec
[ des précautions, après les avoir, au préalable,
I arrofées copieufement. 11 eft des cas où on attend, pour lever en Motte
dans ces fortes de terres , que la gelée y ait pé-
I nétré, & qu’on accélère même cette pénétration
I en creufant fucceffivemint autour de la1 plante un
foffé dont on arrofe le fond pour rendre la glace
I plus conliftante.
L’économie du tems, de la main-d’oeuvre & du
j tranfport s’oppofent feuis à ce que toutes les
I plantes , tous les arbuftes , tous les arbrilfeaux
I & tous les arbres à tranfplanter foienc levés en
Motte j car les avantages de cette pratique font
■ certains fous l#rapport de la reprife & fous celui
I de 1
Parmi les arbres le plus généralement cultivés,
les réfineux font ceux qu’il eft le plus indifoeaia-
ble de lever en Motte. V o y e \ Pin , Sapin , Epicéa
, Genévrier, If , dans le D i c ü o n n a ir e d es
A r b r e s & A r b u fte s . ■
Souvent on fème ou on repique dans les pot&
uniquement pour pouvoir planter en Motte.
G’eft principalement quand les plantes font en
pleine végétation qu’il eft important de les lever
en Motte ; aufl.! les plantes annuelles peuvent-eLes
l’être rarement de l’autre manière avec faccès.
Autrefois les fteuriftes fe fervoient d’un inftru-
ment appelé Manette ( y o y e i ce mot) pour lever
les plantés; mais aujourd’hui on préfère partout
la bêche , qu’il fuffit, en effet, de favoir maniée
pour arriver au but plus promptement 6c plus cer tainement.
Ainfi, pour lever une plante en Motte , on-
donne autour d’ellé , à la diftance convenable r
autant de coups de bêche qu’il eft nécelfaire pour
la cerner, & on la foulève à la fuite du dernier.
V o y e z Lever.
Ainfi, pour lever un arbre, on cerne la terre
autour de lui par un foffé , & lorsqu'on eft arrivé
au-deffous de la plupart des racines , on coupe
celles qui pivotent avec la bêche, & on enleve le
tout avec la main ou autrement.
Quelques heures de pratique en apprendront
plus que tout ce que je pourrois dire de plus; ainfi'
je m'arrête. .
Les arrofemens font moins néceffaires quand
on plante en Motte ; cependant il eft toujours bon
d’en donner un immédiatement après l’opération.
V o y e i , pour le furplus, aux mots Plantation,
T ransplantation-, Rempotage , Rencaissage.
( B o s c . )
MOUCHE : genre d’infe&e qui comprend un
très-grand nombre d’efpèces , plus^de deux cents,
parmi lefquelles il en eft plufieurs qu ileft important
de faire connoïtre aux cultivateurs, a raifon des
fervkes qu'elles leur rendent ou des- dommages
; quelles leur caufent. V o y e [ le D i& io n n a i r e d e s
L t f e â e s i _ ,
Généralement-on applique, dans les campagnes,
le nom de M o u c h e à tous les infeâes à deuï ailes ,
même à ceux à quatre ailes nues : ici je le reftrein*
à ceux à qui Fabricius & Olivier L'appliquent".
Les Mouches proviennentd’oeuFs, d'où foctent
des larves (vers ) alongées, fans patres . ordinairement
coniques, dont là te te , placée au peçjt
bout. eft armée de deux crochets qui leur fervent
à déchirer les viandes ou ïes parties molles des végétaux.
Arrivées à leur dernier degre d àccroifïe—
ment, la- peau de ces larves, qui eft molafte, fe
durcit & devient une coque dans laquelle elles fe
transforment en nymphes dont elies forcent
fous la forme d’infeâes parfaits. 1 '
La plupart des Mouches donnent plufieurs générations
par an, & pondent plufieurs centaines:
d'oeufs à chaque génération.