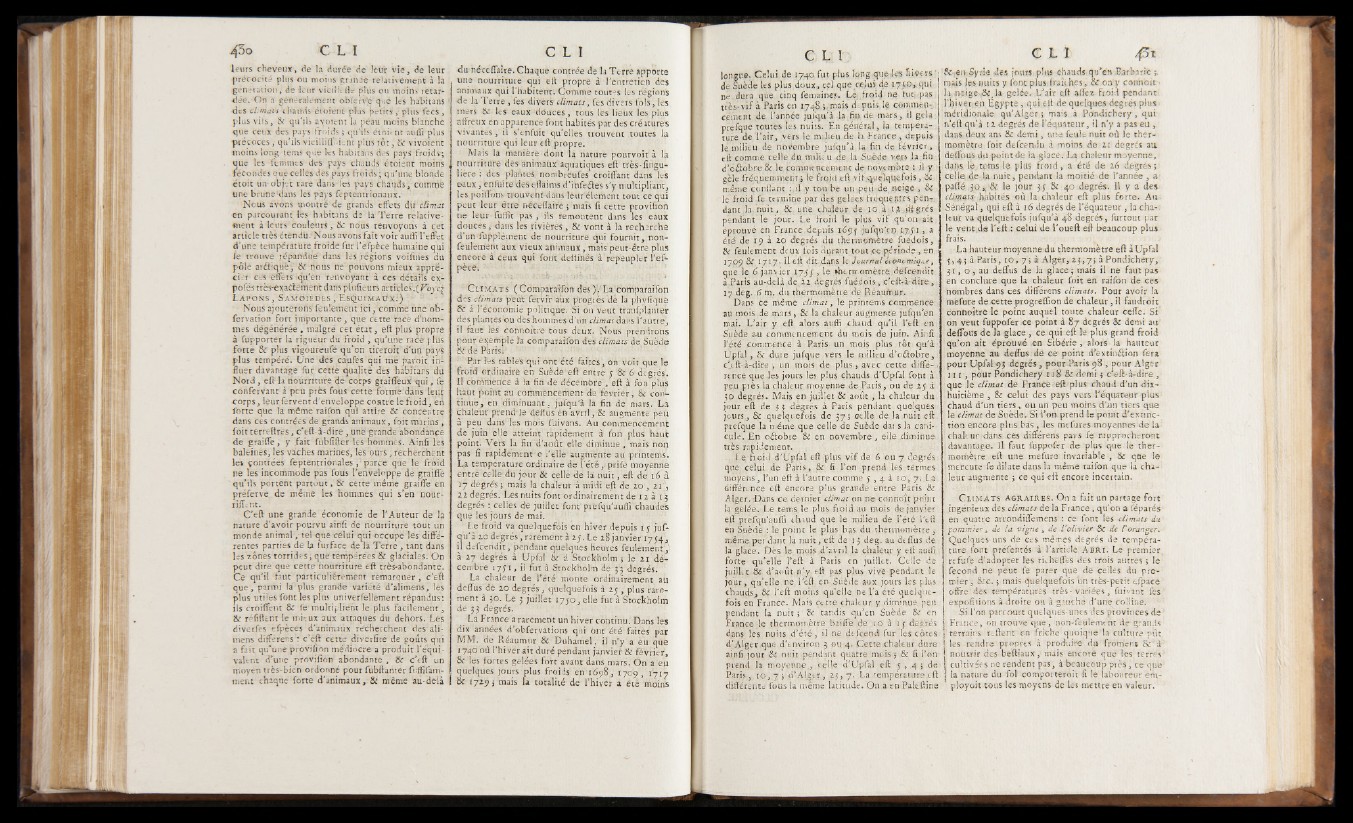
45o C L I
leurs cheveux, de la durée de leur v ie , de leur
■ précocité plus ou moins grande relativement- à la
génération, de leur vieille (le plus ou moins retardée.
On a généralement obfefv'é que les habitans
des cLmavs chauds étoienc plus j)e tir sp lus FecS,
plus v ils , & qu’ils ayoïent la péau moins blanche
•que ceux des pays froids ; qu'ils étoient aiifli plus
précoces , qu’ ils vieilliff-Une plus tôt, & vivotent
moins long tems que les habitans des pays froids;
que les femmes des pays chauds étoient moins
fécondés que celles des pays froids ; qu’une blonde
étoit un- objet rare dans les pays chauds, comme
une brune-dans les pays feptentrionaux.
Nous avons montré de grands effets du climat
en parcourant les habitans de la Terre relativement
à leurs couleurs, tic nous renvoyons à cet
article très-étendu.' Nous avons fait voir au (h l’effet
d’une température froide fur l’ e'fpèce humaine qui
le trouve répandue dans leS régions voifihes du
pôle arétïqüëi & nous ne pouvons mieux apprécier
ces-effets qu’én renvoyant à ces détaris expo
fés très-éxadement dans pltifieurs arti'cle?.(Foyç£
L a po n s , Samoiédes , E sq u im a u x .1) ■ LV
Nous ajouterons feulement ic i, comme une ob-
fervation fort importante, que cette face d’hommes
dégénérée, malgré cet éta t, eft plus propre
à fupporter la rigueur du froid , qu’une racé’ plus
forte & plus vigoureufe qu’on tireroit d’un pays
plus tempéré. Une dés caufes qui nie paroîtinfluer
davantage fur cette qualité dès habrtârs du
Nord, eft la nourriture de corps graiffeuX qui, le
confervant à peu près fous cetté 'Formé:dans leur
corps, leur fervent d’envélopp.e contre le froid, ën
forte que la même raifon qui attire & concentre
dans ces contrées de grands animaux, foit marins ,
foit terreftr.es, c’ eft-à-dire, unë grande abondance
de graiffe, y fait fubfîfter les hommes. Ainfi les
baleines, les vaches marines, les ours, recHërchént
les çontrées feptentrionales , parce que le froid
ne les incommode pas fous l’enveloppe de graiffe
qu’ ils portent partout, tic cette même graiffe en
préferve de même les hommes qui s’ en nour-
riff.nt.
C ’eft une grande économie de l’Auteur de la
nature d’avoir pourvu ainfi de nourriture tout un
monde animal, tel que célui qui occupé les différentes
parties de la fujface de la T e r re , tant dans
les zones torrides; que tempérées & glaciales: On
peut dire que cetre nourriture eft très-abondante.
Ce qu’ il faut particuliérement remarquer, c ’eft
que, parmi la-plus grande variété d’aïimens, lès
plus utiles font les plus univerfellement répandus:
ils croiffent & fe‘multiplient le plus facilement,
& rëfiftent le mi-ux aux attaques du dehors. Les
diverfes efpèces d'animaux recherchent des a!i-
mens différens: c ’èft cette divërfité de goûts qui
a fait qu’ une provifion médiocre a produit l’équivalent
d’une provifion abondante , tic c’eft un
moyen très-bien ordonné pour fubftanter fuffifam-
ment chaque forte d’ animaux, & même au-delà
c L i
du néceffarre. Chaque contrée de h Terre apporte
une nourriture qui eft propre à l’entretien des
animaux qui l’habitent. Comme toutes les régions
i de la T erre, fes divers climats', fes divers lois, les
mers tic les eaux douces, tous les lieux les plus
affreux en apparence font habités par des créatures
vivantes, il s’enfuit qu’elles trouvent toutes la
nourriture qui leur eft propre.
Mais la manière dont la nature pourvoit à la
, nourriture dès1 animaux aquatiques eft très-fingu-
lière : des plaines, nombréufes croiffant dans .les
eaux, enfuite des eflaims d’ infeétes s'y multipliant,
les poilîons trouvent -dans leiirélemen c tout cé qui
peut leur être néceflairé ; maïs fi cette provifion
ne leur fuffit pas , ils remontent dans les eaux
douces,- dans les rivièrès , & vont à la recherche
d’un fiipp 1 ément de nourriture qui fournit, non-
feulement aux vieux animaux, mais peut-être plus
: encore à ceux qui font deftinës à repeupler l’eft-
i pècê.
| C l im a ts (Cômparaïfôn des)/La comparaifon
des climats peut fervfr aux progrès dé la phvfiqüé
& à l’économie politique. Si ou veut tranfplanter
des plantes ou dès hommes d’un climat dans l’autre,
il faut les connoître tous deux. Nous prendrons
pour exemple la comparaifon des climats de Suède
dèdeParisi'
Parlas râbles qui ont été faîtes, on voit que le
froid ordinaire en Suèdè'eft entre y !8é 6 degrés.
Il commence à la fin de décembre , eft à fon plus
hatit point au commencement de février, tic continue,
en diminuant, jufqu’à la fin de mars. La
chaleur prend'le deffus èn avril, tic augmente peu
à peu dans les mois fui vans. Au commencement
de juin elle atteint rapidement à fon plus haut
point. Vers la fin d’août elle diminue, mais non
: pas fi rapidement-o felle augftiénte au printems.
L:a température ordinaire de l'é té , prifè moyenne
entre celle'du jour tic celle de la nuit, eft de 16 à
17 degrés ; mais la chaleur ;à midi eft de 20, 21 ,
22 degrés. Les nuits font ordinairement de 12 à 13
degrés : celles de juillet font pièfqu’aufli chaudes
que les jours de mai.
Le froid va quelquefois en hiver depuis ic juf*
qu’à 20 degrés, rarement à 25. Le 28 janvier 1754,
il defeendit, pendant quelques heures feulement y
à 27 degrés à Upfal tic à Stockholm ; le 21 décembre
17 5 1, il fut à Stockholm de 33 degrés.
1 La chaleur de Pété monte ordinairement aù
deffus dè 20 degrés, quelquefois à 2y , plus rarement
à 30. Le 3 juillet 17J0, elle fut à Stockholm
de 33 degrés.
La France a rarement un hiver continu. Dans les
dix années d’obfervations qui ont été faites par
MM. de Réaumur tic Duhamel, il n’y a eu que
1740 ou l’hiver ait duré pendant janvier & février,
tic les fortes gelées fort avant dans mars. On a.eu
quelques jours plus froids en 1698, 1709 , 1717
l tic 1729; mais la totalité de l’hiver a été moilfc
c l 1
longue* Celui de 1740 fut plus lqngxpie.les Bi^ei s ' ;
de Suède les p)us doux, tel que celui de i7yo-,,qui
né dura que cinq femaine*. Lé],froid ne fut!pas
très-vif à Paris en 1748.;, mais de puis, le çoinmen-,
cément de l’année jufqu’à -la fin, de mars, il gela
prefque toutes les nuits. En général, la tempéra- ,
ture de Pair, vers le milieu de la France, depuis
lé milieu de novembre jufqu’ à la, fin de février.,
eft comme telle du milieu ,de;la Suède. v.e,rs la fin ,
d’oélobre &, le commencemen-t de noyt ijvbre. î il y
gèle fréquemment ; l é froid eftjvif.Quelquefois, .tic.
même çonftant : ,il :y ton be un,p§ii de< neige , tic
le froid fe termine par des gelées fréquepîès pèn-,
dant la nuit, & une chaleur de io.à-igoftf grés
pendant le jour. Le froid le plus v if qu’on^ait
éprouvé en France,depuis 169 y jufqu’en tyy 1., a .
été de 19 à 20 degrés du thermomètre fuedois,
tic feulement deux fois «iurarn tout oe,période, en
I7P9 & 171,7. Il eft dit dans 1t Journal économique,
que le 6 janvier 17-35 » Ie rive rrr.om être. defeendit
à Paris au-delà dev22 degrés fuédois, eft-à-dire,
17 deg. 6 m. du thermomètre de Réaumur*
Dans ce même climat, le printems commence
au mois de mars, tic la chaleur augmenté jufqu’en
mai. L’air y eft alors auflï chaud qu’ il l’eft en
Suède au commencement du mois de juin. Ainfi
Pété commence à Paris un mois plus tôt qu’à
Upfal, tic dure jufque vers le milieu d’oéfobre, :
c\ ft-à-dire , un mois de plus, avec cette diffé-.
rtnee que les jours les plus chauds d’Upfal font à
peu pi ès la chàleur moyenne de Paris, ou de 25 à
30 degrés. Mais en juillet & a o û t, la chaleur du
jour eft de 33 degrés à Paris pendant quelques
jours., & quelquefois de 37; celle de la nuit eft
prefque la même que celle de Suède dat s la canicule.
En octobre tic en novembre, elle .diminue
très rapidement.
1 e fioid d’Upfal eft plus v if de 6 ou 7 degrés
que, celui de Palis, tic fi l’on prend les termes
moyens', l’ un eft à l’autre comme y , 4 à io’^ 7; La
différence eft encore plus grande entre Paris tic
Alger. Dans ce dernier climat on ne connoît point
la gelée. Le tems. le plus fi oid au mois de janvier
eft pre,fqu’aufîi thiud que le milieu de l’été l'cft
en Suède : le point le plus bas du thermomètre y
même,per dant la nuit, eft de 13 deg. au deffus de
la glace. Dès le mois d ’avril la chaleur y eft suffi
forte qu’elle Pèft à Paris en juillet. Celle de
juillet tic d’août n’y. eft pas plus vive pendant le
jour, qu’elle ne l’eft. en .Suède aux jours les plus
chauds, tic Pefl: moins qu’elle ne l ’a été quelquefois
en France. Mais cetre chaleur y diminue, peu
pendant la nuit ; tic tandis qu’en Suède tic en
France le thermomètre baiffe de .)id à 15 degrés
dans les nuits d’ é té , il ne dcfc.end fur les côtes
d’Alger que d’environ 3. ou 4. Cette chaleur dure
ainfi jour tic nuit pendant quatre mois ; tic fi l’ on
prend la moyenne., celle d’Upfal eft y , 4 ; de
Paris, 1 0 ,7 ; d’Alger, 23, 7. La température,eft
différente fous la même latitude. On a en Paltftine
C L I 431
& ren Syrie des jours, plus chauds qu’en Barbarie ^
mais les nuits y font plus fraîches, & on y connoît
la n e i g e . l a gelée. L’ air eft affez froid pendant
Phi ver;en Égypte, qui eft de quelques degrés plus
méridionale qu’Alger.; mais à Pondichéry , qui
n’eft qu’à 12 degrés de l’équateur, il n’ y a pas eu ,
dans deux ans tic demi, une feule nuit où le thermomètre
foit defcen.du à moins de 21 degrés au.
dqffous du point de la glace. La chaleur moyenne,
dans le. tems le plus froid , a été de 26 degrés ;
celle4e .fa nuit, pendant la moitié de l’ année, a
paffé ,30,; & le jour yy tic 40 degrés. Il y a des
1 climats-^ habités où la chaleur eft plus forte. Au
Sénégal, qui eft à 16 degrés de l’équateur, la cha-.
leur va quelquefois jufqu’à 48 degrés, furtout par
le vent.d.e l’eff : celui de l’ouefl eft beaucoup plus
frais.
La hauteur moyenne du thermomètre eft à Upfal
f , 4 ; à Paris, 10, 753 Alger, 2L$>7> à Pondichéry,
3 1 , o 3 au deffus de la glace ; mais il ne faut pas
en conclure que la chaleur foit en raifon de ces
nombres dans ces différens climats. Pour avoir la
mëfure de cette progreflïon de chaleur , il faudroit
connoître le point auquel toute chaleur ceffe. Si
on veut fuppofer x e point à 87 degrés tic demi au
deffous de la glace , ce qui eft le plus grand froid
qu’on ait éprouvé en Sibérie, alors la hauteur
; moyenne au deffus dé ce point d’extinétion fera
pour Upfal‘93 degrés, pour-Paris 98 , pour Alger
n i , pour Pondichéry 118 tic demi ; c’eft-à-dire ,
que le climat de France eft plus chaud d’un dix-
huitième, tic celui des pays vers l’équateur plus
chaud d’un tiers, ou un peu moins d’am tiers que
le climat de .Suède«. Si l’on prend le point d'extinction
encore plus bas, les me fuies moyennes de la
chaleur dans, ces différens pays fe rapprocheront
davantage. Il faut fuppofer de plus que le thermomètre
eft une mefure invariable , tic qûe le
. mercure fe dilate dans la même raifon que la chaleur
augmente j ce qui eft encore incertain.
C limats agraires. On a fait un partage fort
ingénieux des climats-de la France, qu’on a féparés
en quatre arrondiffemens ce font les climats du
pommier, de la vigne , de Volivier tic de l'oranger.
Quelques uns de ces mêmes degrés de température.
font préfentés à l’article A bri. Le premier,
refufe d’adopter les richeffes des trois autres ; le
: fécond ne peut fe parer que de celles du premier
, ticc. ; mais quelquefois un très-petit efpace
offre'des températures très-variées, fujvant fes
expo fi rions à droite ou à gauche d’ une colline. 1
Si l’on parcourt quelques-unes des provinces de
France, on trouve que, non-feulement de gran.is
terrains relient en friche quoique la culture pût
les rendre propres à produire du froment & ' à
nourrir des beftiaux, mais encore que les terres
cultivées ne rendent pas, à beaucoup près, ce que
la nature du fol comporteroit fi le laboureur employait
tous les moyens de les mettre en valeur.