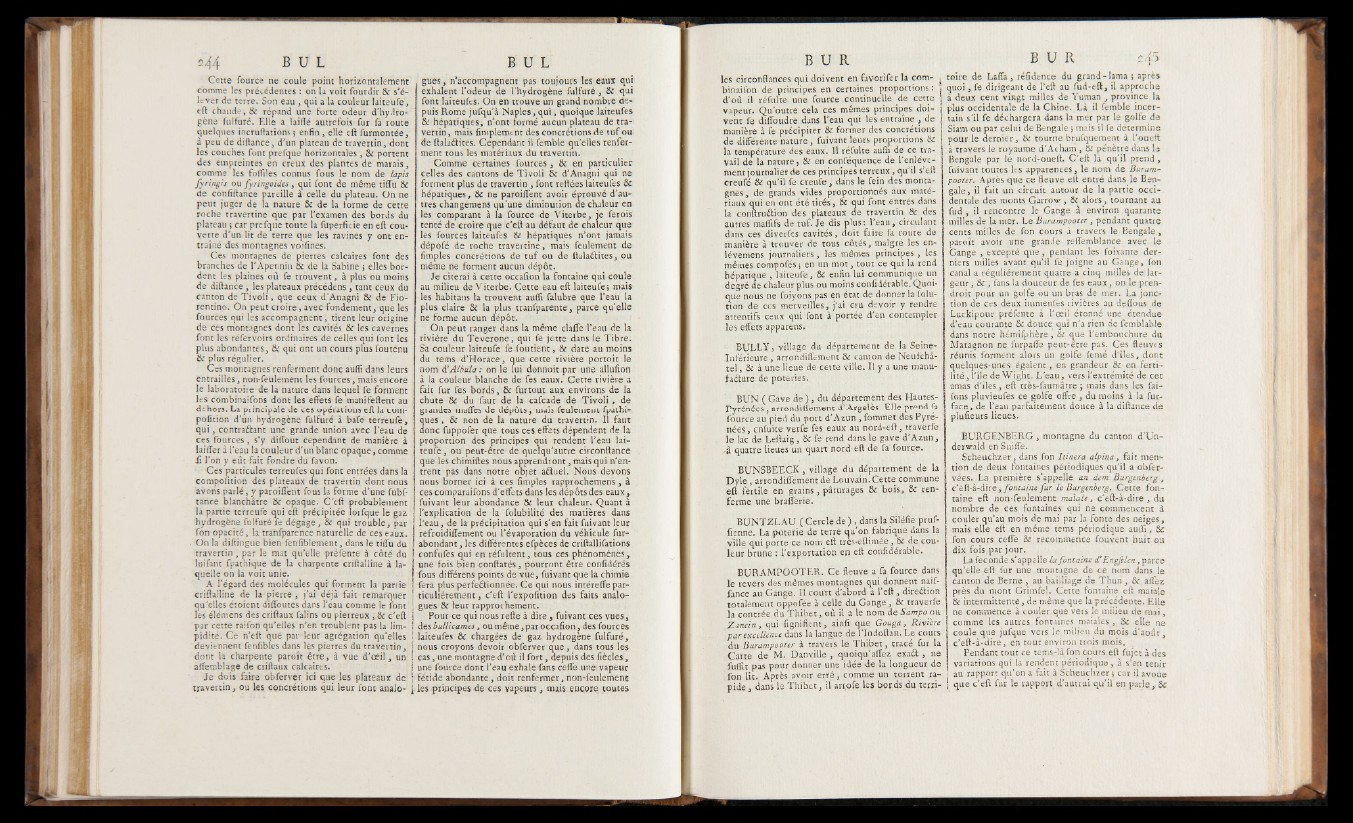
C e tte fource ne coule point horizontalement
comme les précédentes : on la vo it fourdir & s 'éle
v e r de terre. Son e a u , qui a la couleur la iteu fe ,
eft chaude, & répand une forte odeur d'hyd rog
ène fulfuré. Elle a laiflé autrefois fur fa route
quelques incruftations5 en fin , elle eft furmontée,
à peu de diftance, d’ un plateau de tra vertin, dont
les couches font prefque ho r izon ta le s, & portent
des empreintes en creux des plantes de marais,
comme les foflîles connus fous le nom de lapis
fyringis ou fyringoidcs, qui font de même tiffu &
de confiftance pareille à celle du plateau. On ne
peu t juger de ia nature & de la forme de ce tte
ro ch e travertine que par l’examen des bords du
plateau j car prefque toute la fuperficie en eft cou ve
r te d ’ un lit de terre que les ravines y ont entraîné
des montagnes voifines.
Ce s montagnes de pierres calcaires font des
branches de l’ Apennin & de la Sabine > elles bordent
les plaines où fe t ro u v en t , à plus ou moins
de diftance, les plateaux précéd en s , tant ceux du
canton de T i v o l i , que ceux d ’Anagni & de F io -
rentino. On peut c ro ire , avec fon dement, que les
fources qui les accompagnent, tirent leur origine
de ces montagnes dont les cavités & les cavernes
font les réfervoirs ordinaires de célles qui font les
plus abondantes, & qui ont un cours plus foutenu
& plus régulier.
C e s montagnes renferment donc auffi dans leurs
entrailles, non-feulement les fou rce s , mais encore
le laboratoire de la nature dans lequel fe forment
les combinaifons dont les effets fe manifeftent au
dehors. La principale de ces opérations eft la com-
pofition d ’un hydrogène fulfuré à b afe te r reu fe ,
q u i , contrariant une.grande union avec l ’eau de
ce s fou r c e s , s’y diffout cependant de manière à
laiffer à l’eau la cou leur d’ un blanc opaqu e, comme
i î l’on y eût fait fondre du favon.
C e s particules terreufes qui font entrées dans la
compofition des plateaux de travertin dont nous
avons pa rlé, y paroiffent fous la forme d’ une fubf-
tance blanchâtre & opaque. C 'e ft probablement
la partie terreufe qui eft précipitée lorfque le gaz
hydrogène fulfuré fe d é g a g e , & qui t ro u b le , par
fon o p a c ité , la tranfparence naturelle de ces eaux.
On la diftingue bien fenfiblement, dans le tiffu du
travertin y par le mat qu’elle préfente à cô té du
luifant fpathique de la charpente criftalline à laquelle
on la v o it unie.
A l’égard des molécules q ui forment la partie
criftalline de la p ie r r e , j’ ai déjà fait remarquer
qu'elles étoient diffoutes dans l’eau comme le font
les élémens des criftaux falins ou pie r reu x, & c’ eft
par cette raifon qu’ elles n’en troublent pas la limpid
ité. C e n’eft que par leur agrégation qu’elles
deviennent fenfibles dans les pierres du tra v e r tin ,
dont la charpente paroît ê t r e , à vu e d’oe i l , un
affembîage de criftaux calcaires.
Je dois faire ob fe rve r ici que les plateaux de
t ra v e r tin , ou les concrétions qui leu r font analog
u é s , n’accompagnent pas toujours les eaux qui
exhalent l’odeur de l'hydrogène fu lfu r é , & qui
font laiteufes. On en trou ve un grand nombre depuis
Rome ju fqu ’à N aples , q u i , quoique laiteufes
&: hépatiques, n’ ont formé aucun plateau de trav
e r tin , mais Amplement des concrétions de tu f ou
de ftalaélites. Cependant il femble q u e lle s renferment
tous les matériaux du travertin.
Comme certaines fo u r c e s , & en particulier
celles des cantons de T iv o li & d’Anagni qui ne
forment plus de t ra v e r tin , font reftées laiteufes &
hépatiques, & ne paroiffent avoir éprouvé d’autres
changemens qu’une diminution de chaleur en
les comparant à la fource de V ite rb e , je ferois
tenté de croire que c’ eft au défaut de chaleur que
les fources laiteufes & hépatiques n’ ont jamais
dépofé de roche tra v e r tin e , mais feulement de
(impies concrétions de tu f ou de ftaladfites, ou
même ne forment aucun dépôt.
Je citerai à ce tte occafion la fontaine qui cou le
au milieu de V ite rb e . C e tte eau eft laiteufe} mais
les habitans la trouvent auffi falubre que l’eau la
plus claire & la plus tranfparente', parce qu’ elle
ne forme aucun dépôt.
On peut ranger dans la même claffe l’èau de la
rivière du T e v e r o n e , qui fe je tte dans le T ib re .
Sa couleur laiteufe fe S o u tien t , & date au moins
du tems d’H o ra c e , que ce tte rivière portoit le
nom d'Albula: on le lui donnoit par une allulion
à la couleur blanche de fes eaux. C e tte rivière a
fait fur fes b o rd s , & furtout aux environs de la
chute & du faut de la cafcade de T i v o l i , de
grandes maffes de d é p ô ts , mais feulement fpathi-
q u e s , & non de la nature du travertin. Il faut
donc fuppofer que tous ces effets dépendent de la
proportion des principes qui rendent l’ eau lai—
t e u fë , ou peut-être de quelqu’ autre circonftance
que les chimiftes nous apprendront, mais qui n’entrent
pas dans notre o bjet aéfcuel. Nous devons
nous borner ic i à ces (impies rapprochemens, à
ces comparaifons d’effets dans les dépôts dès e a u x ,
fuivant leur abondance & leur chaleur. Quant à
l’explication de la folu b ilité des matières dans
l ’e a u , de la précipitation qui s’en fait fuivant leur
refroidiffement ou l’évaporation du véhicule fur-
abondant, les différentes efpèces de criftallifations
confufes qui en ré fu lten t, tous ces phénomènes,
une fois bien confta tés, pourront être confidérés
fous différens points de v u e , fuivant que la chimie
fera plus perfeétionnée. C e qui nous intéreffe particuliérement
, c’ eft l’expofition des faits analogues
& leur rapprochement.
Pour ce qui nous refte à d i r e , fuivant ces vu e s ,
des bullicames, ou m ême, par occafion , des fources
laiteufes & chargées de gaz hydrogène fu lfu ré ,
nous croyons devoir obferver q u e , dans tous les
c a s , une montagne d ’ où il fo r t , depuis des fiècles ,
une fource dont l’eau exhale fans ceffe une vapeur
fé tid e abondante, doit renfermer, non-feulement
les principes de ces vapeurs , mais encore toutes
les circonftances qui doivent en favorifer la corn- >
binaifon de principes en certaines proportions : j
d ’ où il réfulte une fource continuelle de ce tte j
vapeur. Q u ’outre cela ces mêmes principes d o iv
en t fe diffoudre dans l’eau qui les entraîne , de
manière à fe précipiter & former des concrétions
de différence n a tu re , fuivant leurs proportions &
la température des eaux. Il réfulte auffi de c e travail
de la na tu re , & en conféquence de l’ enlèvement
journalier de ces principes te r reu x, qu’ il s’eft
creufé & qu’ il fe c r e u fe , dans le fein des montagnes
, de grands vides proportionnés aux matériaux
qui en ont é té t ir é s , & qui font entrés dans
la conftruétion des plateaux de travertin & des
autres maffifs de tuf. Je dis plus: l’e a u , circulant
dans ces diverfes c a v i té s , do it faire fa route de
manière à trouver de tous c ô té s , malgré les en-
lévemens jou rnaliers, les mêmes p r in c ip e s , les
mêmes comp ofés , en un m o t , tou t ce qui la rend
hépatique , la iteu fe , & enfin lui communique un
degré de chaleur plus ou moins confidérable. Q u o ique
nous ne foiyons pas en état de donner la (olu-
tion de ces merveilles, j’ai cru devoir y rendre
attentifs ceux qui font à portée d’en contempler
les effets apparens.
B U L L Y , village du département de la Seine-
Inférieure , arrondiffement & canton de Neufchâ-
t e l , & à une lieue de ce tte ville . Il y a une manufacture
de poteries.
BU N ( Gave de ) , du département des Hautes-
Pyrénées , arrondiffement d’Argelès. Elle prend fa
fou rce au pied du port d’Azun , fommet des P yré - ;
n é e s , cnfuite v erfe fes eaux au nord-eft, traverfe
le lac de L e fta ig , & fe rend dans le gave d ’A z u n ,
quatre lieues un quart nord eft de fa fource.
B U N S B E E C K , village du département de la
D y l e , arrondiffement de L o u v a in .C e tte commune
eft fertile en g ra in s , pâturages & b o is , & renferme
une brafferie.
B U N T Z L A U (C e r c le d e ) , dansla Siléfie pruf-
fienne. La poterie de terre qu’ on fabrique dans la
v ille qui porte ce nom eft tres-eftimée, & de cou leur
brune : l’exportation en eft confidérable.
B U R AM P O O T E R . C e fleuve a fa fource dans
le revers des mêmes montagnes qui donnent n a if-.
fance au Gange. Il cou rt d’abord à l’ e f t , direction
totalement oppofée à ce lle du G a n g e , & traverfe
la contrée du T h ib e t , où il a le nom de Sampo ou
Zancin, qui lign ifien t, ainfi que Gouga, Rivière
par excellence dans la langue de l’Indoftan. L e cours
du Burampooter à travers le T h ib e t , tracé fur la
Ca r te de M. Danville , quoiqu ’affez e x aC t, ne
fuffit pas pour donner une idée de la longueur de
fon lit. Après avoir e r r é , commè un torrent rapide
, dans le T h ib e t , il arrofe les b ords du territoire
de L a ffa , réfidence du grand-lama ; après
q u o i , fe dirigeant de l’eft au fu d -e ft, il approche
à deux cent vin g t milles de Yuman , province la
plus occidenta le de la Chine. Là il femble incertain
s ’il fe déchargera dans la mer par le g o lfe de
Siam ou par celu i de Bengale 5 mais il fe détermine
pour le d e rn ier, & tourne brufquement à l’oueft
à travers le royaume d ’A ch am , & pénètre dans la
Bengale par le nord-oueft. Ç ’eft là qu’ il p ren d ,
fuivant toutes les apparences , le nom de Burampooter.
Après que ce fleuve eft entré dans le Beng
a le , il fait un circu it autour de la partie o c c identale
des monts G a r row , & a lo r s, tournant au
fu d , il rencontre le Gange à environ quarante
milles de la mer. Le Burampooter , pendant quatre
cents milles de fon cours à travers le B en g ale ,
paroît avoir une grande reffemblance a v ec le
Gange , ex cepté q u e , pendant les foixante derniers
milles avant qu’ il fe joigne au G an g e , fon
canal a régulièrement quatre à cinq milles de lar-
I g e u r , & T fa n s la douceur de fes e a u x , on le pren-
droit pour un golfe ou un bras de mer. La jonc-
| tion de ces deux immenfes rivières au deffous de
Luckipour préfente à l’oe il étonné une étendue
d’eau courante & douce qui n’ a rien de femblable
dans notre h émifp h ère, & que l’ embouchure du
Maragnon ne furpaffe peut-être pas. C e s fleuves
réunis forment alors un g o lfe Cerné d’î le s , dont
quelques-unes é g a le n t , en grandeur & en fertil
i t é , t’ île de W igh t . L ’ea u , vers l’extrémité de ce t
amas d’î le s , eft très-faumâtre ; mais dans les fai—
Tons pluvieufes ce g o lfe o f f r e , du moins à la fur-
face , de l’eau parfaitement douce à la diftance de
plufieurs lieues.
B U R G E N B E R G , montagne du canton d’U n -
derwald en Suiffe.
S ch eu ch z e r , dans fon Itinera alpina, fait mention
de deux fontaines périodiques qu’ il a obfer-
vées. La première s’ appelle an dem Burgenberg,
c’èft-à-dire, fontaine fur le Burgenberg. C e t te fon taine
eft non-feulement maiale, c’ eft-à-dire , du
nombre de ces fontaines qui ne commencent à
cou le r qu’ au mois de mai par la fon te des n e ig e s ,
mais elle eft en même tems périodique au ffi, &
fon cours ceffe & recommence fou ven t hu it ou
dix fois par jour.
La fécondé s’ appelle la fontaine <£ Engftlcn, parce
qu’elle eft fur une montagne de ce nom dans le
canton de Berne , au bailliage de T h u n , & affez
près du mont Grimfe). C e tte fontaine eft maiale
& intermittente, de même que la précédente. E lle
ne commence à couler que vers le milieu de m a i,
comme les autres fontaines maiales , & elle ne
cou le que jufque vers le milieu du mois d’a o û t ,
c’ e ft-à -d ire , en tout environ trois mois.
Pendant tout ce te ms-là fon cours eft fujet à des
variations qui la rendent p é r io d iq u e , à s’en tenir
! au rapport qu’on a fait à Scheuchzer ; car il avoue
} q u e c ’ eft fur le rapport d’ autrui qu’ il en p a r le , &