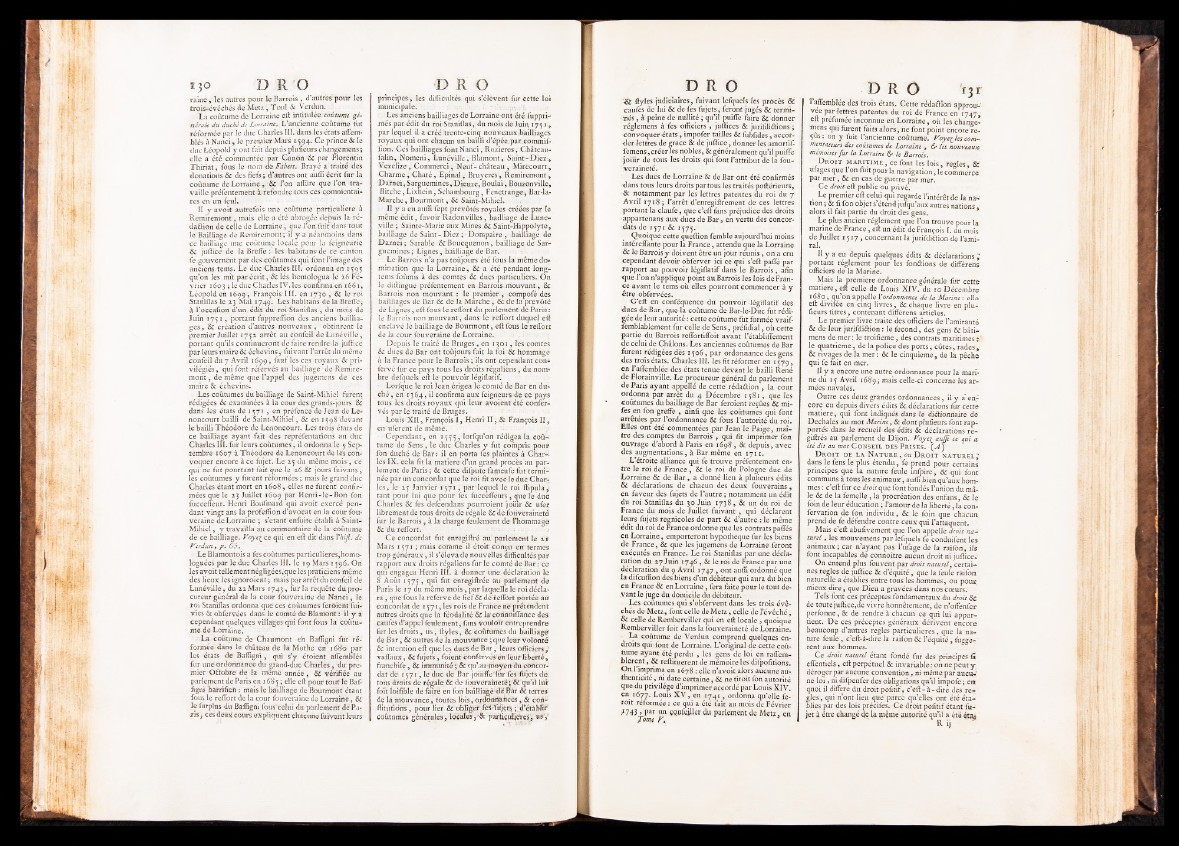
raine, les autres pour le Barrois, d’autres pour les
irois-évêchés de Metz, Toul & Verdun. ;
La coutume de Lorraine eft mtmlée coâtume générale
du duché de Lorraine. L’ancienne, coutume fut
réformée par le duc Charles NI. dans les états aftëm-
blés à Nanci, le premier Mars L594. Ce prince & le
<luc Léopold y ont fait depuis plufieurs changenlens ;
elle a été commentée'par Canon & par Florentin
Thiriat, fous le nom dè Fàbtrt. Brayé a traité des
donations 8c des fiefs ; d’autres ont aufliëcrit lûr la
•coûtume de L o r r a in e & l’on allure -que l’on travaille
pré lentement ià-'fefondre tous cés comnientai-
res en un feul.
Il y a voit: autrefois une coutume particulière à
Remiremont, mais elle a été abrogée depuis la ré-
daftion de celle de Lorraine, que l’on fuit-dans tout
le Bailliage de Remireiuont ; -il y a néanmoins dans
ce bailliage une coutume locale pour la fêignèUrie
& julliee de la Brefîe ; les habita ns* de ce canton
fe gouvernent par des coutumes:qui font l’image des
anciens-tems. Le dûc-Charles III. ordonna en 1595
qu’on les mît par écrit, 8c lés homologua le 26 Février
1603 ; le duc Charles IV. les confirma en 1661 ,
Léopold en 1699', François III. en 1730 , & le roi
Staniflas le .23 Mai 1749. Les habitans de la Breflèj
à i’occafion d’un édit du roi Staniflas , du mois de
Juin 17 5 1 , portant luppreffion des anciens bailliag
e s , & création d’antres nouveaux , obtinrent le
premier Juillet 1751 arrêt au confeil dé Lunéville,
portant qu’ils continueront défaire rendre la juftice
par leurs maire 8c échevins ^ fuivant l’arrêt du même
confeil du 7 Avril 1699, fauf les cas royaux & privilégiés
, qui font réfervés au bailliage dé Remire-
mont , de même que l’appel des jugêmens de ces
maire & échevins.
Les coutumes du bailliage de Saint-Mihiel furent
rédigées & examinées à la cour des grands-jours 8c
dans les états de 1571 , en préfence de Jean deLe-
noncourt bailli de Saint-Mihiel, 8c en 1598 devant
le bailli Théodore de Lenoncoürt. Les trois états de
ce bailliage ayant fait des repréfentatlons au due
Charles III. fur leurs coûtumes, il ordonna le y Septembre
1607 à Théodore de Lenoncoürt de lés convoquer
encore à ee fujet. Le 25 du même mois-, ce
qui ne fut pourtant fait que-le 26 8C jours fuivans,
les coûtumes y furent réformées ; mais lé grand duc
Charles étant mort en 1608,-elles ne furent-cbnfir-
méesquele 23 Juillet-1-609 par Henri-le-Bon fon
fucceffeur. Henri Boufmard qui avoit exercé pendant
vingt ans la profeffiôn d’avocat en la cour fou-
veraine de Lorraine ; s’etant enfuite établi à Saint-
Mihiel , y travailla au commentaire de la coutume
de ce bailliage. Voye^ ce qui en eft dit dans Vhifi. de
Verdun, p. 65.
Le Blamôtftois a fes coûtumes particulières,homologuées
par le duc Charles III. le 19 Mars 1596. On
les avoit tellement négligées,que les praticiens même
des lieux les ignoroient ; mais par arrêt du confeil de
Lunéville, du 22 Mars 1743, fur la requête du procureur
général de la cour foùveraine de Nanci , le
roi Staniflas ordonna que ces coûtumes ferOïént fui-
vies & obfervées dans le comté de B lam o n t il y a
cependant quelques Villâ'gës- qüî font fous la coûtu-
me de Lorraine.
La coutume de Chaumont eh Bàflighi fût réformée
dans le château de là Mothe en 1680 par
les états de Baffigni, qui s’y étoient àffçmblés
fur une ordonnance du grand-duc Charles , : du premier
O&obte de la même' année , & vérifiée au
parlement de Paris en 168 5 ; elle eft pour fout le Baf-
figni barrifien : mais le bailliage de Bourmont étant
fous le reffort de la cour foùveraine de Lorraine, &
le furplus dû Baffigni foüs celui du parlement dë Par
xisj ces deux cours expliquent chacune furvaiit leurs
principes, les difficultés, qui s’élèvent fur cette loi
municipale,’ . I
Les anciens bailliages de- Lorraine .ont été fuppri-
,més pat édit du rorStaniflas, du mois de Juin,. 175 1 ,
par lequel il a créé ’trente-cinq nouveaux ibàilliag es
royaux qui ont chacun un bailli d’ëpée.par.commif-
fion. Ces bailliages font Nanci, Rozieros, Château-
falin, Nomeni, Lunéville, Blamont, Saint-Diez,,
Vezelize, Commerci;, Neuf-château , Mirècoiirt,
Charme:, Chaté, Epinal, Bruyères, Remiremont-,
Dariiei, Sarguemines, Dieuze, Boulai, Bouzonville,
Bitche, Lixhein, Schambourg, Fenetrange-, Bar-la-
Marche, Bourmont, 8t Saint-Mihiel, 1 H
Il y'a eu auffifept prévôtés royales créées par le
même éd it, favoir Radonvilles, bailliage de Lune-
ville ; Sainte-Marie aux Mines & Saintr-Hippolyte,
bailliage de Saint - Diez ;• Dompaire 3 bailliage de
Darnei ; Sarable &Boucquenon, bailliage de Sarguemines;
Lignes , bailliage de Bar.
Le Barrois n’a pas toûjours été fous-la même do*
mination que la Lorraine, .8c a été pendant long-
tems foûmis à des comtes 8c ducs particuliers. On
le diftingue préfentement en Barrois. mouvant, 8c
Barrois non mouvant : le premier. , compofé des
bailliages de Bar & de la Marche, 8c de la prévôté
de Lignes, eft fous le reffort du parlement de Paris :
le Barrois non mouvant, dans le reffort duquel eft
enclavé lé bailliage de Bourmont, eft fous le reffort
de la cour foùveraine de Lorraine.
Depuis le traité de Bruges, en 1301, lés comtes
& ducs de Bar ont toûjours fait la foi 8c hommage
•à la France pour le Barrois ; ils ont cependant con-
fervé fur ce pays tous les droits régaliens, du nom?
bre defquels eft le pouvoir légiflatif.
- Lorfque le roi Jean érigea le comté de Bar en du?
ché , en 1-364, il confirma aux feigneurs de ee pays
tous les droits royaux qui leur avoient été confer-
vés par-le traité de Bruges.
Louis X II, François I , Henri I I , & Fra'nçois II,
en nferent de même.
- Cependant, en 1 , lorfqu’on rédigea la coutume
de Sens, le duc Charles y fut compris pouf
fon duché de Bar : il en porta fes plaintes à Char~
les IX. cela fit la matière d’un grand procès au paN
lement de Paris; & cette difpute fameufe-fut termi->
née par un concordat que le roi fit avéc le duc Charles,
le 25 Janvier 15 7 1 , par lequel le roi ftipula^
tant pour lui que pour fes fuccëfîeuts, que le duc
Charles 8c fès defeendans pourroient jouir 8c ufei*
librement de tous droits de régale 8c de foliVeraineté
fur le Barrois, à'ia-charge feulement dè l’hommagô
8c du reffort. - ; ... .
Ce concordat fut enrègiftré au parlement le i r
Mars 1571 ; mais comme il étoit' conçit e'rï termes
trop généraux, il s’éleva de nouvelles difficultés par
rapport aux droits régaliens fur le comté de Bar : ce
qui engagea Henri III. à donner une déclaration le
8 Août 1575, qui fut enfegiftrée ato pàflènYent dé
Paris le 17 du mêrtie mois-, par laquelle le roi déclara
, que fous la rèferve de fief & de:îéffOrt portée au
concordat de 1571, les rois de France ne prétendent
autres droits que là féodalité 8c la'corinoiffânce des
caüfesd’âppel feulement ,fanS yoüioif Chtreprendre
furies droits, us, ftÿles, 8c coûtutfiés du bailliage?
de Bar, & autres de la mouvance ; que leûf Volônfé
8c intention eft que les ducs de Bar ,■ leurs officiers
vaffaux, & fujers, foienf côftfèrvéS-'èn’lëitfliberté,
franchife, 8c immunité ;' & qu’au moyeh du concordat
de 1.571, lë duc de Bar joniffeTuf’feS fil jets de.
tous droits de régale & dé fpiivërâihét'é ; 8t qu’il liir
foft loifible de faire en fon baiHiagë dë Bàr « terres
de là. mouvance,‘ toutes 10i$ ,.ordOrrtiâncès& coû*
ftitufidns , pour lier & obliger ,fëS:-fûjetS ; d’étàbli^
coûtâmes générales, locales-,% particulières^ usy
■ St ftyles judiciaires, fuivant lefquels les procès &
caufes de lui 8ç de fes fujets,- feront jugés & termin
é s , à peiné de nullité ; qu’il puiffe faire & donner
réglemens à fes officiers , juftices & jurifdiétions ;
convoquer états, impofer tailles & fubfides, accorder
lettres de grâce & de juftice, donner les amortif-
femens', créer les nobles, & généralement qu’il puiffe
joiiir de tous les droits qui font l’attribut de la fou-
yeraineté.
Les ducs de Lorraine & de Bar ont été confirmés
•dans tous leurs droits par tous les traités poftérieurs,
& notamment par les lettres patentes du roi du 7
Avril 17 18 ; l’arrêt d’enregiftrement de ces lettres
portant la claufe, que c’eft fans préjudice des droits
appartenans aux ducs de Bar, en vertu des concordats
de 1571 & 1575.
Quoique cette queftion femble aujourd’hui moins
mtéreffante pour la France, attendu que la Lorraine
& le Barrois y doivent être un jour reunis, on a cru
cependant devoir obferver ici ce qui s’eft paffé par
rapport au pouvoir légiflatif dans le Barrois, afin
<jue l’on n’applique point au Barrois les lois de France
avant le tems où elles pourront commencer à y
être obfervées.
C ’eft en conféquence du pouvoir légiflatif des
ducs de Bar, que la coutume de Bar-le-Duc fut rédigée
de leur autorité : cette coûtume fut formée vraif-
femblablement fur celle de Sens, préfidial, où cette
partie du Barrois reffortiffoit avant l’établiffement
de celui de Châlons. Les anciennes coûtumes de Bar
furent rédigées dès 1506, par ordonnance des gens
des trois états. Charles III. les fit réformer en 1579,
en l’affemblée des états tenue devant le bailli René
de Florainville. Le procureur général du parlement
de Paris ayant appellé de cette rédaction , la cour
ordonna par arrêt du 4 Décembre 1581, que les
coûtumes du bailliage de Bar feroient reçûes & mi-
fes en fon greffe , ainfi que les coûtumes qui font
arrêtées par l’ordonnance & fous l ’autorité du roi.
Elles ont été commentées par Jean le Paige, maître
des comptes du Barrois , qui fit imprimer fon
ouvrage d’abord à Paris en 1698, & depuis, avec
des augmentations, à Bar même en 1711.
L étroite alliance qui fe trouve préfentement entre
le roi de France, & le roi de Pologne duc de
Lorraine & de Bar, a donné lieu à plufieurs édits
& déclarations de chacun des deux fouverains,
en faveur des fujets de l ’autre ; notamment un édit
du roi Staniflas du 30 Juin 1738, & un du roi de
France du mois de Juillet fuivant , qui déclarent
leurs fujets regnicoles de part 8c d’autre : le même
édit du roi de France ordonne que les contrats paffés
en Lorraine, emporteront hypotheque fur les biens
de France, 8c que les jugemens de Lorraine feront
exécutés en France. Le roi Staniflas par une déclaration
du 27 Juin 1746 , & le roi de France par une
déclaration du 9 Avril 1747, ont aufli ordonné que
la difcuflïon des biens d’un débiteur qui aura du bien
en France 8c en Lorraine, fera faite pour le tout de-
yant le juge du domicile du débiteur.
Les coûtumes qui s’obfervent dans les trois évêchés
de Metz, font celle de Metz, celle de l’évêché,
& celle de Remberviller qui en eft locale, quoique
Remberviller foit dans la fouveraineté de Lorraine.
La coûtume de Verdun comprend quelques endroits
qui: font de Lorraine. L’original de cette coû-
tume ayant été perdu , les gens de loi en raffem-
blerent, 8t reftituerent de mémoire les difpofitiohs.
On l’imprima en 1678 : elle n’avoit alors aucune authenticité,
ni date certaine, & ne tiroit fon autorité
que du privilège d’imprimer accordé par Louis XIV.
en 1677. Louis X V , en 174 1 , ordonna qu’elle fer
roit réformée : ce qui a été fait au mois de Février
i*743 > Par un çqnfeiller du parlement de Metz, en
Tome Va
l ’affemblée des trois états. Cette réda&ïon approm-'
vée par lettres patentes , du roi de France en 1747V
eft préfumée inconnue en Lorraine , où les changeo
n s qui furent faits alors, ne font point encore reçus
: on y fuit l’ancienne coûtume. Voye1 ies commentateurs
dés coutumes de Lorraine > & Lès nouveaux,
mémoires fur la Lorraine 6* le Barrois.
D r o i t m a r i t im e , ce font les lois, réglés, &
ufages que l’on fuit pour la navigation, lé commerce
par mer -, & en cas de guerre par mer.
Ce droit eft public ou privé.
^ Le premier eft celui qui regarde l’intérêt de la na**’
tion ; & fi fon objet s’étend jufqu’aux autres nations
•alors il fait partie du droit des gens.
Le plus ancien réglement que l’on trouve pour là
marine de France, eft un édit de François I. du mois
de Juillet 15 1 7 , concernant la jurifdiétion de l’amiral.
II y a ëu depuis quelques édits & déclarations J
portant réglement pour les fondions de différenS
officiers de la Marine.
Mais la première ordonnance générale fur cette
matière, eft celle de Louis XIV. du 10 Décembre
1680, qu’on appelle ¥ ordonnance de la Marine : elle
eft divifée en cinq livres, & chaque livre en plufieurs
titres, contenant différens articles.
Le premier livre traite des officiers de l’amirauté
8c de leur jurifdiftion : le fécond, des gens 8c bâti—
mens de mer : le troifieme, des contrats maritimes r*
le quatrième, de la police des ports, côtés, rades v
& rivages de la mer : & le cinquième, de la pêche
qui fe fait en mer.
Il y a encore une autre ordonnance pour la marine
du ï ç Avril 1689; mais celle-ci concerne les armées
navales.
Outre ces deux grandes ordonnances, il y a’ enf
core eu depuis divers édits 8c déclarations fur cette
matière, qui font indiqués dans le dictionnaire de
Dechales au mot Marine, & dont plufieurs font rapportés
dans le recueil des édits & déclarations re-
giftrés au parlement de Dijon. Voye{ aujjî ce qui a
été dit au mot C o n s e il DES P r is e s , -(^ë)
D r o i t d e l a N a t u r e , ou D r o i t n a t u r e l ^
dans le fens le plus étendu, fe prend pour certains
principes que la nature feule infpire, & qui font
communs à tous les animaux, aufli bien qu’aux hommes
: c’eft fur ce droit que font fondés l’union du mâle
& de la femelle , la procréation des enfans, 8c le
foin de leur éducation ; l’amour de la liberté, la con-
fervation de fon individu, 8c le foin que chacun
prend de fe défendre contre ceux qui l’attaquent.
Mais c’eft abufivemertt que l’on appelle droit naturel
, les mouvemens par lefquels fe conduifent les
animaux ; car n’ayant pas l’ufage de la rai fon, ils
font incapables de connoître aucun droit ni juftice.’
On entend plus fouvent par droit naturel, certaines
réglés de juftice & d’équité, que la feule raifon
naturelle a établies entre tous les hommes, ou pour
mieux dire, que Dieu a gravées dans nos coeurs.
Tels font ces préceptes fondamentaux du droit 8c
de toute juftice,de vivre honnêtement, de n’offenfer
perfonne, & de rendréà chacun ce qui lui appartient.
De ces préceptes généraux dérivent encore
beaucoup d’autres réglés particulières, que la nature
feule, c’eft-à-dire la raifon 8c l’équité, fu^ge-
rent aux hommes.
Ce droit naturel étant fondé fur des principes fî
effentiels, eft perpétuel & invariable : on ne peut y
déroger par aucune convention , ni même par aucu-j
ne lo i, nidifpenfer des obligations qu’il impofe; en
quoi il différé du droitpofitir, c’e ft-à-dire des re-r
gles, qui n’ont lieu que përcè qu’elles ont été établies
par des lois précifes. Ce droit pofitif étant fujet
à être changé 4e la mçme autorité qu’il a été éta*