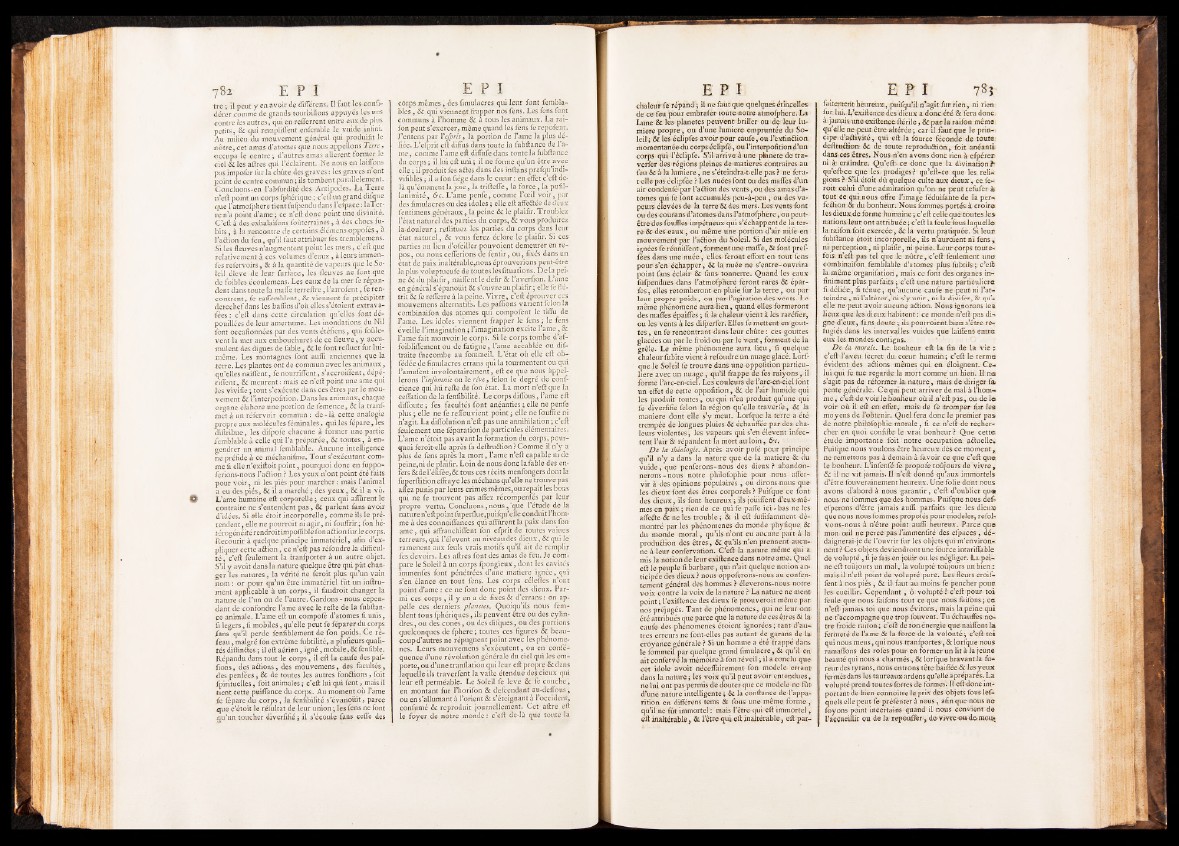
tre ; il peut y en avoir de dïfférens. Ilffantles-confi-
dérer comme de grands tourbillons appuyés les uns
contre les autres, qui en reffer-rent entre eux de plus
petits, & qui remplirent enfemble le vuide infini.
Au milieu du mouvement général qui produifit le
nôtre, cet amas d’atomes que nous appelions Terre,
occupa le .centre ; d’autres amas allèrent former le
ciel & les affres qui l’éclairent. Ne nous en laifTons
pas impofer fur la chute des graves : les graves n’ont
point de centre commun ; ils tombent parallèlement.
Concluons-en l ’abfurdité des Antipodes. La Terre
n’eft point un corps fphérique ; c’eft un grand difque
que l’atmofphere tient fufpendu dans l’efpace : feTer-
re n’a point d’ame ; ce n’eft donc point une divinité.
C ’efl à des exhalaifons foûterraines, à des chocs fu-
bits, à la rencontre de certains eleniense>ppoies, à
l ’a&ion du feu, qu’il faut attribuer fes tremblemens.
Si les fleuves n’augmentent point les mers, c eft que
relativement à ces volumes d’eaux, à leurs immen-
fes refervoirs, & à la quantité de vapeurs que le Soleil
éleve de leur furface, les fleuves ne font que
de foibles écoulemens. Les eaux de la mer fe répandent
dans toute la maffe terreftre, l ’arrofent, fe rencontrent,
fe raffemblent, 8c viennent fe précipiter
derechef dans les baffins d’où elles s’étoient extrava-
fées : c’eft dans cette circulation qu’elles font dépouillées
de leur amertume. Les inondations du Nil
font occafionnées par des vents étéfiens, qui foule-
vent la mer aux embouchures de ce fleuve, y accumulent
des digues de fable, 8c le font refluer fur lui-
même. Les montagnes font aufli anciennes que la
terre. Les plantes ont de commun avec les animaux,
qu’elles naiffent, fe nourriffent, s’accroiffent, dépendent,
& meurent ; mais ce n’eft point une ame qui
les vivifie ; tout s’exécute dans ces êtres par le mouvement
8c l’interpofition. Dans les animaux, chaque
organe élabore une portion de femence, 8c la tranf-
met à un réfervoir commun : de - là cette analogie
propre aux molécules féminales, qui les fépare, les
diftribue, les difpofe chacune à former une partie
femblable à celle qui l’a préparée, & toutes, à engendrer
un animal femblable. Aucune intelligence
ne préfide à ce méchanifme. Tout s’exécutant comme
fi elle n’exiftoit point, pourquoi donc en fuppo-
ferions-nous l’a&ion ? Les yeux n’ont point été faits
pour vo ir, ni les piés pour marcher : mais l’animal
a eu des piés, & il a marché ; des yeux, & il a vu.
Q L’ame humaine eft corporelle ; ceux qui aflurent le
contraire ne s’entendent pas, 8c parlent fans avoir
d’idées. Si e lle étoit incorporelle, comme ils le prétendent,
elle ne pourroit ni agir, ni fouffrir; fon hétérogénéité
rendroit impofîîble fon aélion fur le corps.
Recourir à quelque principe immatériel, afin d’expliquer
cette a&ion, ce n’eft pas réfoudre la difficulté
, c’eft feulement la tranfporter à un autre objet.
S’il y avoit dans la nature quelque être qui pût changer
les natures, la vérité ne feroit plus qu’un vain
nom : or pour qu’un être immatériel fût un infiniment
applicable à un corps, il faudroit changer la
nature de l’un ou de l’autre. Gardons - nous cependant
de confondre l’ame avec le refte de la fubftan-
ce animale. L’ame eft un compofé d’atomes fi unis,
fi légers, fi mobiles, qu’elle peut fe féparer du corps
fans qu’il perde fenfiblement de fon poids. Ce ré-
feau, malgré fon extrême fubtilité, a plufieurs qualités
diftin&es ; il eft aérien, igné, mobile,& fenfible.
Répandu dans tout le corps, il eft la caufe des parlions
, des aôions, des moûvemens, des facultés,
des penfées, 8c de toutes les autres fonctions, foit
fpirituelles, foit animales ; c’eft lui qui fent, mais il
tient cette puiffance du corps. Au moment oii l’ame
fe fépare du corps , la fenfibilité s’évanouit, parce
que,ç’étoit le réfultat de leur union ; les fens ne font
nu’un toucher diverfifié ; il s’écoule fans ceffe des
corps mêmes, des fimulacres qui leur font fembla-
bles, & qui viennent,frapper nos fens. Les fens font
communs à l’homme 8c à tous les animaux. La rai-
fon peut s’exercer, même quand les fens fe repofent.
J’entens par Yefprit, la portion de l’ame la plus déliée.
L ’efprit eft diffus dans toute la fubftance de Taine,
comme l’ame eft diffufe dans toute la fubftance
du corps ; il lui eft uni ; il ne forme qu’un être avec
elle ; il produit fes a&es dans des inftans prefqu’indi-
vifibles ; il a fon fiége dans le coeur : en effet c’eft delà
qu’émanent la joie, la trifteffe, la force, la pufil-
lanimité, &c. L’ame penfe, comme l’oeil voir, par
des fimulacres ou des idoles ; elle eft affeélée de deux
fentimensgénéraux, la peine 8c le plaifir.Troublez
l’état naturel des parties du corps, & vous produirez
la.douieur ; reftitùez les parties du corps dans leur
état naturel, 8c vous ferez éclore le plaifir. Si ces
parties au lieu d’ofciller pouvoient demeurer en repos
, ou nous cefferions de fentir, ou, fixés dans un
état de paix inaltérable,nous éprouverions peut-être
la plus voluptueufe de toutes lesfituations. D e la peine
8c du plaifir, naiffent le defir & l’averfion. L’ame
en général s’épanouit 8c s’ouvre au plaifir ; elle fe flétrit
8c fe refferre à la peine. Vivre, c’eft éprouver ces
moûvemens alternatifs. Les paillons varient félon la
combinaifon des atomes qui compofent le tiffu de
l’ame. Les idoles viennent frapper le fens ; le fens
éveille l ’imagination ; l’imagination excite l’ame, &
l’ame fait mouvoir le corps. Si le corps tombe d’af-
foibliffement ou de fatigue, l’ame accablée ou distraite
fuccombe au fommeil. L ’état où elle eft ob-
fédée de fimulacres errans qui la tourmentent ouqui
l’amufent involontairement, eft ce que nous appellerons
Yinfomnie ou le rêve, félon le degré de confidence
qui lui refte de fon état. La mort n’eft que la
ceffation de la fenfibilité. Le corps diffous, l’ame eft
diflbute ; fes facultés font anéanties ; elle ne penfe
plus ; elle ne fe reffouvient point ; elle ne fouffre ni
n’agit. La diffolution n’eft pas une annihilation ; c’eft
feulement une féparation de particules élémentaires.
L’ame n’étoit pas avant la formation du corps, pourquoi
feroit-elle après fa deftrudion? Comme il n’y a
plus de fens après'la mort, l’ame n’eft capable ni de
peine,ni de plaifir. Loin de nous donc la fable des enfers
&de lelifée,& tous ces récits menfongers dont la
fuperftition effraye les méchans qu’elle ne trouve pas
affez punis par leurs crimes mêmes,ou repaît les bons
qui ne fe trouvent pas affez récompenlés par leur
propre vertu. Concluons, nous, que l’étude de la
nature n’eft point fuperflue,puifqu’elle conduit l’homme
à des connoiffances qui aflurent la paix dans fon
ame, qui affranchiffent fon efprit de toutes vaines
terreurs, qui Pélevent au niveau des dieux, 8c qui le
ramènent aux feuls vrais motifs qu’il ait de remplir
fes devoirs. Les aftres font des amas de feu. Je compare
le Soleil à un corps fpongieux, dont les cavités
immenfes font pénétrées d’une matière ignée, qui
s’en élance en tout fens. Les corps céleftes n’ont
point d’ame : ce ne font donc point des dieux. Parmi
ces corps , il y en a de fixes & d’errans : on appelle
ces derniers planètes. Quoiqu’ils nous fem-
blent tous fphériques, ils peuvent être ou des cylindres
, ou des cônes, ou des difques, ou des portions
quelconques de fphere ; toutes ces figures 8c beaucoup
d’autres ne répugnent point avec les phénomènes.
Leurs moûvemens s’exécutent, ou en confé-
quence d’une révolution générale du ciel qui les emporte,
ou d’une tranflation qui leur eft propre 8c dans
laquelle ils traverfent la vafte étendue des deux qui
leur eft perméable. Le Soleil fe leve 8c fe couche,
en montant fur l’horifon & defeendant au-deffous,
ou en s’allumant à l’orient & s’éteignant à l’occident,
confumé 8c reproduit journellement. Cet aftre eft
ïe foyer de notre monde : c’eft de-là que toute la
chaleur fô répand ; il nefatiüque quelques étincelles
de ce feu pour embrafèr' toute notre atmofphere; La
Lune 8c les- planètes peuvent briller ou de leur lumière
propre, ou d’une lumière empruntée du Soleil;
& Tes éelipfes avoir pour caufe, ou ltextinélion
momentanée du corps écl-ipfé-, ou Tinterpofitiond-un
corps quiTéclipfe. S’iharriveàune ptenetedetra-
verfer des-régions pleines de matieres contraires au
feu & à la lumière, ne s’éteiridra-t-elle pas ? ne fora-
t-elle pas-éclipfée ? Les nuées font ou des maffes d’un
air condenfé;par Paétion des-vents, ou des-amas d’atomes
qui fe font accumulés- peu-à-peu , ou des vapeurs
élevées de la terre 8c des- mers. Les-vents-font
ou des coutans d’atomes dans J’atmofphëre, ou peut-
être des-fouffles impétueux qui s’échappent de la terre
& d'eS eaux , ou même Une portion d’air mife-en
mouvemenr-par P'a&ion du Soleil. Si des. molécules
ignées fe réunifient, forment une maffe , & font pref-
fées dans une-nuée-, elles feront effort en tout fens
pours’én échapper, 8i la; nuée ne s’entre-ouvrira
point fans éclair 8c fans tonnerre. Quand les eaux
fûfpendues, dans Patmofphere feront rares & épar-
fes, elles retomberont en- pluie für la- terre, ou par
leur propre- poids, ou par l’agitation des vents. Le
même phénomène aura-lieu, quand elles formeront
des mafles épaiffes ; fi la chaleur vient-à les raréfier,
ou les vents à‘ les difperfer. Elles fe mettent-en gouttes,
en fe rencontrant- dans leur chûte : ces-gouttes
glacées ou par le froid ou-par le Vent, forment de la
grêle. Le même phénomène aura lieu, fi quelque
chaleur fubite vient à refoudre un nuage glacé. Lorfque
le Soleil fe trouve dans une oppofition particulière
avec un nuage, qu’il frappe de fes raiyons, il
forme l’arc-en-ciel. Les couleurs de l’arc-en-ciel font
un effet de cette oppofition, & de Pair humide qui
les produit toutes, ou qui n’ên produit qu’une qui
fe diverfifié félon la région qu’elle traverfe, & la
maniéré dont elle s’y meut. Lorfque la terre a été
trempée de longues pluies & échauffée par des chaleurs
violentes ; les vapeurs qui s’en élevent infectent
Pair & répandent la mort au loin, &c.
De la théologie. Après avoir pofé: pour principe
qu’il n’y a dans la nature que de la matière & du
vuide j que penferons- nous des dieux ? abandonnerons
nous notre philofophie pour nous affer-
vir à des opinions populaires , ou dirons-nous que
les dieux font des êtres corporels ? Puifque ce font
des dieux, ils font heureux ; ils joiiiffent- d’eux-mêmes
en paix; rien de ce qui fe paffe ici*-bas ne les
affefte & ne les trouble ; & il eft fuffifamment démontré
par les phénomènes du monde phyfique, 8c
du monde moral, qu’ils-n’ont eu aucune part à* la
produ&ion des êtres , & q u ’ilsn’en prennent-aucune
à- leur confervation. C ’eft la nature meme qui a
mis la-notion de leur exiftence dans notre ame. Quel,
eft le peuple fi barbare , qui n’ait quelque notion anticipée
des dieux ? nous oppoferons-nous au confen-
tement général des hommes ? éleverons-nous notre
voix contre la voix de la nature ? La nature ne ment
point ; Pexiftence des dieux fe prouveroit même par.
nos préjugés. Tant de phénomènes, qui ne leur ont
été attribués que parce que la nature de ces êtres & la-
caufe des phenomenes étoient ignorées ; tant d’autres
erreurs ne font-elles pas autant de garans de la*
croyance générale ? Si un homme a été frappé dans
le fommeil par quelque grand fimulacre, & qu’il en
aitconfervéla mémoire à fon réveil ; il a conclu que
cet idole avoit néceffairement- fon modèle errant
dans la nature ; les voix qu’il peut avoir entendues,
ne lui ont pas permis de douter que ce modèle ne fût
d?une nature intelligente; & la confiance de*Pappa-
riti'on en différens tems & fous une même forme,
qu’il ne fût immortel : mais l’être- qui- eft immortel,
eft inaltérable, & l’être qui eft inaltérable, eft parfaitenrent
heureux;, puÜqjx’il. n’agit fiir rien, ni rien
lur lui.. L’exiftenc© des dieux a donc, été & fera donc,
àijamaisune exiftenceftérile, & par la raifon même
qu’elle, ne peut êtne akérée ; car il. faut que le pria--
cipe. d’aélivité, qui eft. la fource féconde de toute:
deftcu$i©n- & de toute reproduâicm., foit anéanti
dans ices/êtres. Nous n’en avons donc rien.à efpérec
ni,àî craindre. Qu’effi-ee donc que la. divination?»
qu?elbce que les; prodiges ? qu’eft-ee que les. reli«
gions ? ^ S’il étoit dû quelque culte aux dieux, ce feroit!
.celui d’une admiration qu’on, ne peut refufer à
tout: de; qui. no us offre l’image fédulfante de la per-
feéÜQn.& du bonheur; Nous fommes portés à croire.
lesidieux.de forme humaine ;.c’eft cellequéitôutes les
nations, leur ont attribuée ; c’eft la feule fous laquelle
lai raifon; foit. exercée-, 8c la vertu pratiquée. Si leuc
fubftance étoit incorporelle, ils n’auraient ni fens,
ni perception, ni plaifir, ni peine. Leur corps toutefois.
n’elb pas tel que le nôtre, c’eft: feulement une
combinaifon. femblable d’atomes plus fubüls.;. c’eft}
lai même organifatiori , mais.ee font des organes infiniment
plus parfaits ; c’eft une nature parriouliere
fi.deliée , fi ténue, qu’aucune caufe ne peut; ni l’atteindre.,
ni l’altérer, ‘ni s’y unir, ni la divifeo, &. quelle
ne/peut avoir aucune aèlion. Nous ignorons les
lieux.que les dieux habitent;, ce monde n’eft;pas digne
d’eux, fans.doitte ^ ils pourroient.bism s’être.réfugiés,
dans les. intervalles vuides que lailfent entra
eux les. mondes, contigus.
De la, morale. Le. bonheur eft; la fin de- la vie 5
c’eft Paveu. fecret duj coeur humain; c’eft le terme
évident:des, aâions mêmes qui. en. éloignent.. Ce«*
luLqui fe tue regarde:^ mort comme un bien. 11: na
s’agit pas de réformer la, nature, mais.de diriger fa>
pente" générale. Cejqui.peut arriver de mal à L’hom-*
nie., c’eft.de. voinle honfreur oii.il n’èfbpas., ou.de le
voir où il. eft en, effet, maiside f e -tromper fur. lea
moyens de Pobtenir. Quel fera donc le premier pa9
de notre phiiofophie morale, fi ce. n’eft de rechercher.
eni quoi confifte le . vrai bonheur ? Que cette
étude importante foit notre occupation aûuelle^
Puifque nous voulons être heureux,dès ce moment,
ne remettons pas à. demain à. fa voir ce que c’eft que
le bonheur. L’infenféTe propofe toujours de viv re ,
8c il'ne v.it jamais. Il n’eft donné qu’aux immortels
d’être fouverainement heureux. Une folie dont nous
avons cL’abordi à nous garantir, c’eft d’oublier que
nous; ne-fommes qqedes hommes. Puifque nous défi«
efperons. d’être jamais; aufli parfaits que les dieu»
que nous nous fommespropoiés pour modèles, refol-
vons,-nous à n ’être point aufli.heureux. Parce* que
mon oeil ne perce-pas Pimmenfité des efpaces , dédaignerai
je de l’ouvrir fur les objets qui m’environ«-
nent ? Ces objets deviendront une fource intariffable
de volupté , fi je fai^-en.jouir, ou.les négliger. La.peine
eft toûjours un mais, la volupté" toûjours un bien.:
mais»il.n’eft point de volupté pure. Les fleurs croifi.
fent-à nos piés, 8c ilvfaut au.moins fe pencher pour
les-Gueillir. Cependant, ô-volupté.!r c’eft pour toi
feule; que nous faifons tout ce que nous fe fions; ce
nfeftj jamais, toi que nous évitons, mais la peine qui
ne-t’àccompagne que trop fouvent. Tu échaufes notre
froide railon; c’eft1 de toaénergie que-naiffent. la
fermeté de l’ame & la force de la volonté; c’eft toi
qui nous meus, qui nous-tranfportes', & lorfque nous
ramaffons des rofes- pour- en former un lit à la jeune
beauté qui nous a charmés-, & lorfque bra-vantla fu-
reurdes tyrans, nous entrons tête baifîée & les yeux
fermésdans les taureauxardensqu’elleapréparés. La
volupté prend; tou tes-fortes déformés'; Il-eft donc important
de bien connoître le pri-x des objets fous lef-
qùelfrellë peut-fe préferifer à nous , afin-que nous ne
loyons point incertains quand il-nous convient de
l’accueillir ou de la repoufibr-, de- vivre -ou dee rnou^