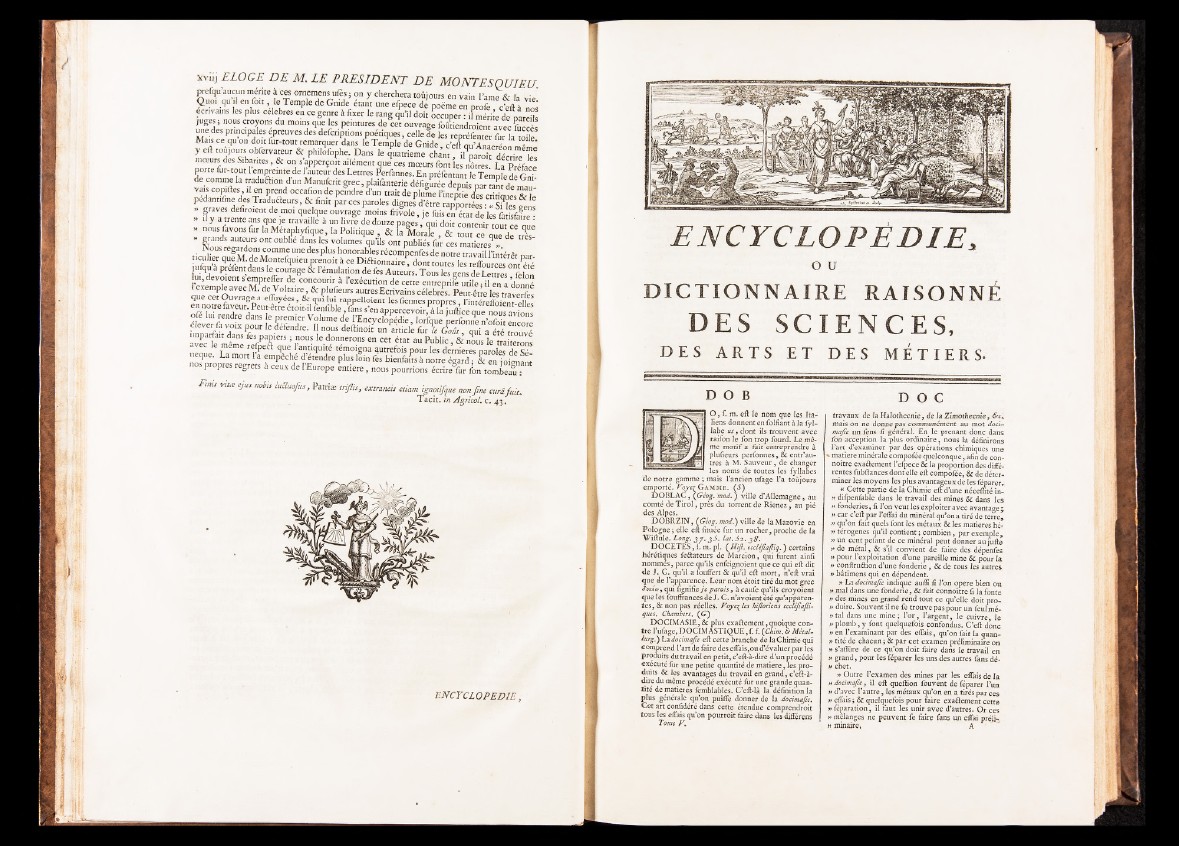
xvüj ELOGE DE M. LE PRESLDENT DE MONTESQUIEU
prefqu’aùcun mérite à ces ornemens ufés ; on y cherchera toûiours en vain H - ’
Quot qu 1 en foit le Temple de Gnide étaifc une efpece d i poëme en profe c î f t à nos
écrivains les plus célébrés en ce genre à fixer le rang qu’il doitioccuper : il méri e de parefis
juges; nous croyons du moins que les peintures de cet ouvrage foûriendroient avec fuccès
une des principales épreuves des defcriptions poétiques , celle de les repréfenter fur la tofie
Mais ce qu on doit lur-tout remarquer dans le Temple de Gnide r ’r L n ’À n ,, I 1 a
y eft toujours obfervateur & phi&ophe. Dans le quatrième cha’nt S e ^
moeurs des S.bantes, & on s apperçoit ailément que ces moeurs font les nôtres
porte fur-tout 1 empreinte de 1 auteur des Lettres Perfannes. En préfentant le Temple de G n f
de comme la rradudion d’un Manufcrit grec , plaifanterie défigurée depuis nar mn7 °
vais copiftes il en prend occafion de peindre d’un trait de plulte l’ineprie des — M
pedantifme des Tradufteurs, & finit par ces paroles dignes d’être rapportées “ sHes eenî
» giaves defiroient de moi quelque ouvrage moins frivole, je fuis en état de les fatisfalre •
» .1 y a trente ans que ,e travaille à un livre de douze pages1 qui doit contenir tout ce que
I H B | fur la ’ la W Ê Ê > & i Morale , & tout ce que de trTs
- grands auteurs ont oublie dans les volumes qu’ils ont publiés fur ces m a t ie ^ »
Nous regardons comme une des plus honorables rècompenfes de notre travaül’imérêt par
t cuber queM.deMontefquieu prenoit à ce Dictionnaire, dont toutes les reffources ontété
■ P-!fe.nt’dailS “ rémulation de Auteurs. Tous les gens de Lettres félon
■ ■ ■ s » 9 de. concourir à l’exécution de cette entrepril utile : il en a donné
xempleavecM. de Voltaire & plufieurs autres Ecrivains célébrés. Peut-être les traverfes
que cet Ouvrages elfuyees, & qui lui rappelloient les tiennes propres l’intéreffoient elles
en notre faveur Peut-être étoit-ilTenfible, B s’en aPPercevoir,à lam é c e a u e « M M
ofe lui rendre dans e premier Volume de l’Encyclopédie, lorfque perfonne n’ofoit encore
M f f l s x m p,our Ie défendre- 11 nous deftinoit H l ■ S o û t, qui a l t é m m 7 danS fes, pa£lers ; ,"0US le donnerons en cet état au Public, & nous le traiterons
avec le meme refpeét que 1 antiquité témoigna autrefois pour les demieres paroles de Sé
neque. La mort l’a empêché H H plus l i n fes bienfait à notre égard - H T o it a *
os propres regrets à ceux de 1 Europe entière, nous pourrions écriregfur fon tombeau :
Finis nue ejus nobis luUuofus, Patriæ tnftis.extraneis etiam ignotifque non fine curâ fuit.
Tacit. in Agricol. c. 43.
E N C Y C L O P E D IE ,
ENCYCLOPÉDIE,
O U
DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES S C I E N C E S ,
DES A R T S ET DES MÉTIERS .
D O B
O , f. m. eft le nom que les Italiens
donnent en folfiant à la fyl-
labe ut, dont ils trouvent avec
raifon le fon trop fourd. Le n
me motif a fait entreprendre à
plufieurs perfonnes , èc entr’au-
tres à M. Sauveur, de changer
les noms de toutes les fyllabes
de notre gamme ; mais l’ancien ufage l’a toujours
emporté. Voye^ Gamme. ( 51)
D O B LA C , ( Géog. 'mod. ) ville d’Allemagne, au
comté de Tiro l, près du torrent de Rienez, au pié
des Alpes.
DOBRZIN, (Géog. mod.) ville de laMazovie en
Pologne ; elle eft fituée fur un rocher, proche de la
Wiftule. Long. $ j . lat. S z. 38.
D OC ETES, f. m. pi. ( Hiß. eccUfiaßiq. ) certains
hérétiques feûateurs de Marcion, qui furent ainfi
nommes, parce qu’ils enfeignoient que ce qui eft dit
de J. C. qu’il a fouffert & qu’il eft mort, n’eft vrai
que de l’apparence. Leur nom étoit tiré du mot grec
à'oKtw, qui lignifie j e parois , à caufe qu’ils croyoient
que les fouffrances de J. C. n’a voient été qu’apparentes
, & non pas réelles. Voye£ Us hißoriens ecclißaßi-
ques. Chambers. (G)
DOC IMASlE,& plus exa&ement, quoique contre
l’ufage,DOCIMASTIQUE,f. f. (Chim. &Métal-
lurgi) La docimafie eft cette branche de la Chimie qui
comprend l ’art de faire des effais,ou d’évaluer par les
produits du travail en petit, c’eft-à-dire d’un procédé
exécuté fur une petite quantité de matière, les produits
& les avantages au travail en grand, c’eft-à-
dire du même procédé exécuté fur une grande quantité
de matières femblables. C’eft-là la définition la
plus generale qu’on puiffe donner de la docimafie.
Cet art confidére dans cette étendue comprendroit
tous les effais qu’on ppurroit faire dans les différens
Tome y .
D O C
travaux de la Halothecnie, de la Zimothecnie, &ci.
mais on ne donne pas communément au mot docimafie
un feus fi general. En le prenant donc dans
Ion acception la plus ordinaire, nous la définirons
Part d’examiner par des opérations chimiques une
' matière minérale compofée quelconque, afin de con-
noître exa&ement l’efpece & la proportion des différentes
fubftances dont elle eft compofée, & de déterminer
les moyens les plus avantageux de les féparer.:
« Cette partie de la Chimie eft d’une néceffité in-
>> difpenfable dans le travail des mines & dans les
» fonderies, fi l’on veut les exploiter avec avantage ;
» car c’eft par l’effai du minéral qu’on a tiré de terre,
» qu’on fait quels font les métaux & les matières hé-
» térogenes qu’il contient ; combien, par exemple,
» un cent pelant de ce minéral peut donner au jufte
» de métal, & s’il convient de faire des dépenfes
» pour l’exploitation d’une pareille mine & pour la
» conftruftion d’une fonderie, & de tous les autres
» bâtimens qui en dépendent.
» La docimafie indique auffi fi Ton opéré bien ou
» mal dans une fonderie, & fait conrioître fi la fonte
» des mines en grand rend tout ce qu’elle doit pro-
» duire. Souvent il ne fe trouve pas pour un feulmé-
»tal dans une mine; l’o r , l’argent, le cuivre le
» plomb, y font quelquefois confondus. C ’eft donc
» en l’examinant par des effais, qu’on fait la quan-
» tité de chacun ; & par cet examen préliminaire on
» s’aflure de ce qu’on doit faire dans le travail en
» grand, pour les féparer les uns des autres fans dé-
v chet.
» Outre l’examen des mines par les effais de la
» docimafie, il eft queftion fouvent de féparer l’un
» d’avec l’autre, les métaux qu’on en a tirés par ces
» effais ; & quelquefois pour faire exaôement cette
» féparation, il faut les unir avec d’autres. Or ces
» mélanges ne peuvent fe faire fans un effai préfe
» minaire, A