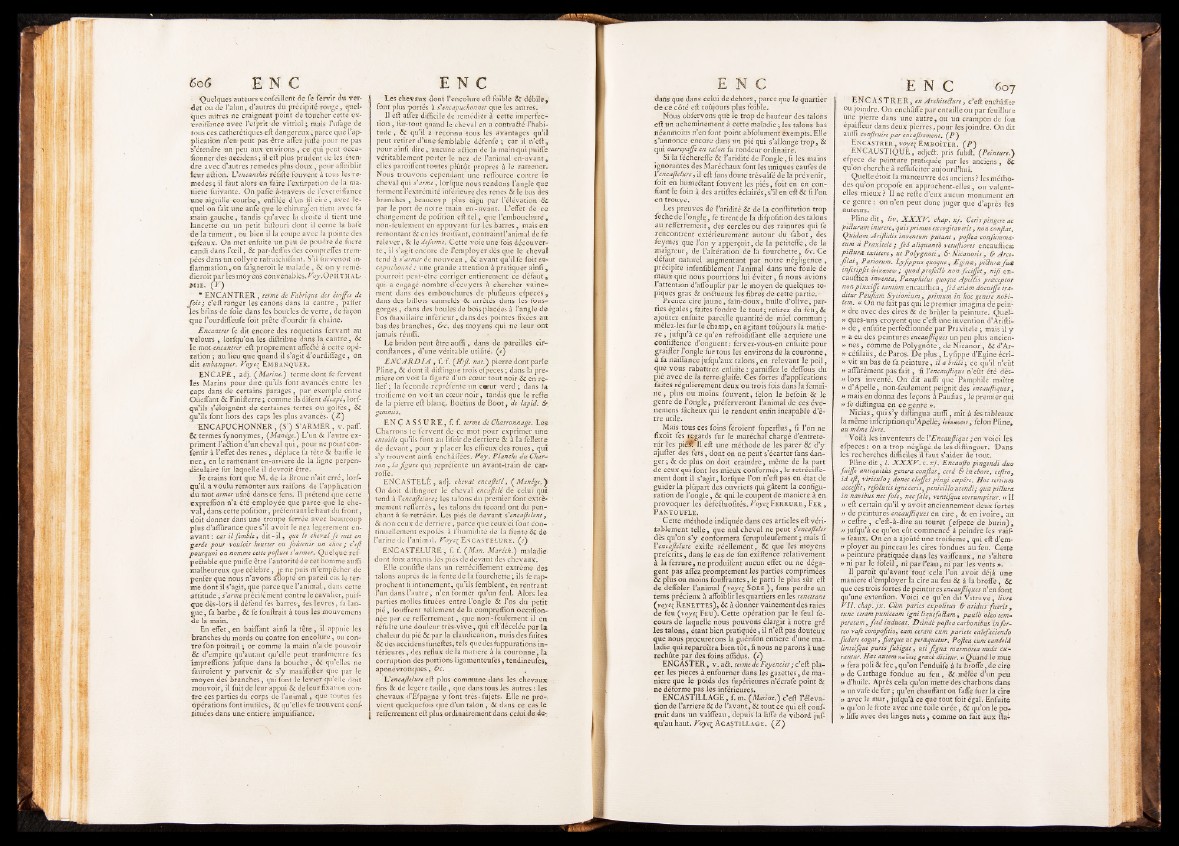
- Quelques auteurs -confeillent de fe îervir du vers
e t ou de l’alun, d’autres du précipité rouge, quelques
autres ne craignent point de toucher cette ex-
croiffance avec l’elprit d e vitriol; mais l’ufage de
tous ces catherétiques eft dangereux, parce que l’application
ri’en peut pas -être a fiez jufte-pour ne pas
s’ étendre -un peu aux-environs , ce qui peut occa-
fionnerdes accidens ; il eft plus prudent de les -étendre
avec d’autres remedes plus doux, pour-afFoiblir
leur action. U encanthis réfille fouvent à tous lès remèdes
; il faut alors en faire l’extirpation de la maniéré
fuivante. On palfe à-traver-s de i’excroiffance
line aiguille courbe , enfilée d’un fil c iré , avec lequel
on fait une anfe que le chirurgien tient avec la
main gauche, tandis qu’avec la droite il tient une
lancette ou un petit billouri dont il cerne la bafe
de la tumeur, Ou bien il la coupe avec la pointe des
cifèaux. On met enfuite un peu de poudre de fucre
candi dans l’oe il, & par-defiiis des compreffes trempées
dans un collyre rafraîchilfant. S’il fûrvenoit in-
flammatioiiyon faigneroit le malade, & on y remédierait
par les moyens convenables. Voy .Op h th al- JMIE. (T )
* ENCANTRER , terme de Fabrique des étoffes de
Joiej c’eft ranger les canons dans la cantre , palier
les'bfîns-de foie dans les boudes de verre, de façon
que l’ourdiffeufe foit prête d’ourdir fa chaîne.
Encantrer fè dit encore des roquetins fervant au
velours , lorfqu’on les diftribue dans la cantre, &
le mot encantrer eft proprement affeûé à cette operation
; au lieu que quand il s’agit d’ourdiffage, on
dit embanquer. Voye^ Emban-QUER.
ENGAPÉ, adj. ( Marine.) terme dont fe fervent
les Marins pour dire qu’ils font avancés entre les
caps dans de certains parages , par exemple entre
Oüeffant & Finifterre ; comme ils dilent décapé, lorf-
qu’ ils s’éloignent de certaines terres ou golfes, &
qu’ils font hors des caps les plus avancés. (Z )
EN C APU CHONNER , (S') S’ARMER, v. paff.
& -termes fynonymes, (Manège.) L’un & l’autre expriment
l’a&ion d’un cheval qui, pour ne point con-
fentir à l’effet des renes, déplace fa tête & baiffe le
nez , en le ramenant en-arriere de la ligne perpendiculaire
fur laquelle il devroit être.
Je crains fort que M. de la Broue n’ait erré, lorsqu'il
a voulu remonter aux raifons de l’application
du mot armer ulité dans ce fens. Il prétend que cette
expreffion n’a été employée que parce que le cheval
, dans cette pofitiotr, présentant le haut du front,
doit donner dans une troupe ferrée avec beaucoup
plus d’alïurance que s’il avoit le npz legerement en-
avant : car il ftmble , dit - i l , que Le cheval fe met en
■ garde pour vouloir heurter ou J'oûtenir un choc ; défi
pourquoi on nomme cette pojlure s'armer. Quelque ref-
peûable que puilfe être l’autorité de cet homme auffi
malheureux que célébré, je ne puis m’empêcher de
penfer que nous n’avons âuopté en pareil cas le terme
dont il s’agit, que parce que l’animal, dans cette
attitude, s'arme précifément contre le cavalier, puil-
que dès-lors il défend fes barres-, fes levres, fa langue
, fa barbe, & fe fouftrait à tous les mouvemens
de la main.
En effet, en baiffant ainfi la tête, il appuie les
branches du mords ou contre fon encolure, ou contre
fon poitrail ; or comme la main n’a de pouvoir
& d’empire qu’autant qu’elle peut tranfmettre fes
împreffions jufque dans la bouche, & qu’elles ne
fauroient y parvenir & s’y manifefter que par le
moyen des branches, qui font le levier qu’elle doit
mouvoir, il fuit de leur appui & de leur fixation contre
ces parties du corps de l’animal, que toutes fes
opérations font inutiles, & qu’elles fe trouvent constituées
dans une entière impuifîance.
Les chevaux dont l’encolure eft foîble & débile ,
font plus-portés à s'encapuchonner que les antres.
Il eft allez difficile de remédier à cette imperfection
, fur-tout quand le cheval en a cohtra&é l’habitude
, & qu’il a reconnu tous les avantages qu’il
peut retirer d’une femblable défenfe ; car il n’eft,
pour ai né dire, aucune aélion de la main qui puilfe
véritablement porter-le nez de l’animal en-avant,
elles paroiffent toutes- plutôt propres à -le ramener.
Nous trouvons cependant une reffource contre le'
cheval qui s'arme, lorfque nous rendons l’angle que
forment l’extrémité inférieure des renes & le bas des
branches , beaucoup plus aigu par l’élévation Sc
par le port de notre main en-avant. L’effet de ce
changement de pofition eft t e l , que l’embouchure ,
non-feulement en appuyant fur les barres , mais en
remontant & en les froiffant, contraint l’animal de fe
relever, & le defarme. Cette voie une fois découverte
, il s’agit encore de l’employer dès que le cheval
tend à s'armer de nouveau , &C avant qu’il fe foit encapuchonné
: une grande attention à pratiquer ainfi,
pourroit peut-être corriger entièrement ce défaut,
qui- a engagé nombre d’écuyers à chercher vainement
dans des embouchures de plufieurs efpeces,
dans des billots cannelés & arrêtés dans les fous-
gorges, dans des boules de bois placées à l’angle de
l’os maxillaire inférieur, dans des pointes fixées au
bas des branches, &c. des moyens qui ne leur ont
jamais réuffi.
Le bridon peut être auffi dans de pareilles cir-
conftances, d’une véritable utilité, (e)
EN CAR DIA , f/f. {fi<-fi- nat.) pierre dont parle
Pline, & dont il diftingue trois efpeces ; dans la première
on voit la figure d’un coeur tout noir & eh relief
; la fécondé repréfente un coeur verd ; dans la
troifieme on voit un coeur noir, tandis que le refte
de la pierre eft blanç, Boëtius de Boot, de lapid. &
EN Ç A S S U R E , f. f. terme de Charronnage. Les
Charrons fe fervent de ce mot pour exprimer, une
entaille qu’ils font au lifoir de derrière & à la fellette
de devant, pour y placer les effieux des roues, qui
s’y trouvent ainfi enchâffées.- Voy. Planche du Charron
y la figure qui repréfente un avant-train de car-
roffe.
ENCASTELÉ, adj. cheval encafielè, (Manège.}
On doit diltinguer le cheval encafielè de celui qui
tend à l’encafielure; Les talons du premier font extrêmement
renerrés , les talons dit fécond ont du penchant
à fe rétrécir. Les piés de devant s'encaflelent,
& non ceux de derrière, parce que ceux-ci font continuellement
expofés à l’humidité de la fiente 8cde
l’urine de l’animal. Voye^ Encastelure. ( f )
ENCASTELURE, f. f. (Man. Marèch.) maladie-
dont font atteints les piés de devant des chevaux.
Elle confifte dans un retréciffement extrême des
talons auprès de la fente de la fourchette; ils fe rapprochent
fi intimement, qu’ils femblent, en rentrant
l’Un dans l’autre, n’en former qu’un feul. Alors les
parties molles fituées entre l’ongle & l’os du petit
pie, fouffrent tellement de la compreffion occafion-"
nçe par ce refferrement, que non-feulement il en
réfulte une douleur très-vive, qui eft'décelée parla
chaleur du pié & pa r la claudication, mais des fuites
& des accidens funeftes, tels que des fuppurations intérieures
, des reflux de la matière à la couronne, la
corruption des portions ligamenteufes, tendineufes,
aponévrotiques, Oc. , . y
L’encafielure eft plus commune dans les chevaux
fins & de legere taille, que dans tous les autres : les
chevaux d’Efpagne y font très-fujets. Elle ne pro-,
vient quelquefois que d’un talon, & dans ce cas le
refferrement eft plus ordinairement dans celui de.de-.
élans que dans celui de dehors, parce que le quartier
de ch côté eft toujours plus foibfe.
Nous obfervons qifé le trop de hauteur des talons
eft tm acheminement à cette maladie ; les talons baé
néanmoins n’en font point abfolument êxempts. Elle
s’annonce encore dans un pié qui s’allongé trop, &
qui otitrepaffe en talon fa rondeur ordinaire.
Si la féchereffe & l’aridité de l’ongle, fi les mains
ignorantes des Maréchaux font les uniques caufes de
l 'encafielure, il eft fansdoute très-aifé de la prévenir,
foit en humeélant fouvent les piés, foit en en confiant
le foin à des artiftes éclairés , s’il en eft & fi l’on
en trouve.
Les preuves de l’aridité & de la conftitution trop
fieche de l’ongle, fe tirent de la difpofition des talons
au refferrement, des cercles oti des rainures qui fe
rencontrent extérieurement autour du fabot, des
feymes que l’on y apperçqit, de' la petitéffe, de la
maigreur, de l’altération, dé la fourchette, Oc. Ce
defaut naturel augmentant par notre négligence ,
précipite infenfiblement l’animal dans une foule de
maux que nous pourrions lui éviter, fi nous avions
1 attention d’affouplir par le moyen de quelques topiques
gras & onôtueux les fibrès de cette partie.-
Prenez cire jaune, fain-doux, huile d’olive, parties
égales ; faites fondre le tout; retirez du feu , &
ajoutez enfuite pareille quantité de miel commun ;
mêlez-les fur le champ, en agitant toûjours la matie-
re , jufqu’à ce qu’en refroidiffant elle acquière une
confiftence d’onguent : fervez-vo.us-en enfuite pour
graiffer l’ongle fur tous les envitôns de la couronne,
à fa naiffance jufqu’aux talons, en relevant le poil,
que vous rabattrez enfuite : garnifféz le deffous du
pié avec de la terre-glaife. Ces fortes d’applications
faites régulièrement deux ou trois fois dans la femai-
îîe , plus ou moins fouvent, félon le befoin & le
genre de l’ongle, préfôfveront l’animal de ces évé-
nemens fâcheux qui le rendent enfin incapable d’être
utile.
Mais tous ces foins feroient fuperflus, fi l’on ne
fixoit fes regards fur le maréchal chargé d’entretenir
les piëS. Il eft une méthode de les parer 8>c d’y
a'jufter des Fers, dont on ne peut s’écarter fans danger
; & de plus On doit craindre, même de la part
de ceux qui font lés mieux conformés, le retréciffe-
anent dont il s’agit, lorfque l’on n’eft pas en état de
guider la plûpart des ouvriers qui gâtent la configuration
de l’ongle, & qui le coupent de maniéré à en
provoquer les défeéluofités.^qy^Ferrure, Fer ,
Pantoufle.
Cette méthode indiquée dans ces articles eft véritablement
telle, que nul cheval ne peut s'encafleler
dès qu’on s’y conformera fcrupuleufement ; mais fi
Pencafielure exifte réellement, & que les moyens
preferits, dans le cas de fon exiftence relativement
à la ferrure, ne produifent aucun effet ou ne dégagent
pas affez promptement les parties comprimées
& plus ou moins fouffrantes, le parti le plus sûr eft
de deffoler l’animal ( voye£ Sole ) , fans perdre un
tems précieux à affoiblir les quartiers en les renettant
(voyc^ Renettes), & à donner vainement des raies
de feu (yoye^ Feu). Cette opération par le feul fe-
cours de laquelle nous pouvons élargir à notre gré
les talons, étant bien pratiquée, il tî’èft pas douteux
que nous procurerons la guérifon entière d’une maladie
qui reparoîtra bien-tôt, fi nous ne parons à Une
rechute par des foins affidus. (e)
ENCASTER, v . aft. terme de Fayentier ; c’eft placer.
les pièces à enfourner dans les gazettes, de maniéré
que le poids des fupérieures n’écrafe point &
ne déforme pas les inférieures.
ENCASTILLAGE, f. m. (Marine.') c’eft l’eleva-
tion de l’arriere & de l’avant, & tout ce qui eft çonf-
truit dans un vaiffeau, depuisTa liffe de vibord juf-
qu’au haut. Voye^ Aca§tillage. (Z )
E N C A S T R E R , en Architecture , c’eft enchâffer
ou joindre. On enchâffe par entaille ou par feuillure
une pierre dans une autre, ou un crampon de fon
epaiffeur dans deux pierres, pour les joindre. On dit
auffi çonfiruirepar cncajlrement. (P ) Encastrer, voye{ Emboîter. (P )
ENCAUSTIQUE, adjeft. pris fubft. (Peinture.}
efpece de peinture pratiquée par les anciens, &
qu’on cherche à reffufeiter aujourd’hui.
Quelle etoit la manoeuvre des anciens ? les méthodes
qu’on propofe en approchent-elles, ou valent-
elles mieux } R ne refte d’eux aucun monument ert
ce genre : on n’en peut donc juger que d’après lés
auteurs.
Pline dit, liv. X X X V . chap. xj. Ceris pingere ac
picturam inurere, quisprirnus excogitaverit, non confiât.
Quidam Arfiidis inventam putant, poflea confumma-
tum a Praxitèle j fed aliquantb vetufliores encauflicæ
pictura extitere , ut Polygnoti , & Nicanoris, & Arce-
filai y Pariorum. Lyfippus quoque, E gin ce, picluroe fuce
W Æ M m vtY.ctuGiv ; quodprofeclb non fecijfet, nifi en-
cauftica inventa', Pamphilus quoque Apellls prceceptor
nonpinxiffe tantum.encaullica, fed. etiàm docuiffe ira-
ditur Paujîam Sycionium, prémuni in tioc genere nobi-
iem. « On ne fait pas qui le premier imagina de pein-
» dre avec, des cires & de brûler la peinture. Quel-
» ques-uns croyent que c’eft une invention d’Arifti-
» de, enfüite perfectionnée par Praxitèle ; mais il y
» a eu des peintures encaufiiques un peu plus ancien-
» nés, comme de Polygnote, de Nicanor, & d’Ar-
» céfilaiis, de Paros. De plus, Lyfippe d’Egine écri-
» vit au bas de fa peinture, il a brûlé ; ce qu’il n’eût
» aflurement pas fa it , fi l’enedufiique n’eût été dès-
» lors inventé. On' dit auffi que Pamphile maître
» d’Apelle, non-feulement .peignit des encaufiiques,
» mais en donna des leçonsrà Paufias, le premier qui
» fe diftingua en ce genre >>.
Nicias, qui s’y diftingua auffi, mit à fes tableaux
la même infeription qu’Apelle, tWxetverey , félon Pline,
au même livre.
Voilà les inventeurs de VEncaufiique ;en voici les
efpeces.: on a trop négligé.de les diftinguer. Dans
les recherches difficiles il faut s’aider de tout.
Pline d it , l. X X X V . c. x jv Encauflo pingendi duo
fuiffe antiquitiis généra confiât? cera & in ebore, cefiro,
id efl, viriculo ; donec claffès pingi cap ère. Hoc tertium
acceffit, refolutis igni ceris, penicillo utendi; quoe. piclura
in navibus nec foie, nec fale, ventifque coirumpitur. « Il
» eft certain qu’il y avoit anciennement deux fortes
» de peintures encaufiiques en cire, & en ivoire, au
» ceftre , c’eft-à-dire au touret (efpece de burin) ,
» jufqu’à ce qu’on eût commencé à peindre les vaifi
» féaux. On en a ajoûté une troifieme, qui eft d’em-
» ployer au pinceau les cires fondues au feu. Cette
» peinture pratiquée dans lés vaiffeauX, ne s’àltere
«ni par le foleil, ni p arl’eau, ni par les vents «.
Il paroît qu’avant tout cela l’on avoit déjà une
maniéré d’employer la cire au feu & à la brofle, &
que ces trois fortes de peintures encaufiiques n’en font
qu’une extenfion. Voici ce qu’èn dit Vitruve, livre
VII. chàp.jx. Càm paries expoli tus & aridusfuerit,
tune cerampuniceam igni liquefaclam, paulb ôlèo tem-
peratam, fêta inducat. Deindh pofiea carbonibus infer-
reo vafe coihpofitis, eam ceram cüm pàriete calefaciendo
fudare cogat, fiatque utperoequetur. Pofièa cum candelâ
linteifque puris fubigat, uti figna niarmoréa nuda cu-
rantur. Hue autem xauinç greecè dicitur. « Quand le mue
« fera poli & fe c , qu’on l’enduife à la brôffe, de cire
>> de Carthage fondue au feu, & mêlée d’un peu
« d’huile. Après cela qu’on mette des charbons dans
» un vafe de fer ; qu’en chauffent on faffe fuer la cire
« avec le mur, jufqu’à ce que tout foit égal. Enfuite
« qu’on le frote avec une toile cirée, & qu’on le pa-
« liffe avec des linges nets, comme on fait aux ftar